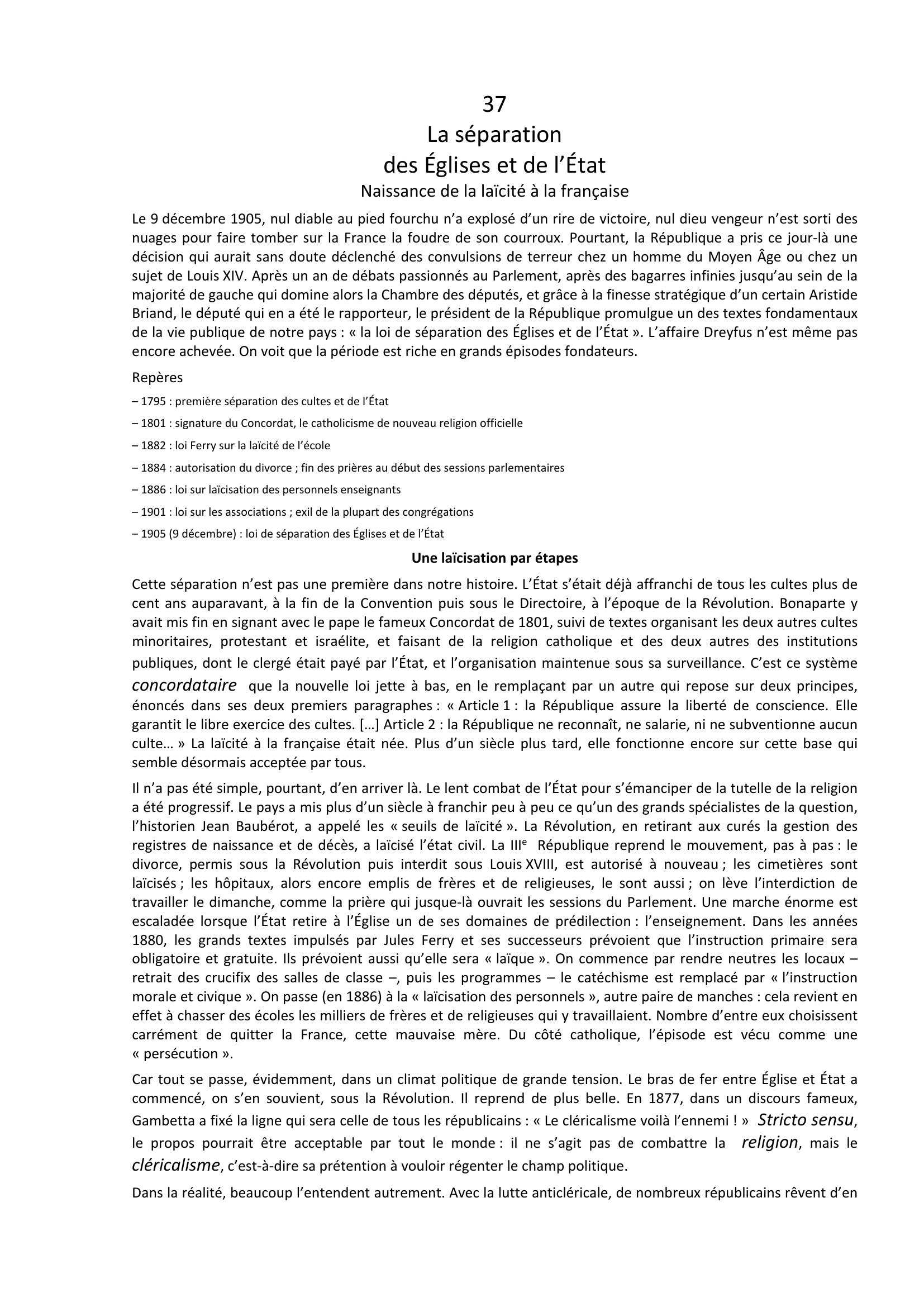innocent.
Publié le 06/01/2014
Extrait du document
«
37
La séparation
des Églises etde l’État
Naissance delalaïcité àla française
Le 9 décembre 1905,nuldiable aupied fourchu n’aexplosé d’unriredevictoire, nuldieu vengeur n’estsortides
nuages pourfairetomber surlaFrance lafoudre deson courroux.
Pourtant,laRépublique apris cejour-là une
décision quiaurait sansdoute déclenché desconvulsions deterreur chezunhomme duMoyen Âgeouchez un
sujet deLouis XIV.
Aprèsunande débats passionnés auParlement, aprèsdesbagarres infiniesjusqu’au seindela
majorité degauche quidomine alorslaChambre desdéputés, etgrâce àla finesse stratégique d’uncertain Aristide
Briand, ledéputé quienaété lerapporteur, leprésident delaRépublique promulgueundes textes fondamentaux
de lavie publique denotre pays : « laloide séparation desÉglises etde l’État ».
L’affaire Dreyfusn’estmême pas
encore achevée.
Onvoit que lapériode estriche engrands épisodes fondateurs.
Repères
– 1795 :
première séparation descultes etde l’État – 1801 :
signature duConcordat, lecatholicisme denouveau religionofficielle – 1882 :
loiFerry surlalaïcité del’école – 1884 :
autorisation dudivorce ; findes prières audébut dessessions parlementaires – 1886 :
loisur laïcisation despersonnels enseignants – 1901 :
loisur lesassociations ; exildelaplupart descongrégations – 1905
(9 décembre) : loide séparation desÉglises etde l’État Une
laïcisation parétapes Cette
séparation n’estpasune première dansnotre histoire.
L’États’était déjàaffranchi detous lescultes plusde
cent ansauparavant, àla fin delaConvention puissous leDirectoire, àl’époque delaRévolution.
Bonapartey
avait misfinensignant aveclepape lefameux Concordat de1801, suividetextes organisant lesdeux autres cultes
minoritaires, protestantetisraélite, etfaisant delareligion catholique etdes deux autres desinstitutions
publiques, dontleclergé étaitpayé parl’État, etl’organisation maintenuesoussasurveillance.
C’estcesystème concordataire que
lanouvelle loijette àbas, enleremplaçant parunautre quirepose surdeux principes,
énoncés danssesdeux premiers paragraphes : « Article 1 :laRépublique assurelaliberté deconscience.
Elle
garantit lelibre exercice descultes.
[…]Article 2 : laRépublique nereconnaît, nesalarie, nine subventionne aucun
culte… » Lalaïcité àla française étaitnée.Plusd’un siècle plustard, ellefonctionne encoresurcette basequi
semble désormais acceptéepartous.
Il n’a pas étésimple, pourtant, d’enarriver là.Lelent combat del’État pours’émanciper delatutelle delareligion
a été progressif.
Lepays amis plus d’un siècle àfranchir peuàpeu cequ’un desgrands spécialistes delaquestion,
l’historien JeanBaubérot, aappelé les« seuils delaïcité ».
LaRévolution, enretirant auxcurés lagestion des
registres denaissance etde décès, alaïcisé l’étatcivil.LaIIIe
République reprendlemouvement, pasàpas : le
divorce, permissouslaRévolution puisinterdit sousLouis XVIII, estautorisé ànouveau ; lescimetières sont
laïcisés ; leshôpitaux, alorsencore emplisdefrères etde religieuses, lesont aussi ; onlève l’interdiction de
travailler ledimanche, commelaprière quijusque-là ouvraitlessessions duParlement.
Unemarche énorme est
escaladée lorsquel’Étatretire àl’Église undeses domaines deprédilection : l’enseignement.
Danslesannées
1880, lesgrands textesimpulsés parJules Ferry etses successeurs prévoientquel’instruction primairesera
obligatoire etgratuite.
Ilsprévoient aussiqu’elle sera« laïque ».
Oncommence parrendre neutres leslocaux –
retrait descrucifix dessalles declasse –,puis lesprogrammes –le catéchisme estremplacé par« l’instruction
morale etcivique ».
Onpasse (en1886) àla « laïcisation despersonnels », autrepairedemanches : celarevient en
effet àchasser desécoles lesmilliers defrères etde religieuses quiytravaillaient.
Nombred’entreeuxchoisissent
carrément dequitter laFrance, cettemauvaise mère.Ducôté catholique, l’épisodeestvécu comme une
« persécution ».
Car tout sepasse, évidemment, dansunclimat politique degrande tension.
Lebras defer entre Église etÉtat a
commencé, ons’en souvient, souslaRévolution.
Ilreprend deplus belle.
En1877, dansundiscours fameux,
Gambetta afixé laligne quisera celle detous lesrépublicains : « Lecléricalisme voilàl’ennemi ! » Stricto
sensu ,
le propos pourrait êtreacceptable partout lemonde : ilne s’agit pasdecombattre la religion ,
mais le cléricalisme ,
c’est-à-dire saprétention àvouloir régenter lechamp politique.
Dans laréalité, beaucoup l’entendent autrement.Aveclalutte anticléricale, denombreux républicains rêventd’en.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Est-on innocent parce qu'on ne sait pas ?
- Suffit-il d’avoir bonne conscience pour être innocent ?
- DERNIÈRE HEURE D'INNOCENT III (La) (résumé & analyse) d’Heinrich Federer
- INNOCENT (L’). Philippe Hériat (résumé)
- FORÇAT INNOCENT (Le). Jules Supervielle (résumé)