HEGEL (Friedrich Wilhelm)
Publié le 02/04/2015
Extrait du document
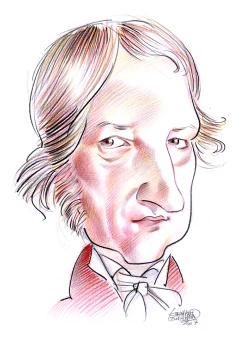
HEGEL (Friedrich Wilhelm) ________________________________________
Né à Stuttgart en 1770, fils d'un petit fonctionnaire, il fit de bonnes études au lycée de sa ville natale ; à dix-huit ans il entre au séminaire de Tübingen où il a Schelling et Hülderlin pour condisciples. En
1793, ses études achevées, il prend un poste de précepteur à Berne puis à Francfort où il compose ses premiers écrits (rassemblés par
Nohl sous le titre Écrits théologiques de jeunesse). En 1801, il
soutient à Iéna une thèse sur les trajectoires des planètes ; en 1804, il publie Foi et savoir, analyse des philosophies de Fichte et de
Schelling ; en 1806, paraît la Phénoménologie de l'esprit. En 1809, il devient directeur du lycée de Nuremberg où il enseigne également la
philosophie (ses notes de cours composent la Propédeutique philoso‑
phique) ; c'est également à Nuremberg qu'il rédige La Science de la logique, 1812-1816. En 1816, il devient professeur à l'université de
Hèidelberg ; il rédige à cette occasion l'exposé le plus systématique de
sa pensée, le Précis de l'encyclopédie des sciences philosophiques. Professeur titulaire à l'université de Berlin en 1817, il est célèbre et
son enseignement a un immense rayonnement ; il rédige à cette occasion des cours sur le droit (publiés en 1821 sous le titre Principes de la philosophie du droit), l'Esthétique, la Philosophie de la religion, la Philosophie de l'histoire qui seront publiées après sa mort, survenue en 1831 à la suite d'une épidémie.
1. Pour la plupart des philosophies, la connaissance consiste en un certain nombre d'idées que l'homme possède et qu'il manifeste aux autres hommes par un certain discours portant sur la réalité externe, et dont les propositions sont susceptibles d'être vraies ou fausses suivant leur forme intrinsèque et leur rapport à la réalité. Se pose alors le problème de savoir par quel miracle s'effectue la correspondance de la pensée et de l'Être. La solution hégélienne consiste à refuser la situation imposée par la reconnaissance d'une hétérogénéité originelle : le savoir, le discours qui l'exprime, et le monde lui-même ne sont que le développement de l'Idée ; tout est donné dans la diversité comme le déploiement de l'Absolu et du Vrai. L'originalité de la pensée hégélienne réside dans ce point de vue qui consiste à
considérer le vrai et l'absolu non comme Substance, mais comme Sujet, et cette originalité est donnée par Hegel comme équivalente à son idéalisme : « Que le vrai soit effectivement réel seulement comme système, ou que la substance soit essentiellement sujet, cela est exprimé dans la représentation qui énonce l'Absolu comme Esprit — le concept le plus elevé appartenant au temps moderne et à sa religion «. Il en résulte que la philosophie doit prendre pour sujet l'Absolu et l'Absolu seulement : dans la préface de la Phénoménologie de l'esprit, Hegel exprimait cette nécessité en soutenant qu'à la philosophie appartient un type de proposition particulier, la proposition spéculative.
2. Si l'Absolu est sujet des propositions de la science spéculative ou philosophie, comme alors rien n'est hors de lui, il s'ensuit :
1 — que le sujet de chaque proposition est identique à son prédicat (et au sujet de toute proposition) ;
2 — que le sujet de chaque proposition est par conséquent différent de soi ;
3 — si le sujet est différent de soi parce qu'il est identique à son prédicat, en ce sens le prédicat diffère aussi de soi puisqu'il est identique à son sujet ; ce que la pro osition affirme, c'est donc l'identité de l'identité et de la différence, c'est-à-dire encore une fois le sujet.
La conception hégélienne de la dialectique découle du projet fondamental de considérer l'Absolu comme sujet. Il est alors clair que ce qui est identique doit apparaître dans la contradiction ; et que ce qui est en contradiction doit apparaître dans l'identité. Mais cela ne suffit pas encore pour comprendre ce que Hegel entend par « développement de la notion «. Prenons en effet une proposition qui exprime l'identité de termes contradictoires, par exemple la proposition « l'Etre et le néant sont une seule et meure chose « ; « en réalité une détermination spéculative ne peut s'exprimer dans une semblable proposition ; il faut appréhender l'unité dans la différence en même temps existante et posée. « Il s'ensuit que l'unité (l'identité) des déterminations contraires est elle-même une détermination : « Devenir est le résultat véritable de l'Etre et du néant en tant que leur unité, ce n'est pas seulement l'unité de l'Être et du néant « (1). Autrement dit, ce qui est, n'est pas l'unité abstraite de l'identité et de la différence, mais ce qui est, c'est l'Idée, le Sujet, l'Absolu, qui se développe et s'oppose à soi et dont le savoir de soi n'est lui-même qu'un moment et une détermi-nation/destination (2) : « Puisque le concept est le Soi propre de l'objet qui se présente comme son devenir, le Soi n'est pas un sujet au repos comportant passivement les accidents, mais il est le concept se mouvant soi-même et reprenant en soi-même ses déterminations. « Ce qui est, c'est donc le mouvement de l'Idée et l'Idée comme mouvement : ainsi c'est l'Idée elle-même qui se développe comme Logique,
lorsqu'elle est simplement en soi, comme Nature lorsqu'elle se pose hors de soi (3) et comme Esprit lorsqu'elle retourne en soi. La science philosophique se présente comme système de ces déterminations/destinations successives, et elle est elle-même une détermination/destination de l'Idée, comme savoir de soi de l'Idée.
3. L'Idée apparaît comme Logique, soi, Nature, différence d'avec soi, et comme Esprit, retour du soi à soi, c'est-à-dire identité de l'identité et de la différence. Le mouvement par lequel l'Idée rentre en soi est triple. L'esprit est :
1 — esprit subjectif c'est-à-dire esprit étant simplement en soi comme vérité de la nature ; mais lorsqu'apparaît la volonté libre qui a pour destination/détermination de réaliser sa notion dans le monde extérieur, l'esprit devient
2 — l'esprit objectif ; c'est le monde du droit qui s'achève dans cette réconciliation de l'universel et de l'individuel qu'est l'Etat, auquel ne manque que la conscience de soi, qui est
3 — l'esprit absolu, comme retour à soi de l'Esprit.
Ainsi la notion de l'Esprit a sa réalité dans l'Esprit : la notion est identique à sa réalité comme savoir de l'Idée absolue. Mais là encore la réalisation de la notion demande des médiations. La conscience de soi de l'Esprit peut revêtir différentes formes : ce peut-être l'immédiateté de la détermination dans la sensibilité, puis la négation de cette immédiateté lorsque la forme et le contenu du savoir diffèrent dans la représentation, et enfin la négation de cette négation comme identité des différences. Dans l'art, l'esprit est immédiatement saisi dans la particularité (de l'oeuvre d'art) ; dans la religion, il apparaît dans la singularité d'une existence extérieure (le Dieu existant) ; dans la philosophie, il atteint véritablement l'universalité du retour à soi. On remarquera que ces trois moments, comme auto-détermination de l'Esprit, sont au même titre dans la sphère de la conscience de soi ; il en résulte nécessairement que la conscience de soi qu'à l'esprit dans l'art, dans la religion et dans la philosophie est un savoir de soi, et que les trois formes sont au meme titre des savoirs : la croyance religieuse ne s'oppose pas au savoir, c'est au contraire un savoir, une forme particulière de savoir.
La dialectique hégélienne prise souvent pour l'ensemble du développement de l'Idée, est parfois prise par l'auteur lui-même pour l'aspect négatif de ce developpement (cf. Phénoménologie. Préf., p. 18 : « le sérieux, la douleur, la patience et le travail du négatif «) : « le moment dialectique est la mise de côté par elle-même de ces déterminations finies et leur passage à leur contraire « (Encyclopédie. § 87). Mais dans le contexte de l'idéalisme hégélien, cette négativité ne peut subsister seule, si bien que la dialectique en reçoit une définition plus large : « Dans sa détermination parti‑
culière, la dialectique est (...) la nature propre, véritable des déterminations de l'entendement, des choses et du fini en général « (Encyclopédie. § 87). Il en résulte que la dialectique est le mouvement même du concept et n'est pas seulement le moment négatif. « La dialectique supérieure du concept c'est de produire la détermination, non pas comme une pure limite et un contraire, mais d'en tirer et d'en concevoir le contenu positif et le résultat, puisque c'est par là seulement que la dialectique est développement et progrès immanent. « Pour Platon la dialectique était la méthode même par laquelle le philosophe s'élevait jusqu'à la connaissance des idées ; elle conserve ce statut chez Hegel, mais elle est en même temps déploiement de la réalité parce que la réalité est Idée (4).
1.Ce point est exprimé dans la notion de dépassement (Aufhebung): dans le résultat, la contradiction est dépassée, mais elle y subsiste encore comme ce qui a donné lieu à l'unité.
2.Bestimmung : a — détermination, b — destination.
3.Voir aliénation.
4.C'est pourquoi on résume souvent la philosophie hégélienne par la formule de la préface de la Philosophie du droit « Tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel «.
Liens utiles
- PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE OU DROIT, ou Droit naturel et science de l’État en abrégé, Georg Wilhelm Friedrich Hegel
- ENCYCLOPÉDIE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES EN ABRÉGÉ ou PRÉCIS DE L’ENCYCLOPÉDIE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES, Georg Wilhelm Friedrich Hegel
- LEÇONS SUR L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, Georg Wilhelm Friedrich Hegel - résumé de l'oeuvre
- ESTHÉTIQUE, 1832. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
- LEÇONS SUR LA PHILOSOPHIE DE LA RELIGION, 1832. Georg Wilhelm Friedrich Hegel - résumé de l'oeuvre































