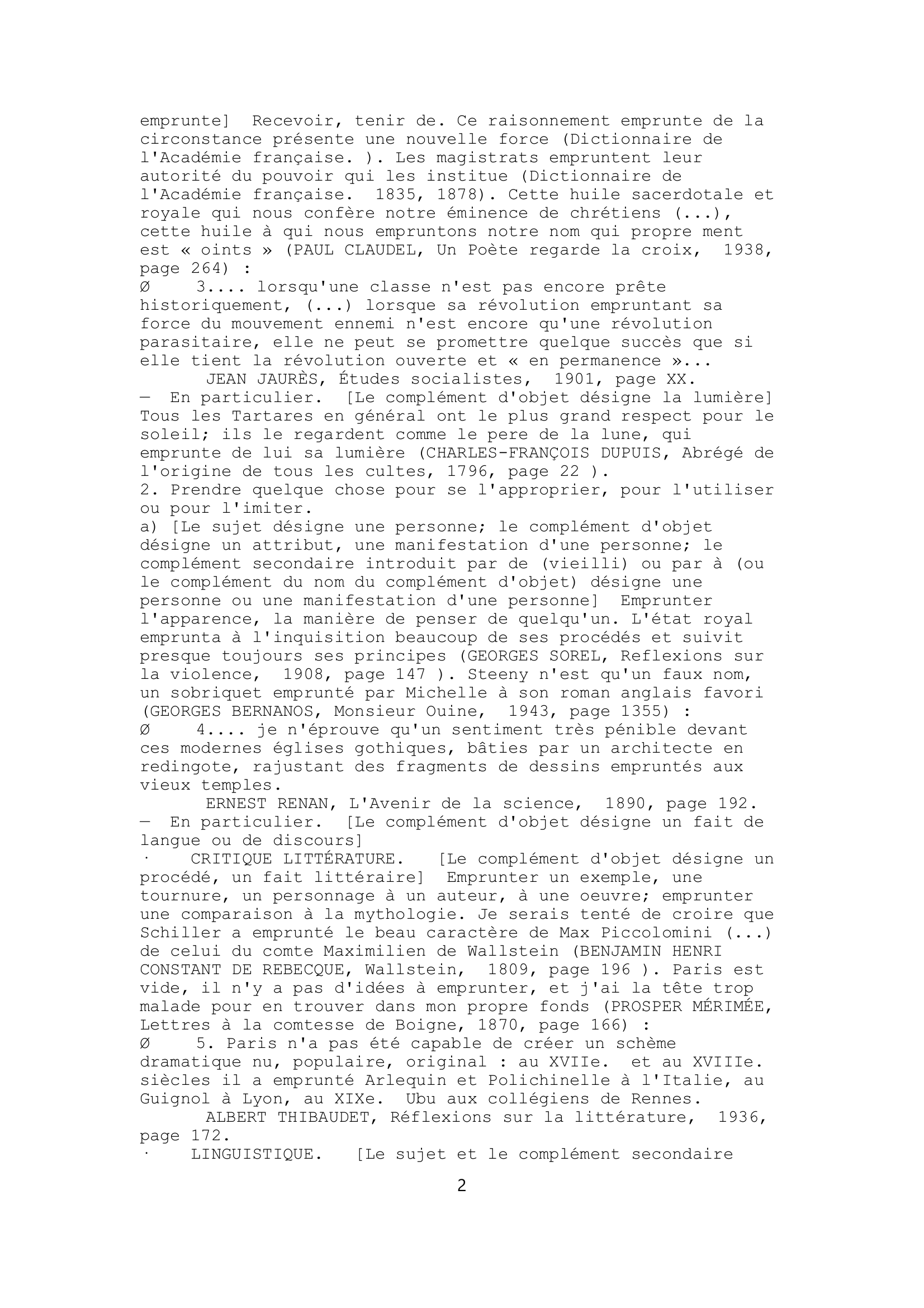Dictionnaire en ligne: EMPRUNTER, verbe transitif.
Publié le 28/01/2016
Extrait du document
«
emprunte] Recevoir, tenir de.
Ce raisonnement emprunte de la
circonstance présente une nouvelle force (Dictionnaire de
l'Académie française.
).
Les magistrats empruntent leur
autorité du pouvoir qui les institue (Dictionnaire de
l'Académie française.
1835, 1878).
Cette huile sacerdotale et
royale qui nous confère notre éminence de chrétiens (...),
cette huile à qui nous empruntons notre nom qui propre ment
est « oints » (PAUL CLAUDEL, Un Poète regarde la croix, 1938,
page 264) :
Ø 3....
lorsqu'une classe n'est pas encore prête
historiquement, (...) lorsque sa révolution empruntant sa
force du mouvement ennemi n'est encore qu'une révolution
parasitaire, elle ne peut se promettre quelque succès que si
elle tient la révolution ouverte et « en permanence »...
JEAN JAURÈS, Études socialistes, 1901, page XX.
— En particulier.
[Le complément d'objet désigne la lumière]
Tous les Tartares en général ont le plus grand respect pour le
soleil; ils le regardent comme le pere de la lune, qui
emprunte de lui sa lumière (CHARLES-FRANÇOIS DUPUIS, Abrégé de
l'origine de tous les cultes, 1796, page 22 ).
2.
Prendre quelque chose pour se l'approprier, pour l'utiliser
ou pour l'imiter.
a) [Le sujet désigne une personne; le complément d'objet
désigne un attribut, une manifestation d'une personne; le
complément secondaire introduit par de (vieilli) ou par à (ou
le complément du nom du complément d'objet) désigne une
personne ou une manifestation d'une personne] Emprunter
l'apparence, la manière de penser de quelqu'un.
L'état royal
emprunta à l'inquisition beaucoup de ses procédés et suivit
presque toujours ses principes (GEORGES SOREL, Reflexions sur
la violence, 1908, page 147 ).
Steeny n'est qu'un faux nom,
un sobriquet emprunté par Michelle à son roman anglais favori
(GEORGES BERNANOS, Monsieur Ouine, 1943, page 1355) :
Ø 4....
je n'éprouve qu'un sentiment très pénible devant
ces modernes églises gothiques, bâties par un architecte en
redingote, rajustant des fragments de dessins empruntés aux
vieux temples.
ERNEST RENAN, L'Avenir de la science, 1890, page 192.
— En particulier.
[Le complément d'objet désigne un fait de
langue ou de discours]
· CRITIQUE LITTÉRATURE.
[Le complément d'objet désigne un
procédé, un fait littéraire] Emprunter un exemple, une
tournure, un personnage à un auteur, à une oeuvre; emprunter
une comparaison à la mythologie.
Je serais tenté de croire que
Schiller a emprunté le beau caractère de Max Piccolomini (...)
de celui du comte Maximilien de Wallstein (BENJAMIN HENRI
CONSTANT DE REBECQUE, Wallstein, 1809, page 196 ).
Paris est
vide, il n'y a pas d'idées à emprunter, et j'ai la tête trop
malade pour en trouver dans mon propre fonds (PROSPER MÉRIMÉE,
Lettres à la comtesse de Boigne, 1870, page 166) :
Ø 5.
Paris n'a pas été capable de créer un schème
dramatique nu, populaire, original : au XVIIe.
et au XVIIIe.
siècles il a emprunté Arlequin et Polichinelle à l'Italie, au
Guignol à Lyon, au XIXe.
Ubu aux collégiens de Rennes.
ALBERT THIBAUDET, Réflexions sur la littérature, 1936,
page 172.
· LINGUISTIQUE.
[Le sujet et le complément secondaire
2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dictionnaire en ligne: ESCARPER1, verbe transitif.
- Dictionnaire en ligne: ESCAMOTER, verbe transitif.
- Dictionnaire en ligne: ESCALADER, verbe transitif.
- Dictionnaire en ligne: ESCAGASSER, verbe transitif.
- Dictionnaire en ligne: ESBROUF(F)ER, (ESBROUFER, ESBROUFFER) verbe transitif.