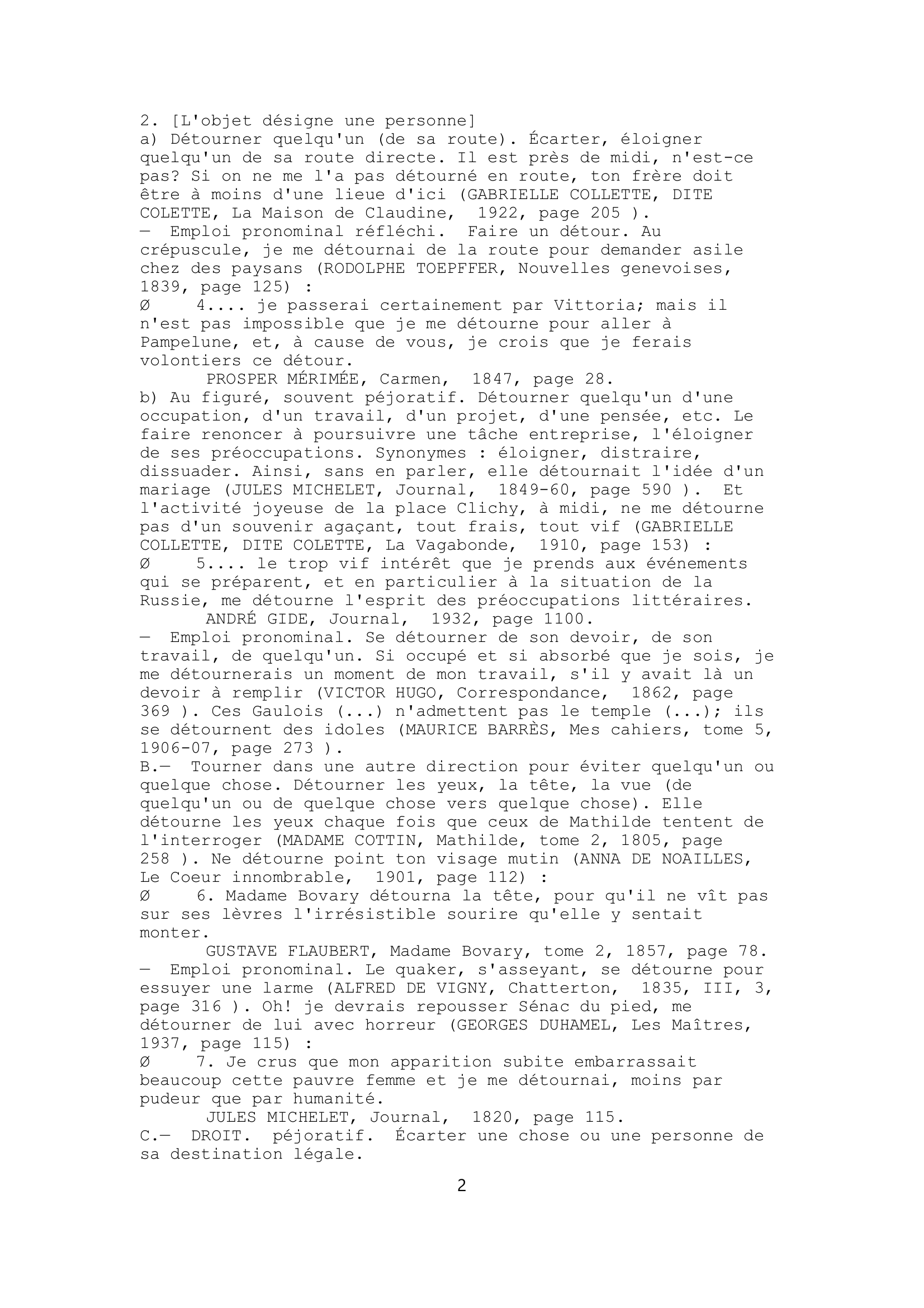Dictionnaire en ligne: DÉTOURNER, verbe transitif.
Publié le 08/01/2016
Extrait du document
«
2.
[L'objet désigne une personne]
a) Détourner quelqu'un (de sa route).
Écarter, éloigner
quelqu'un de sa route directe.
Il est près de midi, n'est-ce
pas? Si on ne me l'a pas détourné en route, ton frère doit
être à moins d'une lieue d'ici (GABRIELLE COLLETTE, DITE
COLETTE, La Maison de Claudine, 1922, page 205 ).
— Emploi pronominal réfléchi.
Faire un détour.
Au
crépuscule, je me détournai de la route pour demander asile
chez des paysans (RODOLPHE TOEPFFER, Nouvelles genevoises,
1839, page 125) :
Ø 4....
je passerai certainement par Vittoria; mais il
n'est pas impossible que je me détourne pour aller à
Pampelune, et, à cause de vous, je crois que je ferais
volontiers ce détour.
PROSPER MÉRIMÉE, Carmen, 1847, page 28.
b) Au figuré, souvent péjoratif.
Détourner quelqu'un d'une
occupation, d'un travail, d'un projet, d'une pensée, etc.
Le
faire renoncer à poursuivre une tâche entreprise, l'éloigner
de ses préoccupations.
Synonymes : éloigner, distraire,
dissuader.
Ainsi, sans en parler, elle détournait l'idée d'un
mariage (JULES MICHELET, Journal, 1849-60, page 590 ).
Et
l'activité joyeuse de la place Clichy, à midi, ne me détourne
pas d'un souvenir agaçant, tout frais, tout vif (GABRIELLE
COLLETTE, DITE COLETTE, La Vagabonde, 1910, page 153) :
Ø 5....
le trop vif intérêt que je prends aux événements
qui se préparent, et en particulier à la situation de la
Russie, me détourne l'esprit des préoccupations littéraires.
ANDRÉ GIDE, Journal, 1932, page 1100.
— Emploi pronominal.
Se détourner de son devoir, de son
travail, de quelqu'un.
Si occupé et si absorbé que je sois, je
me détournerais un moment de mon travail, s'il y avait là un
devoir à remplir (VICTOR HUGO, Correspondance, 1862, page
369 ).
Ces Gaulois (...) n'admettent pas le temple (...); ils
se détournent des idoles (MAURICE BARRÈS, Mes cahiers, tome 5,
1906-07, page 273 ).
B.— Tourner dans une autre direction pour éviter quelqu'un ou
quelque chose.
Détourner les yeux, la tête, la vue (de
quelqu'un ou de quelque chose vers quelque chose).
Elle
détourne les yeux chaque fois que ceux de Mathilde tentent de
l'interroger (MADAME COTTIN, Mathilde, tome 2, 1805, page
258 ).
Ne détourne point ton visage mutin (ANNA DE NOAILLES,
Le Coeur innombrable, 1901, page 112) :
Ø 6.
Madame Bovary détourna la tête, pour qu'il ne vît pas
sur ses lèvres l'irrésistible sourire qu'elle y sentait
monter.
GUSTAVE FLAUBERT, Madame Bovary, tome 2, 1857, page 78.
— Emploi pronominal.
Le quaker, s'asseyant, se détourne pour
essuyer une larme (ALFRED DE VIGNY, Chatterton, 1835, III, 3,
page 316 ).
Oh! je devrais repousser Sénac du pied, me
détourner de lui avec horreur (GEORGES DUHAMEL, Les Maîtres,
1937, page 115) :
Ø 7.
Je crus que mon apparition subite embarrassait
beaucoup cette pauvre femme et je me détournai, moins par
pudeur que par humanité.
JULES MICHELET, Journal, 1820, page 115.
C.— DROIT.
péjoratif.
Écarter une chose ou une personne de
sa destination légale.
2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dictionnaire en ligne: ESCARPER1, verbe transitif.
- Dictionnaire en ligne: ESCAMOTER, verbe transitif.
- Dictionnaire en ligne: ESCALADER, verbe transitif.
- Dictionnaire en ligne: ESCAGASSER, verbe transitif.
- Dictionnaire en ligne: ESBROUF(F)ER, (ESBROUFER, ESBROUFFER) verbe transitif.