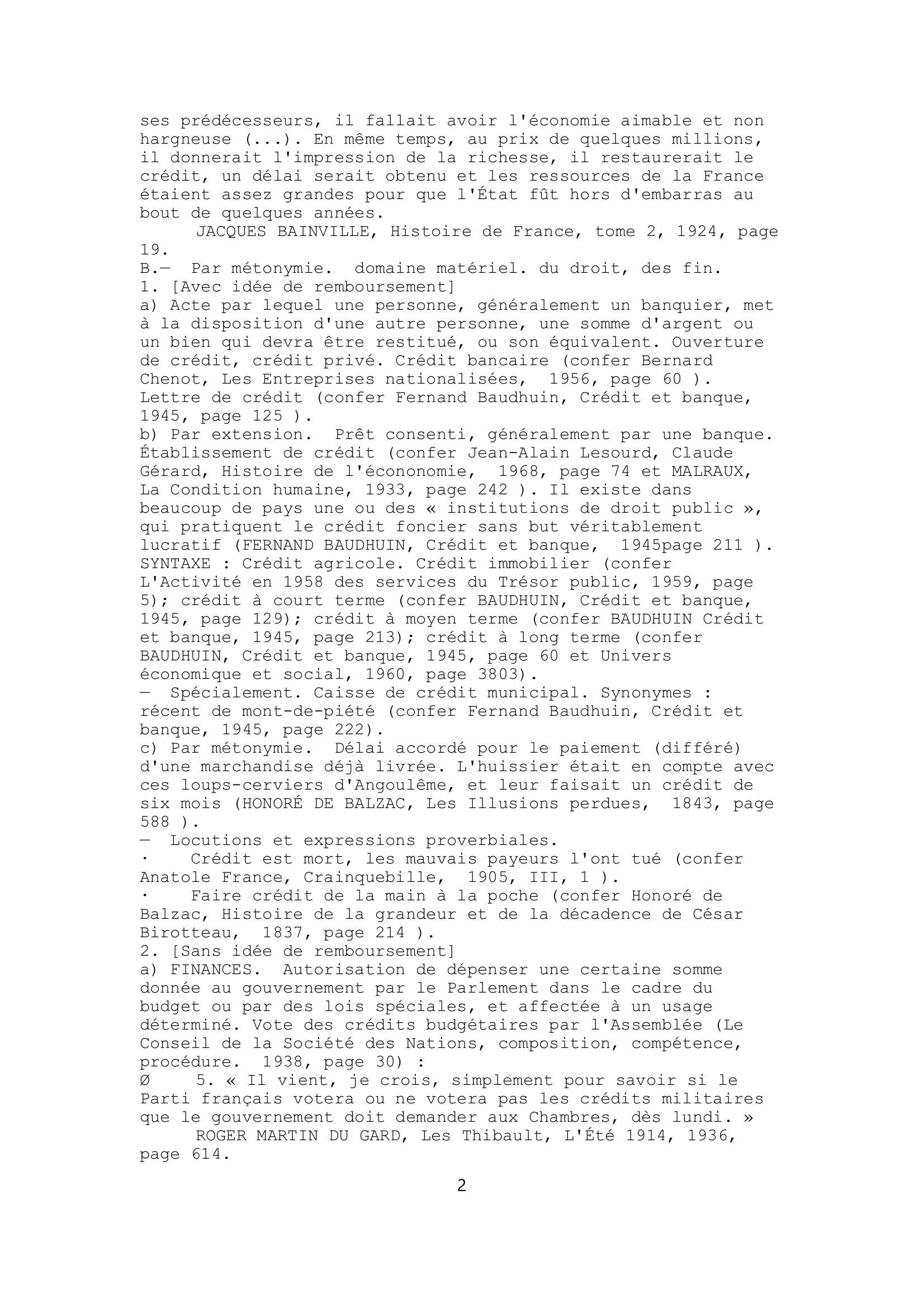Définition du terme: CRÉDIT, substantif masculin.
Publié le 04/12/2015
Extrait du document
«
ses prédécesseurs, il fallait avoir l'économie aimable et non
hargneuse (...).
En même temps, au prix de quelques millions,
il donnerait l'impression de la richesse, il restaurerait le
crédit, un délai serait obtenu et les ressources de la France
étaient assez grandes pour que l'État fût hors d'embarras au
bout de quelques années.
JACQUES BAINVILLE, Histoire de France, tome 2, 1924, page
19.
B.— Par métonymie.
domaine matériel.
du droit, des fin.
1.
[Avec idée de remboursement]
a) Acte par lequel une personne, généralement un banquier, met
à la disposition d'une autre personne, une somme d'argent ou
un bien qui devra être restitué, ou son équivalent.
Ouverture
de crédit, crédit privé.
Crédit bancaire (confer Bernard
Chenot, Les Entreprises nationalisées, 1956, page 60 ).
Lettre de crédit (confer Fernand Baudhuin, Crédit et banque,
1945, page 125 ).
b) Par extension.
Prêt consenti, généralement par une banque.
Établissement de crédit (confer Jean-Alain Lesourd, Claude
Gérard, Histoire de l'écononomie, 1968, page 74 et MALRAUX,
La Condition humaine, 1933, page 242 ).
Il existe dans
beaucoup de pays une ou des « institutions de droit public »,
qui pratiquent le crédit foncier sans but véritablement
lucratif (FERNAND BAUDHUIN, Crédit et banque, 1945page 211 ).
SYNTAXE : Crédit agricole.
Crédit immobilier (confer
L'Activité en 1958 des services du Trésor public, 1959, page
5); crédit à court terme (confer BAUDHUIN, Crédit et banque,
1945, page 129); crédit à moyen terme (confer BAUDHUIN Crédit
et banque, 1945, page 213); crédit à long terme (confer
BAUDHUIN, Crédit et banque, 1945, page 60 et Univers
économique et social, 1960, page 3803).
— Spécialement.
Caisse de crédit municipal.
Synonymes :
récent de mont-de-piété (confer Fernand Baudhuin, Crédit et
banque, 1945, page 222).
c) Par métonymie.
Délai accordé pour le paiement (différé)
d'une marchandise déjà livrée.
L'huissier était en compte avec
ces loups-cerviers d'Angoulême, et leur faisait un crédit de
six mois (HONORÉ DE BALZAC, Les Illusions perdues, 1843, page
588 ).
— Locutions et expressions proverbiales.
· Crédit est mort, les mauvais payeurs l'ont tué (confer
Anatole France, Crainquebille, 1905, III, 1 ).
· Faire crédit de la main à la poche (confer Honoré de
Balzac, Histoire de la grandeur et de la décadence de César
Birotteau, 1837, page 214 ).
2.
[Sans idée de remboursement]
a) FINANCES.
Autorisation de dépenser une certaine somme
donnée au gouvernement par le Parlement dans le cadre du
budget ou par des lois spéciales, et affectée à un usage
déterminé.
Vote des crédits budgétaires par l'Assemblée (Le
Conseil de la Société des Nations, composition, compétence,
procédure.
1938, page 30) :
Ø 5.
« Il vient, je crois, simplement pour savoir si le
Parti français votera ou ne votera pas les crédits militaires
que le gouvernement doit demander aux Chambres, dès lundi.
»
ROGER MARTIN DU GARD, Les Thibault, L'Été 1914, 1936,
page 614.
2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Définition du terme: CYPRIPÈDE, CYPRIPEDIUM, substantif masculin.
- Définition du terme: CYPRIN, substantif masculin.
- Définition du terme: CYPRÈS, substantif masculin.
- Définition du terme: CYNOR(R)HODON, (CYNORHODON, CYNORRHODON) substantif masculin.
- Définition du terme: cynodonte extrait de l'article "CYN(O)-, (CYN-, CYNO-)" cynodonte (grec « dent »), substantif masculin , PALÉONTOLOGIE.