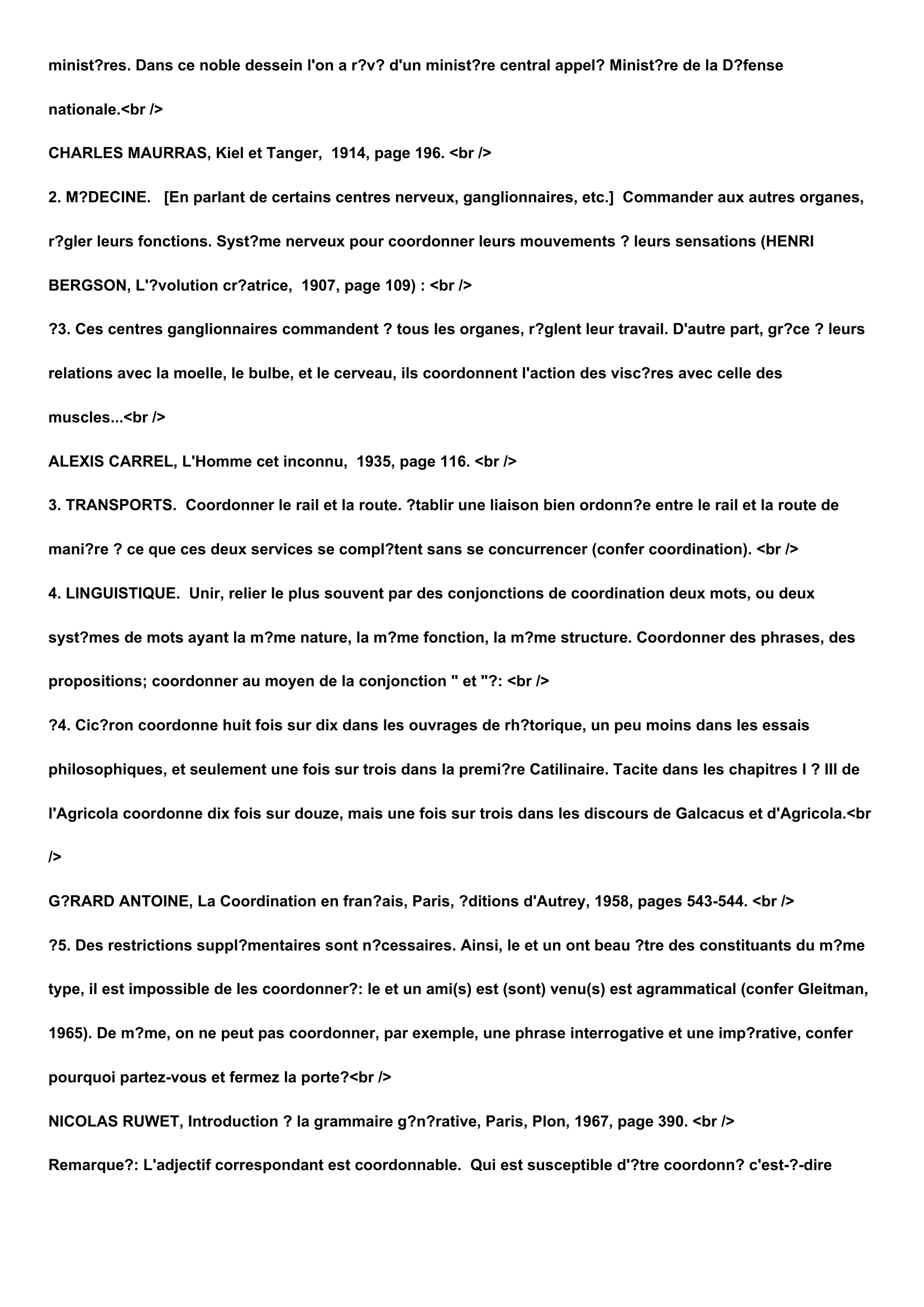Définition du terme: COORDONNER, verbe transitif.
Publié le 19/11/2015
Extrait du document
«
minist?res.
Dans ce noble dessein l'on a r?v? d'un minist?re central appel? Minist?re de la D?fense
nationale.
CHARLES MAURRAS, Kiel et Tanger, 1914, page 196.
2.
M?DECINE.
[En parlant de certains centres nerveux, ganglionnaires, etc.] Commander aux autres organes,
r?gler leurs fonctions.
Syst?me nerveux pour coordonner leurs mouvements ? leurs sensations (HENRI
BERGSON, L'?volution cr?atrice, 1907, page 109) :
? 3.
Ces centres ganglionnaires commandent ? tous les organes, r?glent leur travail.
D'autre part, gr?ce ? leurs
relations avec la moelle, le bulbe, et le cerveau, ils coordonnent l'action des visc?res avec celle des
muscles...
ALEXIS CARREL, L'Homme cet inconnu, 1935, page 116.
3.
TRANSPORTS.
Coordonner le rail et la route.
?tablir une liaison bien ordonn?e entre le rail et la route de
mani?re ? ce que ces deux services se compl?tent sans se concurrencer (confer coordination).
4.
LINGUISTIQUE.
Unir, relier le plus souvent par des conjonctions de coordination deux mots, ou deux
syst?mes de mots ayant la m?me nature, la m?me fonction, la m?me structure.
Coordonner des phrases, des
propositions; coordonner au moyen de la conjonction " et "?:
? 4.
Cic?ron coordonne huit fois sur dix dans les ouvrages de rh?torique, un peu moins dans les essais
philosophiques, et seulement une fois sur trois dans la premi?re Catilinaire.
Tacite dans les chapitres I ? III de
l'Agricola coordonne dix fois sur douze, mais une fois sur trois dans les discours de Galcacus et d'Agricola.
G?RARD ANTOINE, La Coordination en fran?ais, Paris, ?ditions d'Autrey, 1958, pages 543-544.
? 5.
Des restrictions suppl?mentaires sont n?cessaires.
Ainsi, le et un ont beau ?tre des constituants du m?me
type, il est impossible de les coordonner?: le et un ami(s) est (sont) venu(s) est agrammatical (confer Gleitman,
1965).
De m?me, on ne peut pas coordonner, par exemple, une phrase interrogative et une imp?rative, confer
pourquoi partez-vous et fermez la porte?
NICOLAS RUWET, Introduction ? la grammaire g?n?rative, Paris, Plon, 1967, page 390.
Remarque?: L'adjectif correspondant est coordonnable.
Qui est susceptible d'?tre coordonn? c'est-?-dire.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Définition du terme: CYLINDRER, verbe transitif.
- Définition du terme: CYCLISER, verbe transitif.
- Définition du terme: DANDINER, verbe transitif.
- Définition du terme: DAMNER, verbe transitif.
- Définition du terme: DAMER2, verbe transitif.