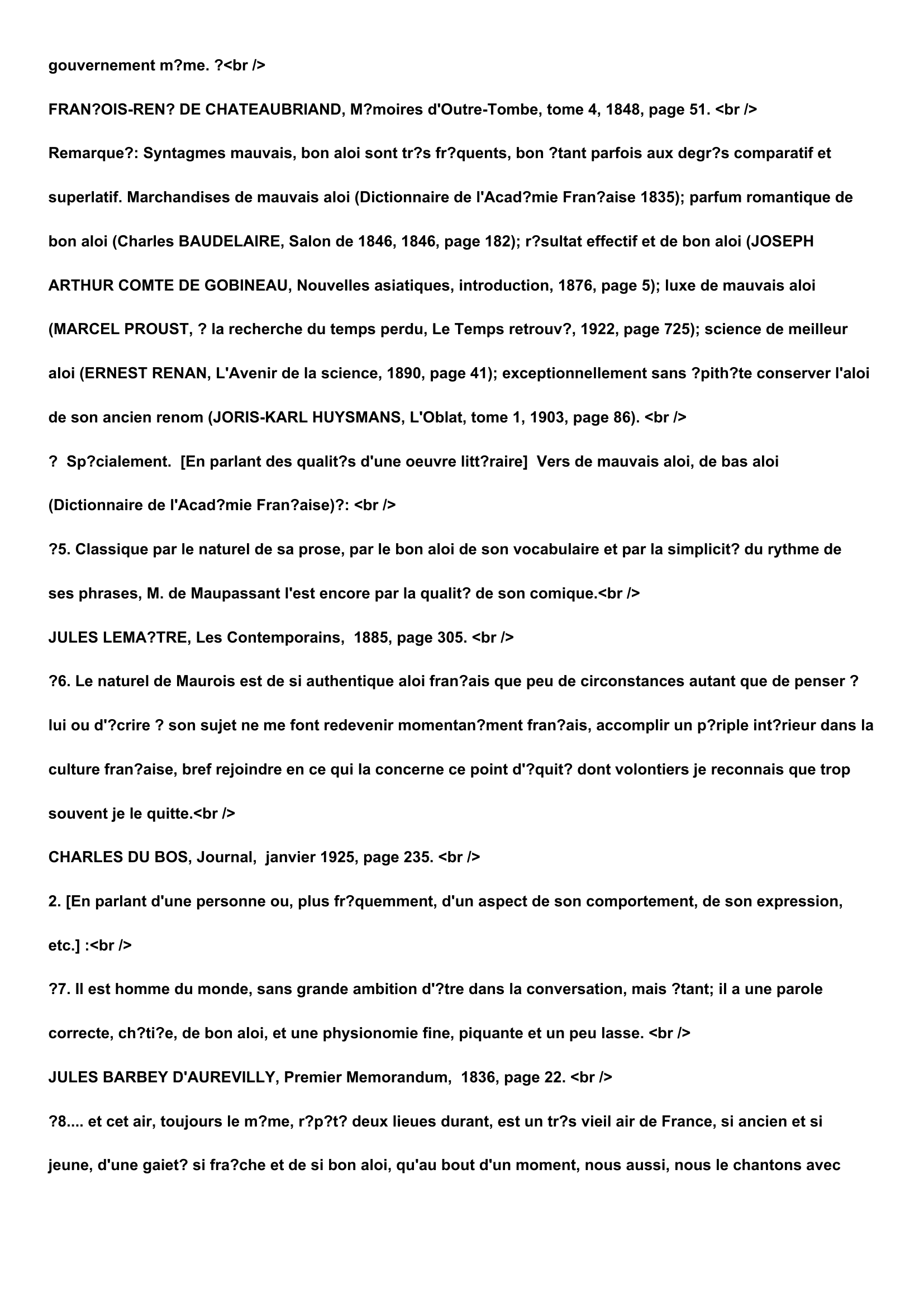Définition du mot: ALOI, substantif masculin.
Publié le 21/10/2015
Extrait du document
«
gouvernement m?me.
?
FRAN?OIS-REN? DE CHATEAUBRIAND, M?moires d'Outre-Tombe, tome 4, 1848, page 51.
Remarque?: Syntagmes mauvais, bon aloi sont tr?s fr?quents, bon ?tant parfois aux degr?s comparatif et
superlatif.
Marchandises de mauvais aloi (Dictionnaire de l'Acad?mie Fran?aise 1835); parfum romantique de
bon aloi (Charles BAUDELAIRE, Salon de 1846, 1846, page 182); r?sultat effectif et de bon aloi (JOSEPH
ARTHUR COMTE DE GOBINEAU, Nouvelles asiatiques, introduction, 1876, page 5); luxe de mauvais aloi
(MARCEL PROUST, ? la recherche du temps perdu, Le Temps retrouv?, 1922, page 725); science de meilleur
aloi (ERNEST RENAN, L'Avenir de la science, 1890, page 41); exceptionnellement sans ?pith?te conserver l'aloi
de son ancien renom (JORIS-KARL HUYSMANS, L'Oblat, tome 1, 1903, page 86).
? Sp?cialement.
[En parlant des qualit?s d'une oeuvre litt?raire] Vers de mauvais aloi, de bas aloi
(Dictionnaire de l'Acad?mie Fran?aise)?:
? 5.
Classique par le naturel de sa prose, par le bon aloi de son vocabulaire et par la simplicit? du rythme de
ses phrases, M.
de Maupassant l'est encore par la qualit? de son comique.
JULES LEMA?TRE, Les Contemporains, 1885, page 305.
? 6.
Le naturel de Maurois est de si authentique aloi fran?ais que peu de circonstances autant que de penser ?
lui ou d'?crire ? son sujet ne me font redevenir momentan?ment fran?ais, accomplir un p?riple int?rieur dans la
culture fran?aise, bref rejoindre en ce qui la concerne ce point d'?quit? dont volontiers je reconnais que trop
souvent je le quitte.
CHARLES DU BOS, Journal, janvier 1925, page 235.
2.
[En parlant d'une personne ou, plus fr?quemment, d'un aspect de son comportement, de son expression,
etc.] :
? 7.
Il est homme du monde, sans grande ambition d'?tre dans la conversation, mais ?tant; il a une parole
correcte, ch?ti?e, de bon aloi, et une physionomie fine, piquante et un peu lasse.
JULES BARBEY D'AUREVILLY, Premier Memorandum, 1836, page 22.
? 8....
et cet air, toujours le m?me, r?p?t? deux lieues durant, est un tr?s vieil air de France, si ancien et si
jeune, d'une gaiet? si fra?che et de si bon aloi, qu'au bout d'un moment, nous aussi, nous le chantons avec.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Définition: FA, substantif masculin.
- Définition: FABLIAU, FABLIAUX, substantif masculin.
- Définition: FABLIER, substantif masculin.
- Définition: FABRICIEN, substantif masculin.
- Définition: FABULISTE, substantif masculin.