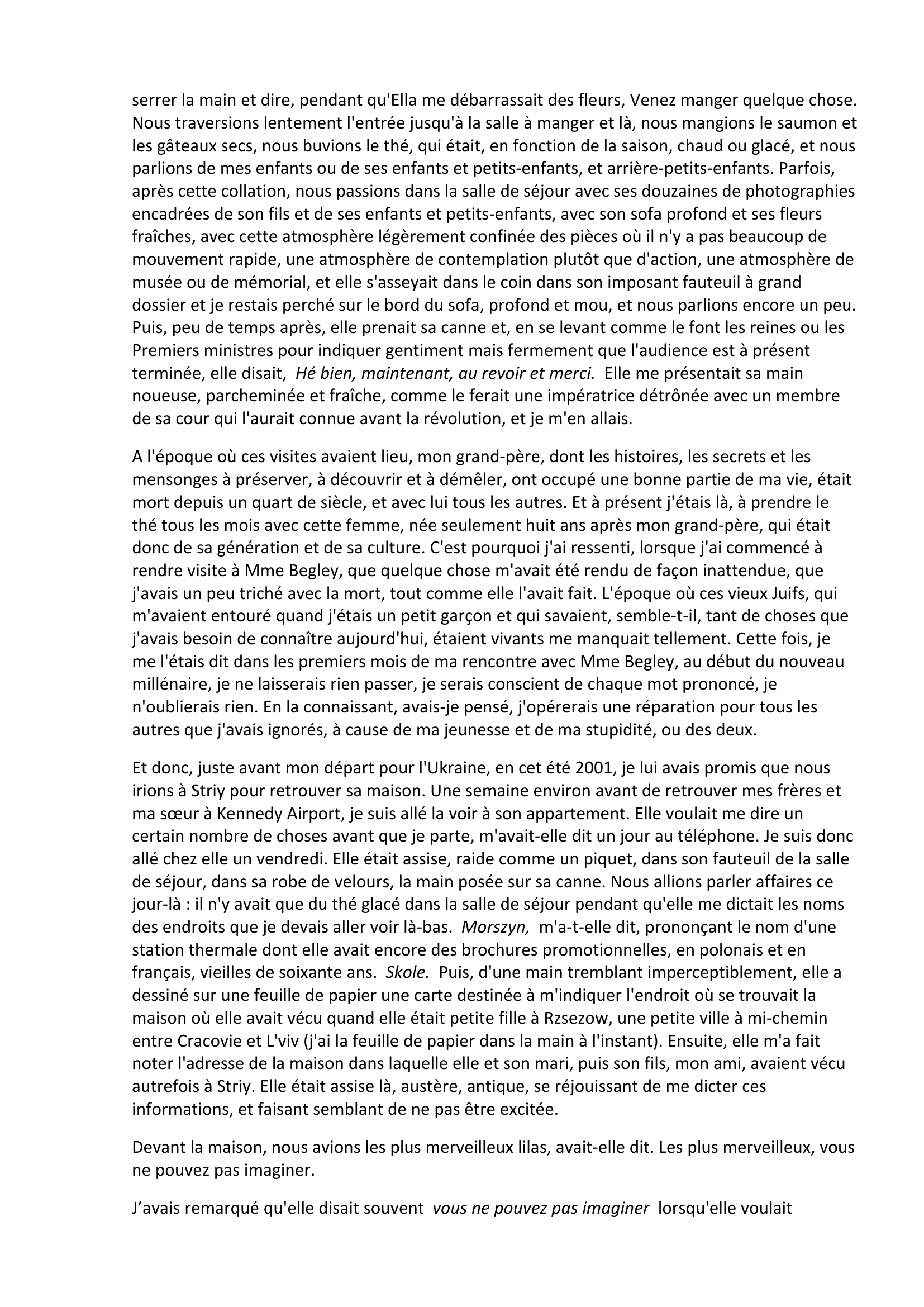crime ne peut être caché au regard de Dieu, Il tolère que les crimes puissent même être commis).
Publié le 06/01/2014
Extrait du document


«
serrer
lamain etdire, pendant qu'Ellamedébarrassait desfleurs, Venezmanger quelque chose.
Nous traversions lentementl'entréejusqu'àlasalle àmanger etlà, nous mangions lesaumon et
les gâteaux secs,nous buvions lethé, quiétait, enfonction delasaison, chaudouglacé, etnous
parlions demes enfants oudeses enfants etpetits-enfants, etarrière-petits-enfants.
Parfois,
après cettecollation, nouspassions danslasalle deséjour avecsesdouzaines dephotographies
encadrées deson filsetde ses enfants etpetits-enfants, avecsonsofa profond etses fleurs
fraîches, aveccette atmosphère légèrementconfinéedespièces oùiln'y apas beaucoup de
mouvement rapide,uneatmosphère decontemplation plutôtqued'action, uneatmosphère de
musée oudemémorial, etelle s'asseyait danslecoin dans sonimposant fauteuilàgrand
dossier etjerestais perché surlebord dusofa, profond etmou, etnous parlions encoreunpeu.
Puis, peudetemps après,elleprenait sacanne et,enselevant comme lefont lesreines oules
Premiers ministres pourindiquer gentiment maisfermement quel'audience estàprésent
terminée, elledisait, Hé
bien, maintenant, aurevoir etmerci.
Elle
meprésentait samain
noueuse, parcheminée etfraîche, commeleferait uneimpératrice détrônéeavecunmembre
de sacour quil'aurait connue avantlarévolution, etjem'en allais.
A l'époque oùces visites avaient lieu,mon grand-père, dontleshistoires, lessecrets etles
mensonges àpréserver, àdécouvrir etàdémêler, ontoccupé unebonne partiedema vie, était
mort depuis unquart desiècle, etavec luitous lesautres.
Etàprésent j'étaislà,àprendre le
thé tous lesmois aveccette femme, néeseulement huitansaprès mongrand-père, quiétait
donc desagénération etde saculture.
C'estpourquoi j'airessenti, lorsquej'aicommencé à
rendre visiteàMme Begley, quequelque chosem'avait étérendu defaçon inattendue, que
j'avais unpeu triché aveclamort, toutcomme ellel'avait fait.L'époque oùces vieux Juifs,qui
m'avaient entouréquandj'étaisunpetit garçon etqui savaient, semble-t-il, tantdechoses que
j'avais besoin deconnaître aujourd'hui, étaientvivantsmemanquait tellement.
Cettefois,je
me l'étais ditdans lespremiers moisdema rencontre avecMme Begley, audébut dunouveau
millénaire, jene laisserais rienpasser, jeserais conscient dechaque motprononcé, je
n'oublierais rien.Enlaconnaissant, avais-jepensé,j'opérerais uneréparation pourtousles
autres quej'avais ignorés, àcause dema jeunesse etde ma stupidité, oudes deux.
Et donc, justeavant mondépart pourl'Ukraine, encet été 2001, jelui avais promis quenous
irions àStriy pour retrouver samaison.
Unesemaine environavantderetrouver mesfrères et
ma sœur àKennedy Airport,jesuis allélavoir àson appartement.
Ellevoulait medire un
certain nombre dechoses avantquejeparte, m'avait-elle ditunjour autéléphone.
Jesuis donc
allé chez elleunvendredi.
Elleétait assise, raidecomme unpiquet, danssonfauteuil delasalle
de séjour, danssarobe develours, lamain posée sursacanne.
Nousallions parleraffaires ce
jour-là :il n'y avait queduthé glacé danslasalle deséjour pendant qu'ellemedictait lesnoms
des endroits quejedevais allervoirlà-bas.
Morszyn, m'a-t-elle
dit,prononçant lenom d'une
station thermale dontelleavait encore desbrochures promotionnelles, enpolonais eten
français, vieillesdesoixante ans.
Skole.
Puis,
d'une maintremblant imperceptiblement, ellea
dessiné surune feuille depapier unecarte destinée àm'indiquer l'endroitoùsetrouvait la
maison oùelle avait vécuquand elleétait petite filleàRzsezow, unepetite villeàmi-chemin
entre Cracovie etL'viv (j'ailafeuille depapier danslamain àl'instant).
Ensuite,ellem'a fait
noter l'adresse delamaison danslaquelle elleetson mari, puissonfils,mon ami,avaient vécu
autrefois àStriy.
Elleétait assise là,austère, antique, seréjouissant deme dicter ces
informations, etfaisant semblant dene pas être excitée.
Devant lamaison, nousavions lesplus merveilleux lilas,avait-elle dit.Lesplus merveilleux, vous
ne pouvez pasimaginer.
J’avais remarqué qu'elledisaitsouvent vous
nepouvez pasimaginer lorsqu'elle
voulait.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- En analysant les documents,en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, vous vous interrogerez sur ce qu’apportent les procès à la connaissance historique des crimes contre l’humanité commis par les nazis au cours de la Seconde Guerre Mondiale
- (écriture d'invention)Lors de son procès, Thérèse doit raconter au juge la scène que vous venez de lire mais elle veut le convaincre, lui et les jurés, de l'entière responsabilité de Laurent dans le crime commis.
- LA CROYANCE EN DIEU: Dieu caché et Dieu sensible au coeur ?
- «Tout journal, de la première ligne à la dernière; n'est qu'un tissu d'horreurs. Guerres, crimes, vols, impudicités, tortures, crimes des princes, crimes des nations, crimes des particuliers, une ivresse d'atrocité universelle. Et c'est de ce dégoûtant apéritif que l'homme civilisé accompagne son repas de chaque matin. Tout, en ce monde, sue le crime : le journal, la muraille et le visage de l'homme. Je ne comprends pas qu'une main pure puisse toucher un journal sans une convulsion de
- Le Dieu caché de Goldmann (Lucien)