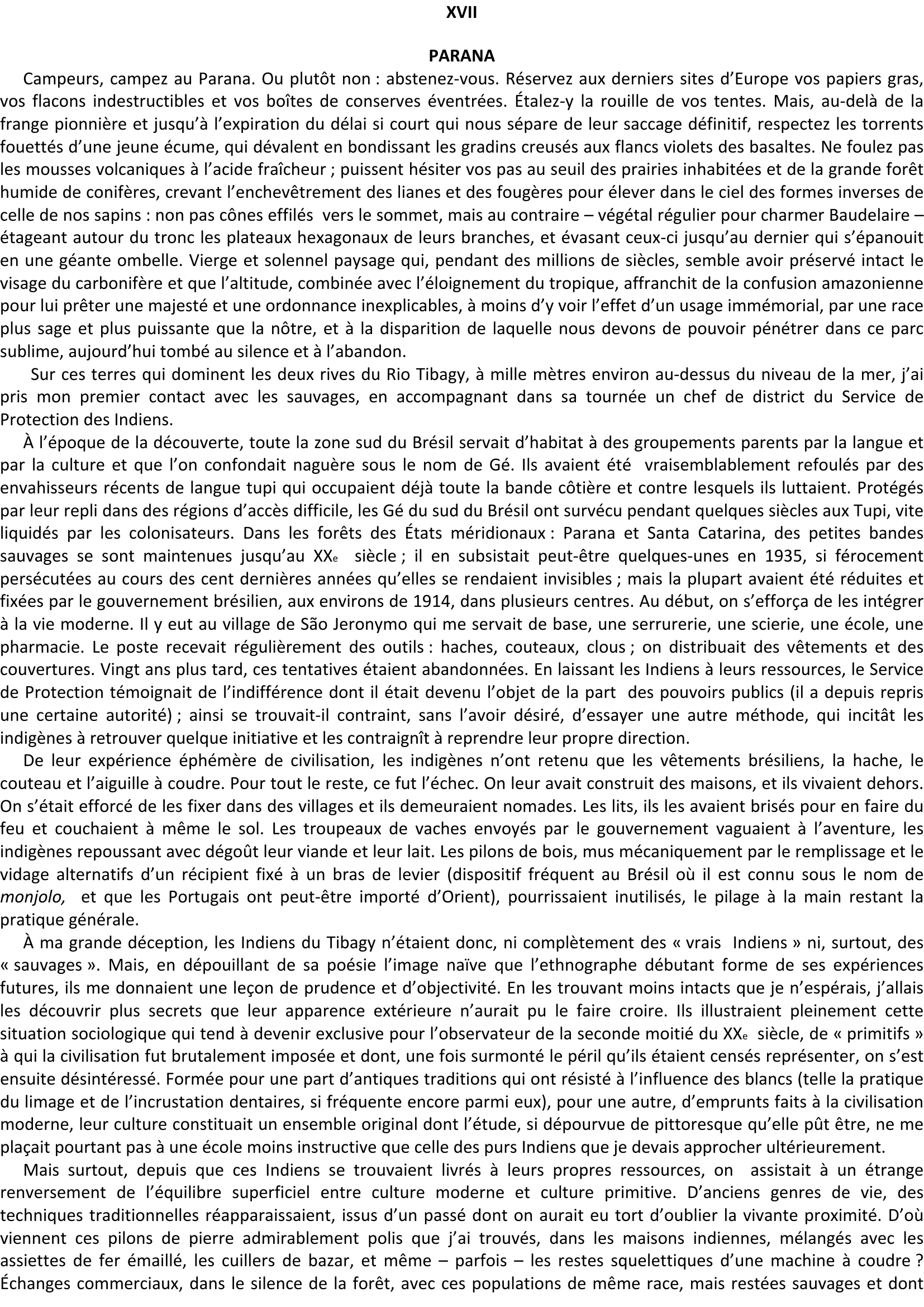CINQUIÈME PARTIE CADUVEO XVII PARANA Campeurs, campez au Parana.
Publié le 06/01/2014
Extrait du document
«
XVII
PARANA Campeurs,
campezauParana.
Ouplutôt non :abstenez-vous.
Réservezauxderniers sitesd’Europe vospapiers gras,
vos flacons indestructibles etvos boîtes deconserves éventrées.
Étalez-ylarouille devos tentes.
Mais,au-delà dela
frange pionnière etjusqu’à l’expiration dudélai sicourt quinous sépare deleur saccage définitif, respectez lestorrents
fouettés d’unejeuneécume, quidévalent enbondissant lesgradins creusés auxflancs violets desbasaltes.
Nefoulez pas
les mousses volcaniques àl’acide fraîcheur ; puissenthésitervospas auseuil desprairies inhabitées etde lagrande forêt
humide deconifères, crevantl’enchevêtrement deslianes etdes fougères pourélever dansleciel des formes inverses de
celle denos sapins : nonpascônes effilés verslesommet, maisaucontraire –végétal régulier pourcharmer Baudelaire –
étageant autourdutronc lesplateaux hexagonaux deleurs branches, etévasant ceux-cijusqu’au dernierquis’épanouit
en une géante ombelle.
Viergeetsolennel paysagequi,pendant desmillions desiècles, semble avoirpréservé intactle
visage ducarbonifère etque l’altitude, combinée avecl’éloignement dutropique, affranchit delaconfusion amazonienne
pour luiprêter unemajesté etune ordonnance inexplicables, àmoins d’yvoir l’effet d’unusage immémorial, parune race
plus sage etplus puissante quelanôtre, etàla disparition delaquelle nousdevons depouvoir pénétrer dansceparc
sublime, aujourd’hui tombéausilence etàl’abandon.
Sur cesterres quidominent lesdeux rivesduRio Tibagy, àmille mètres environ au-dessus duniveau delamer, j’ai
pris mon premier contactaveclessauvages, enaccompagnant danssatournée unchef dedistrict duService de
Protection desIndiens.
À l’époque deladécouverte, toutelazone sudduBrésil servait d’habitat àdes groupements parentsparlalangue et
par laculture etque l’onconfondait naguèresouslenom deGé.
Ilsavaient étévraisemblablement refouléspardes
envahisseurs récentsdelangue tupiquioccupaient déjàtoute labande côtière etcontre lesquels ilsluttaient.
Protégés
par leur repli dans desrégions d’accèsdifficile, lesGé dusud duBrésil ontsurvécu pendant quelques sièclesauxTupi, vite
liquidés parlescolonisateurs.
Danslesforêts desÉtats méridionaux : ParanaetSanta Catarina, despetites bandes
sauvages sesont maintenues jusqu’auXXe siècle ; ilen subsistait peut-être quelques-unes en1935, siférocement
persécutées aucours descent dernières annéesqu’elles serendaient invisibles ; maislaplupart avaient étéréduites et
fixées parlegouvernement brésilien,auxenvirons de1914, dansplusieurs centres.Audébut, ons’efforça deles intégrer
à la vie moderne.
Ilyeut auvillage deSão Jeronymo quime servait debase, uneserrurerie, unescierie, uneécole, une
pharmacie.
Leposte recevait régulièrement desoutils : haches, couteaux, clous ;ondistribuait desvêtements etdes
couvertures.
Vingtansplus tard, cestentatives étaientabandonnées.
Enlaissant lesIndiens àleurs ressources, leService
de Protection témoignait del’indifférence dontilétait devenu l’objetdelapart despouvoirs publics(iladepuis repris
une certaine autorité) ; ainsisetrouvait-il contraint,sansl’avoir désiré, d’essayer uneautre méthode, quiincitât les
indigènes àretrouver quelqueinitiative etles contraignît àreprendre leurpropre direction.
De leur expérience éphémèredecivilisation, lesindigènes n’ontretenu quelesvêtements brésiliens,lahache, le
couteau etl’aiguille àcoudre.
Pourtoutlereste, cefut l’échec.
Onleur avait construit desmaisons, etils vivaient dehors.
On s’était efforcé deles fixer dans desvillages etils demeuraient nomades.Leslits, ilsles avaient briséspourenfaire du
feu etcouchaient àmême lesol.
Lestroupeaux devaches envoyés parlegouvernement vaguaientàl’aventure, les
indigènes repoussant avecdégoût leurviande etleur lait.Lespilons debois, musmécaniquement parleremplissage etle
vidage alternatifs d’unrécipient fixéàun bras delevier (dispositif fréquentauBrésil oùilest connu souslenom de
monjolo, et
que lesPortugais ontpeut-être importéd’Orient), pourrissaient inutilisés,lepilage àla main restant la
pratique générale.
À ma grande déception, lesIndiens duTibagy n’étaient donc,nicomplètement des« vrais Indiens » ni,surtout, des
« sauvages ».
Mais,endépouillant desapoésie l’image naïvequel’ethnographe débutantformedeses expériences
futures, ilsme donnaient uneleçon deprudence etd’objectivité.
Enles trouvant moinsintacts quejen’espérais, j’allais
les découvrir plussecrets queleur apparence extérieuren’auraitpulefaire croire.
Ilsillustraient pleinement cette
situation sociologique quitend àdevenir exclusive pourl’observateur delaseconde moitiéduXXesiècle, de« primitifs »
à qui lacivilisation futbrutalement imposéeetdont, unefoissurmonté lepéril qu’ils étaient censésreprésenter, ons’est
ensuite désintéressé.
Forméepourunepart d’antiques traditionsquiont résisté àl’influence desblancs (tellelapratique
du limage etde l’incrustation dentaires,sifréquente encoreparmieux),pouruneautre, d’emprunts faitsàla civilisation
moderne, leurculture constituait unensemble originaldontl’étude, sidépourvue depittoresque qu’ellepûtêtre, neme
plaçait pourtant pasàune école moins instructive quecelle despurs Indiens quejedevais approcher ultérieurement.
Mais surtout, depuisquecesIndiens setrouvaient livrésàleurs propres ressources, onassistait àun étrange
renversement del’équilibre superficiel entreculture moderne etculture primitive.
D’anciens genresdevie, des
techniques traditionnelles réapparaissaient, issusd’unpassé dontonaurait eutort d’oublier lavivante proximité.
D’où
viennent cespilons depierre admirablement polisquej’aitrouvés, danslesmaisons indiennes, mélangésavecles
assiettes defer émaillé, lescuillers debazar, etmême –parfois –les restes squelettiques d’unemachine àcoudre ?
Échanges commerciaux, danslesilence delaforêt, aveccespopulations demême race,maisrestées sauvages etdont.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Révision DIE DUE PARTIE I - les caractéristiques du droit de l’UE
- « 1984 » de George Orwell (première partie, chapitre 1) - commentaire
- Madame de Lafayette, La princesse de Clèves 1678 Quatrième partie, « la rupture »
- Evolution des caractéristiques du héros de roman du XVII ème siècle au XXIème siècle
- THEME 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant Partie A : Génétique et évolution Chapitre 1 : L’origine du génotype des individus