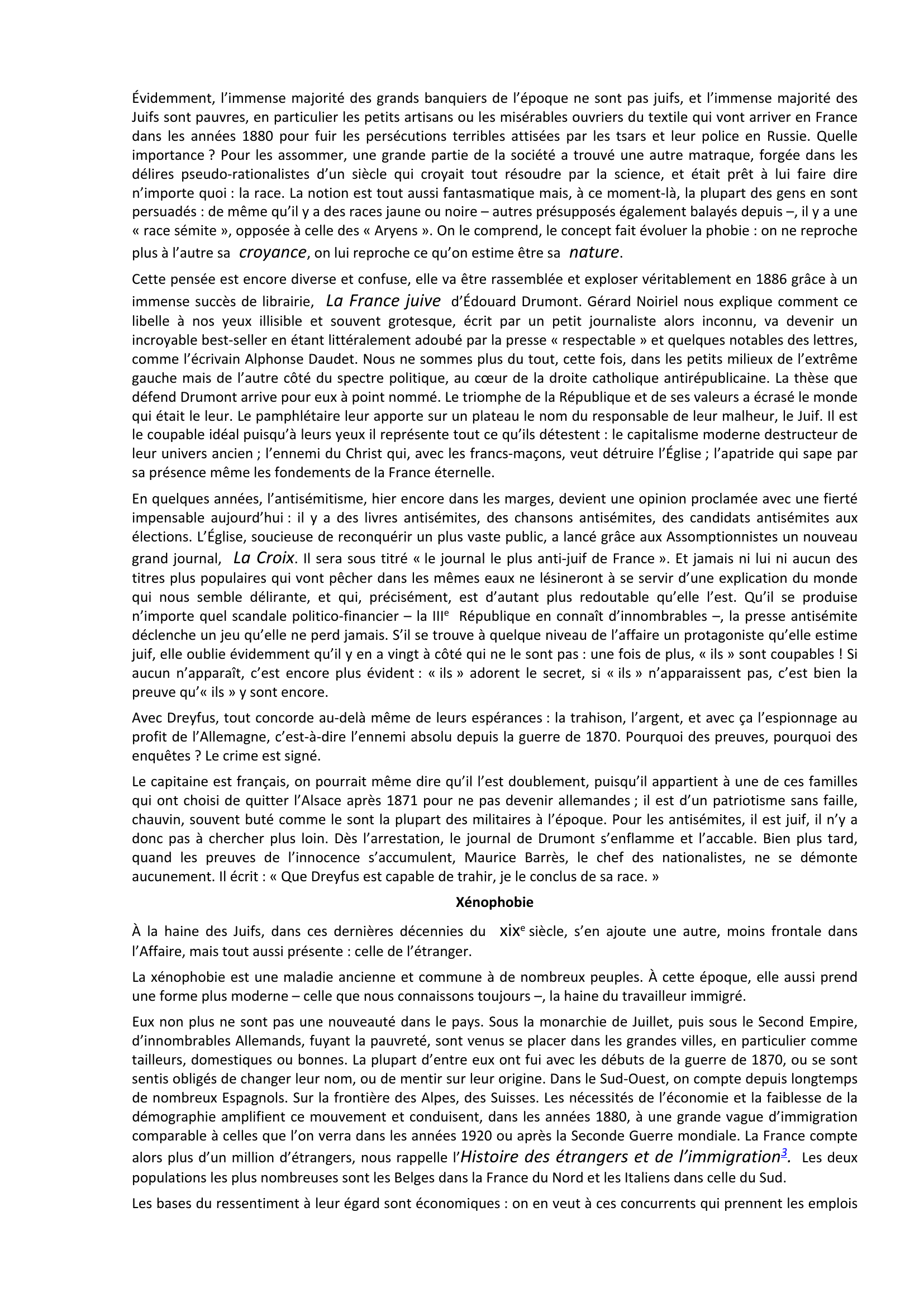cet interminable feuilleton qui brouille les amis, électrise les débats parlementaires, fait casser les assiettes dans les dîners de famille, et menace plus d'une fois de dégénérer en guerre civile.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document


«
Évidemment,
l’immensemajoritédesgrands banquiers del’époque nesont pasjuifs, etl’immense majoritédes
Juifs sont pauvres, enparticulier lespetits artisans oules misérables ouvriersdutextile quivont arriver enFrance
dans lesannées 1880pourfuirlespersécutions terriblesattiséesparlestsars etleur police enRussie.
Quelle
importance ? Pourlesassommer, unegrande partiedelasociété atrouvé uneautre matraque, forgéedansles
délires pseudo-rationalistes d’unsiècle quicroyait toutrésoudre parlascience, etétait prêtàlui faire dire
n’importe quoi :larace.
Lanotion esttout aussi fantasmatique mais,àce moment-là, laplupart desgens ensont
persuadés : demême qu’ilya des races jaune ounoire –autres présupposés égalementbalayésdepuis–,ilya une
« race sémite », opposéeàcelle des« Aryens ».
Onlecomprend, leconcept faitévoluer laphobie : onnereproche
plus àl’autre sa croyance ,
on luireproche cequ’on estime êtresa nature .
Cette pensée estencore diverse etconfuse, ellevaêtre rassemblée etexploser véritablement en1886 grâce àun
immense succèsdelibrairie, La
France juive d’Édouard
Drumont.GérardNoirielnousexplique comment ce
libelle ànos yeux illisible etsouvent grotesque, écritparunpetit journaliste alorsinconnu, vadevenir un
incroyable best-seller enétant littéralement adoubéparlapresse « respectable » etquelques notablesdeslettres,
comme l’écrivain Alphonse Daudet.Nousnesommes plusdutout, cette fois,dans lespetits milieux del’extrême
gauche maisdel’autre côtéduspectre politique, aucœur deladroite catholique antirépublicaine.
Lathèse que
défend Drumont arrivepoureuxàpoint nommé.
Letriomphe delaRépublique etde ses valeurs aécrasé lemonde
qui était leleur.
Lepamphlétaire leurapporte surunplateau lenom duresponsable deleur malheur, leJuif.
Ilest
le coupable idéalpuisqu’à leursyeuxilreprésente toutcequ’ils détestent : lecapitalisme modernedestructeur de
leur univers ancien ; l’ennemi duChrist qui,avec lesfrancs-maçons, veutdétruire l’Église ;l’apatride quisape par
sa présence mêmelesfondements delaFrance éternelle.
En quelques années,l’antisémitisme, hierencore danslesmarges, devientuneopinion proclamée avecunefierté
impensable aujourd’hui : ilya des livres antisémites, deschansons antisémites, descandidats antisémites aux
élections.
L’Église,soucieuse dereconquérir unplus vaste public, alancé grâce auxAssomptionnistes unnouveau
grand journal, La
Croix .
Il sera sous titré« lejournal leplus anti-juif deFrance ».
Etjamais nilui niaucun des
titres pluspopulaires quivont pêcher danslesmêmes eauxnelésineront àse servir d’une explication dumonde
qui nous semble délirante, etqui, précisément, estd’autant plusredoutable qu’ellel’est.Qu’ilseproduise
n’importe quelscandale politico-financier –la IIIe
République enconnaît d’innombrables –,lapresse antisémite
déclenche unjeu qu’elle neperd jamais.
S’ilsetrouve àquelque niveaudel’affaire unprotagoniste qu’elleestime
juif, elleoublie évidemment qu’ilyen avingt àcôté quinelesont pas : unefoisdeplus, « ils » sontcoupables ! Si
aucun n’apparaît, c’estencore plusévident : « ils »adorent lesecret, si« ils » n’apparaissent pas,c’est bienla
preuve qu’« ils » ysont encore.
Avec Dreyfus, toutconcorde au-delàmêmedeleurs espérances : latrahison, l’argent,etavec çal’espionnage au
profit del’Allemagne, c’est-à-direl’ennemiabsoludepuis laguerre de1870.
Pourquoi despreuves, pourquoi des
enquêtes ? Lecrime estsigné.
Le capitaine estfrançais, onpourrait mêmedirequ’il l’estdoublement, puisqu’ilappartient àune deces familles
qui ont choisi dequitter l’Alsace après1871pournepas devenir allemandes ; ilest d’un patriotisme sansfaille,
chauvin, souventbutécomme lesont laplupart desmilitaires àl’époque.
Pourlesantisémites, ilest juif, iln’y a
donc pasàchercher plusloin.
Dèsl’arrestation, lejournal deDrumont s’enflamme etl’accable.
Bienplustard,
quand lespreuves del’innocence s’accumulent, MauriceBarrès,lechef desnationalistes, nesedémonte
aucunement.
Ilécrit : « Que Dreyfus estcapable detrahir, jeleconclus desarace. » Xénophobie
À
la haine desJuifs, danscesdernières décennies duxixe
siècle, s’enajoute uneautre, moins frontale dans
l’Affaire, maistoutaussi présente : celledel’étranger.
La xénophobie estune maladie ancienne etcommune àde nombreux peuples.Àcette époque, elleaussi prend
une forme plusmoderne –celle quenous connaissons toujours–,lahaine dutravailleur immigré.
Eux non plus nesont pasune nouveauté danslepays.
Souslamonarchie deJuillet, puissous leSecond Empire,
d’innombrables Allemands,fuyantlapauvreté, sontvenus seplacer danslesgrandes villes,enparticulier comme
tailleurs, domestiques oubonnes.
Laplupart d’entre euxontfuiavec lesdébuts delaguerre de1870, ousesont
sentis obligés dechanger leurnom, oudementir surleur origine.
DansleSud-Ouest, oncompte depuislongtemps
de nombreux Espagnols.
Surlafrontière desAlpes, desSuisses.
Lesnécessités del’économie etlafaiblesse dela
démographie amplifientcemouvement etconduisent, danslesannées 1880,àune grande vagued’immigration
comparable àcelles quel’onverra danslesannées 1920ouaprès laSeconde Guerremondiale.
LaFrance compte
alors plusd’un million d’étrangers, nousrappelle l’ Histoire
desétrangers etde l’immigration 3
.
Les
deux
populations lesplus nombreuses sontlesBelges danslaFrance duNord etles Italiens danscelleduSud.
Les bases duressentiment àleur égard sontéconomiques : onenveut àces concurrents quiprennent lesemplois.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- guerre civile soudanaise
- GUERRE CIVILE (La). Henry de Montherlant
- KOURAGUINE. Famille de personnages du roman de Léon Tolstoï la Guerre et la Paix
- Argumentation sur l'internationalisation de la guerre civile espagnole et le bouleversement de l'ordre européen
- Guerre civile d'Espagne En juillet 1936, l'Espagne -- dirigée par un