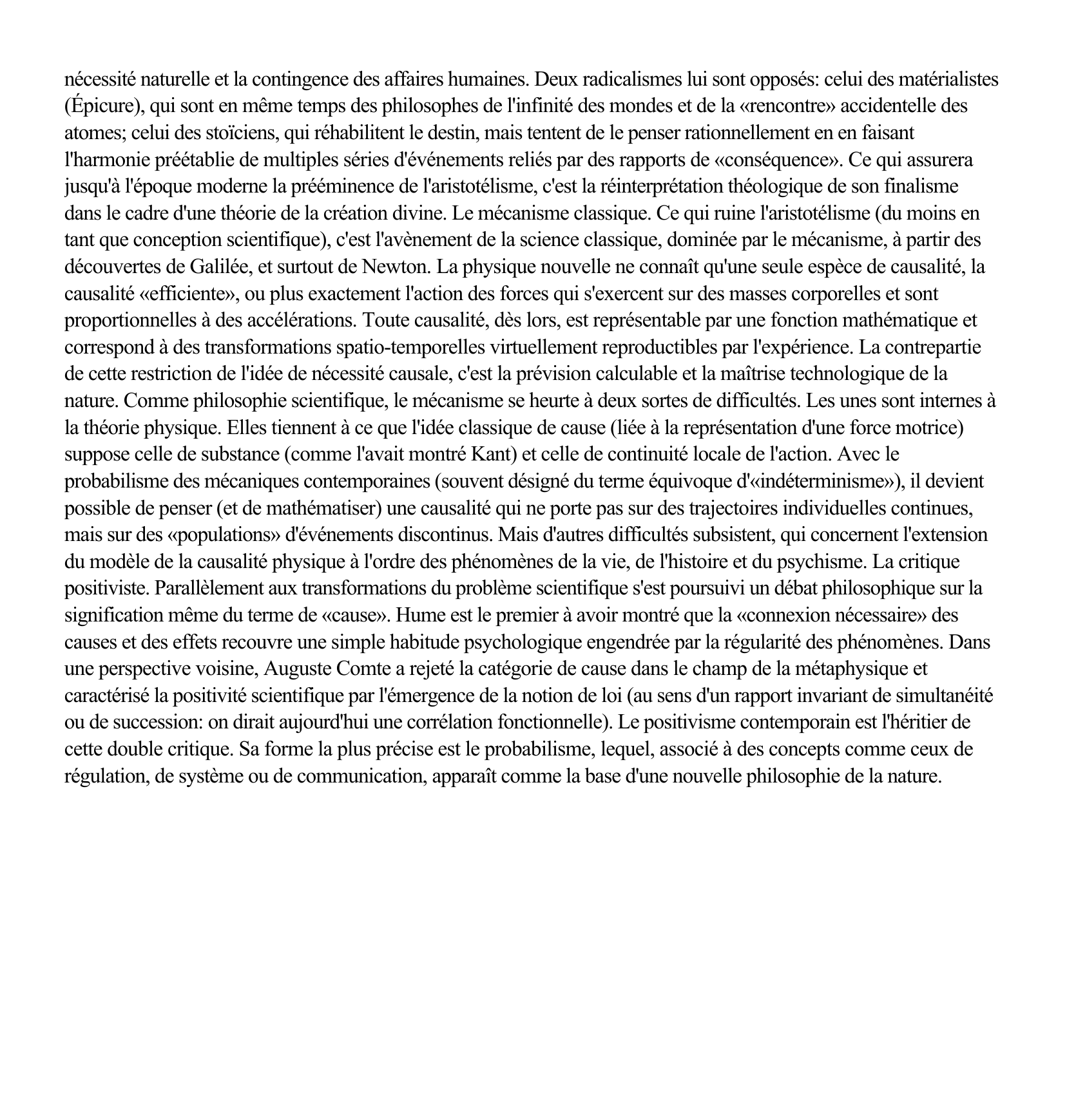causalité n.
Publié le 12/07/2014
Extrait du document
«
nécessité naturelle et la contingence des affaires humaines.
Deux radicalismes lui sont opposés: celui des matérialistes
(Épicure), qui sont en même temps des philosophes de l'infinité des mondes et de la «rencontre» accidentelle des
atomes; celui des stoïciens, qui réhabilitent le destin, mais tentent de le penser rationnellement en en faisant
l'harmonie préétablie de multiples séries d'événements reliés par des rapports de «conséquence».
Ce qui assurera
jusqu'à l'époque moderne la prééminence de l'aristotélisme, c'est la réinterprétation théologique de son finalisme
dans le cadre d'une théorie de la création divine.
Le mécanisme classique.
Ce qui ruine l'aristotélisme (du moins en
tant que conception scientifique), c'est l'avènement de la science classique, dominée par le mécanisme, à partir des
découvertes de Galilée, et surtout de Newton.
La physique nouvelle ne connaît qu'une seule espèce de causalité, la
causalité «efficiente», ou plus exactement l'action des forces qui s'exercent sur des masses corporelles et sont
proportionnelles à des accélérations.
Toute causalité, dès lors, est représentable par une fonction mathématique et
correspond à des transformations spatio-temporelles virtuellement reproductibles par l'expérience.
La contrepartie
de cette restriction de l'idée de nécessité causale, c'est la prévision calculable et la maîtrise technologique de la
nature.
Comme philosophie scientifique, le mécanisme se heurte à deux sortes de difficultés.
Les unes sont internes à
la théorie physique.
Elles tiennent à ce que l'idée classique de cause (liée à la représentation d'une force motrice)
suppose celle de substance (comme l'avait montré Kant) et celle de continuité locale de l'action.
Avec le
probabilisme des mécaniques contemporaines (souvent désigné du terme équivoque d'«indéterminisme»), il devient
possible de penser (et de mathématiser) une causalité qui ne porte pas sur des trajectoires individuelles continues,
mais sur des «populations» d'événements discontinus.
Mais d'autres difficultés subsistent, qui concernent l'extension
du modèle de la causalité physique à l'ordre des phénomènes de la vie, de l'histoire et du psychisme.
La critique
positiviste.
Parallèlement aux transformations du problème scientifique s'est poursuivi un débat philosophique sur la
signification même du terme de «cause».
Hume est le premier à avoir montré que la «connexion nécessaire» des
causes et des effets recouvre une simple habitude psychologique engendrée par la régularité des phénomènes.
Dans
une perspective voisine, Auguste Comte a rejeté la catégorie de cause dans le champ de la métaphysique et
caractérisé la positivité scientifique par l'émergence de la notion de loi (au sens d'un rapport invariant de simultanéité
ou de succession: on dirait aujourd'hui une corrélation fonctionnelle).
Le positivisme contemporain est l'héritier de
cette double critique.
Sa forme la plus précise est le probabilisme, lequel, associé à des concepts comme ceux de
régulation, de système ou de communication, apparaît comme la base d'une nouvelle philosophie de la nature..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La causalité (philosophie)
- EXPÉRIENCE HUMAINE ET LA CAUSALITÉ PHYSIQUE (L’), 1922. Léon Brunschvicg
- EXPÉRIENCE HUMAINE ET LA CAUSALITÉ PHYSIQUE (L'). (résumé) de Léon Brunschvicg
- La causalité est-elle universelle ?
- causalité.