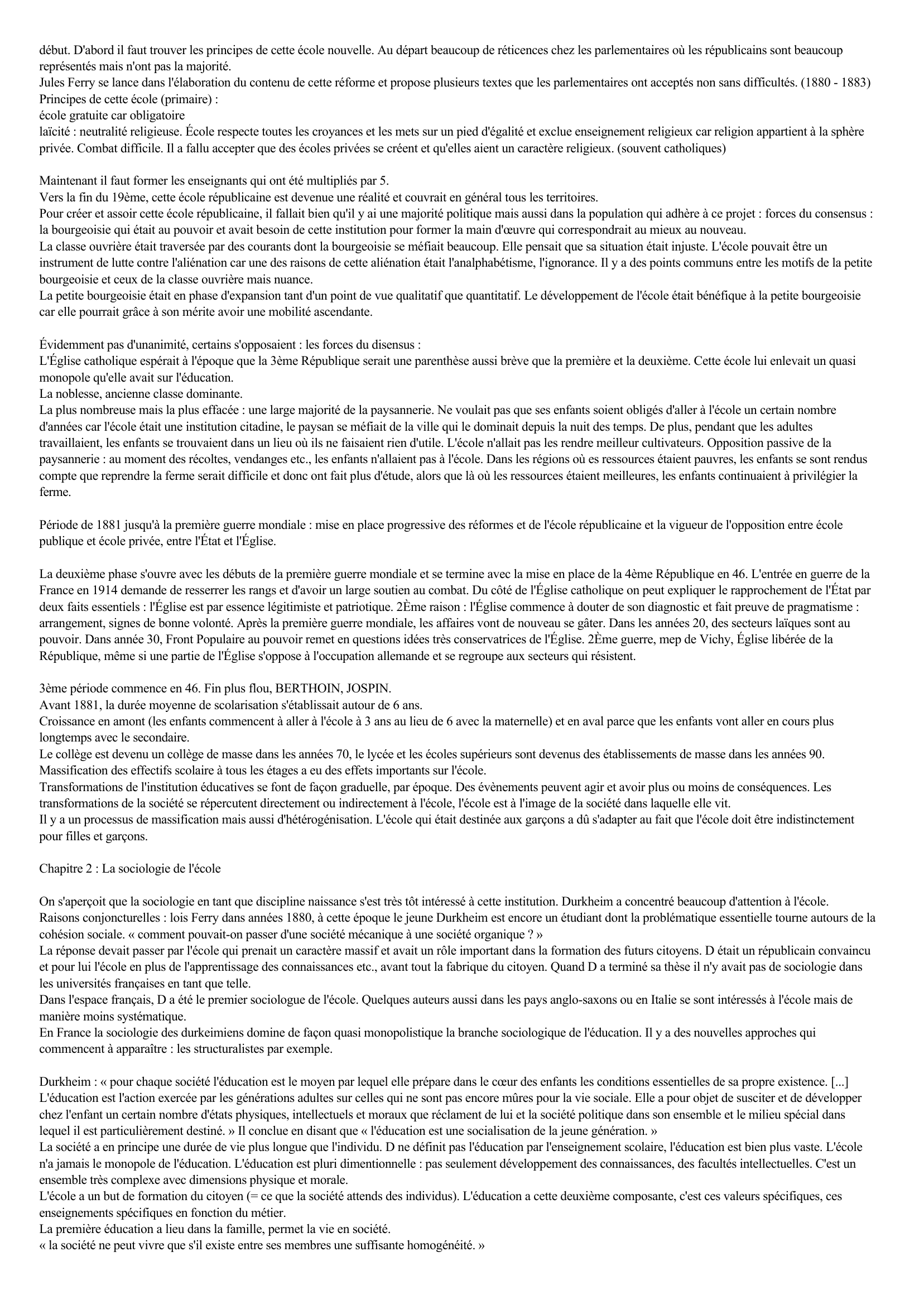SOCIOLOGIE DE L'EDUCATION
Publié le 19/08/2012
Extrait du document
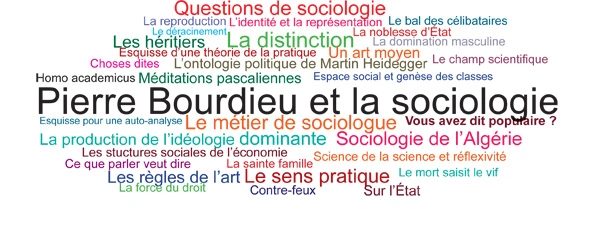
3ème période commence en 46. Fin plus flou, BERTHOIN, JOSPIN. Avant 1881, la durée moyenne de scolarisation s'établissait autour de 6 ans. Croissance en amont (les enfants commencent à aller à l'école à 3 ans au lieu de 6 avec la maternelle) et en aval parce que les enfants vont aller en cours plus longtemps avec le secondaire. Le collège est devenu un collège de masse dans les années 70, le lycée et les écoles supérieurs sont devenus des établissements de masse dans les années 90. Massification des effectifs scolaire à tous les étages a eu des effets importants sur l'école. Transformations de l'institution éducatives se font de façon graduelle, par époque. Des évènements peuvent agir et avoir plus ou moins de conséquences. Les transformations de la société se répercutent directement ou indirectement à l'école, l'école est à l'image de la société dans laquelle elle vit. Il y a un processus de massification mais aussi d'hétérogénisation. L'école qui était destinée aux garçons a dû s'adapter au fait que l'école doit être indistinctement pour filles et garçons.
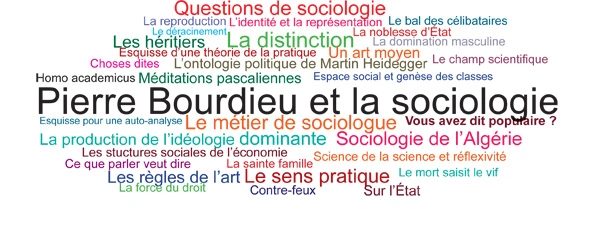
«
début.
D'abord il faut trouver les principes de cette école nouvelle.
Au départ beaucoup de réticences chez les parlementaires où les républicains sont beaucoupreprésentés mais n'ont pas la majorité.Jules Ferry se lance dans l'élaboration du contenu de cette réforme et propose plusieurs textes que les parlementaires ont acceptés non sans difficultés.
(1880 - 1883)Principes de cette école (primaire) :école gratuite car obligatoirelaïcité : neutralité religieuse.
École respecte toutes les croyances et les mets sur un pied d'égalité et exclue enseignement religieux car religion appartient à la sphèreprivée.
Combat difficile.
Il a fallu accepter que des écoles privées se créent et qu'elles aient un caractère religieux.
(souvent catholiques)
Maintenant il faut former les enseignants qui ont été multipliés par 5.Vers la fin du 19ème, cette école républicaine est devenue une réalité et couvrait en général tous les territoires.Pour créer et assoir cette école républicaine, il fallait bien qu'il y ai une majorité politique mais aussi dans la population qui adhère à ce projet : forces du consensus :la bourgeoisie qui était au pouvoir et avait besoin de cette institution pour former la main d'œuvre qui correspondrait au mieux au nouveau.La classe ouvrière était traversée par des courants dont la bourgeoisie se méfiait beaucoup.
Elle pensait que sa situation était injuste.
L'école pouvait être uninstrument de lutte contre l'aliénation car une des raisons de cette aliénation était l'analphabétisme, l'ignorance.
Il y a des points communs entre les motifs de la petitebourgeoisie et ceux de la classe ouvrière mais nuance.La petite bourgeoisie était en phase d'expansion tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif.
Le développement de l'école était bénéfique à la petite bourgeoisiecar elle pourrait grâce à son mérite avoir une mobilité ascendante.
Évidemment pas d'unanimité, certains s'opposaient : les forces du disensus :L'Église catholique espérait à l'époque que la 3ème République serait une parenthèse aussi brève que la première et la deuxième.
Cette école lui enlevait un quasimonopole qu'elle avait sur l'éducation.La noblesse, ancienne classe dominante.La plus nombreuse mais la plus effacée : une large majorité de la paysannerie.
Ne voulait pas que ses enfants soient obligés d'aller à l'école un certain nombred'années car l'école était une institution citadine, le paysan se méfiait de la ville qui le dominait depuis la nuit des temps.
De plus, pendant que les adultestravaillaient, les enfants se trouvaient dans un lieu où ils ne faisaient rien d'utile.
L'école n'allait pas les rendre meilleur cultivateurs.
Opposition passive de lapaysannerie : au moment des récoltes, vendanges etc., les enfants n'allaient pas à l'école.
Dans les régions où es ressources étaient pauvres, les enfants se sont renduscompte que reprendre la ferme serait difficile et donc ont fait plus d'étude, alors que là où les ressources étaient meilleures, les enfants continuaient à privilégier laferme.
Période de 1881 jusqu'à la première guerre mondiale : mise en place progressive des réformes et de l'école républicaine et la vigueur de l'opposition entre écolepublique et école privée, entre l'État et l'Église.
La deuxième phase s'ouvre avec les débuts de la première guerre mondiale et se termine avec la mise en place de la 4ème République en 46.
L'entrée en guerre de laFrance en 1914 demande de resserrer les rangs et d'avoir un large soutien au combat.
Du côté de l'Église catholique on peut expliquer le rapprochement de l'État pardeux faits essentiels : l'Église est par essence légitimiste et patriotique.
2Ème raison : l'Église commence à douter de son diagnostic et fait preuve de pragmatisme :arrangement, signes de bonne volonté.
Après la première guerre mondiale, les affaires vont de nouveau se gâter.
Dans les années 20, des secteurs laïques sont aupouvoir.
Dans année 30, Front Populaire au pouvoir remet en questions idées très conservatrices de l'Église.
2Ème guerre, mep de Vichy, Église libérée de laRépublique, même si une partie de l'Église s'oppose à l'occupation allemande et se regroupe aux secteurs qui résistent.
3ème période commence en 46.
Fin plus flou, BERTHOIN, JOSPIN.Avant 1881, la durée moyenne de scolarisation s'établissait autour de 6 ans.Croissance en amont (les enfants commencent à aller à l'école à 3 ans au lieu de 6 avec la maternelle) et en aval parce que les enfants vont aller en cours pluslongtemps avec le secondaire.Le collège est devenu un collège de masse dans les années 70, le lycée et les écoles supérieurs sont devenus des établissements de masse dans les années 90.Massification des effectifs scolaire à tous les étages a eu des effets importants sur l'école.Transformations de l'institution éducatives se font de façon graduelle, par époque.
Des évènements peuvent agir et avoir plus ou moins de conséquences.
Lestransformations de la société se répercutent directement ou indirectement à l'école, l'école est à l'image de la société dans laquelle elle vit.Il y a un processus de massification mais aussi d'hétérogénisation.
L'école qui était destinée aux garçons a dû s'adapter au fait que l'école doit être indistinctementpour filles et garçons.
Chapitre 2 : La sociologie de l'école
On s'aperçoit que la sociologie en tant que discipline naissance s'est très tôt intéressé à cette institution.
Durkheim a concentré beaucoup d'attention à l'école.Raisons conjoncturelles : lois Ferry dans années 1880, à cette époque le jeune Durkheim est encore un étudiant dont la problématique essentielle tourne autours de lacohésion sociale.
« comment pouvait-on passer d'une société mécanique à une société organique ? »La réponse devait passer par l'école qui prenait un caractère massif et avait un rôle important dans la formation des futurs citoyens.
D était un républicain convaincuet pour lui l'école en plus de l'apprentissage des connaissances etc., avant tout la fabrique du citoyen.
Quand D a terminé sa thèse il n'y avait pas de sociologie dansles universités françaises en tant que telle.Dans l'espace français, D a été le premier sociologue de l'école.
Quelques auteurs aussi dans les pays anglo-saxons ou en Italie se sont intéressés à l'école mais demanière moins systématique.En France la sociologie des durkeimiens domine de façon quasi monopolistique la branche sociologique de l'éducation.
Il y a des nouvelles approches quicommencent à apparaître : les structuralistes par exemple.
Durkheim : « pour chaque société l'éducation est le moyen par lequel elle prépare dans le cœur des enfants les conditions essentielles de sa propre existence.
[...]L'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale.
Elle a pour objet de susciter et de développerchez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu spécial danslequel il est particulièrement destiné.
» Il conclue en disant que « l'éducation est une socialisation de la jeune génération.
»La société a en principe une durée de vie plus longue que l'individu.
D ne définit pas l'éducation par l'enseignement scolaire, l'éducation est bien plus vaste.
L'écolen'a jamais le monopole de l'éducation.
L'éducation est pluri dimentionnelle : pas seulement développement des connaissances, des facultés intellectuelles.
C'est unensemble très complexe avec dimensions physique et morale.L'école a un but de formation du citoyen (= ce que la société attends des individus).
L'éducation a cette deuxième composante, c'est ces valeurs spécifiques, cesenseignements spécifiques en fonction du métier.La première éducation a lieu dans la famille, permet la vie en société.« la société ne peut vivre que s'il existe entre ses membres une suffisante homogénéité.
».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TEXTE D’ETUDE : Jean-Jacques Rousseau, Emile ou De l’Education, 1762, chapitre III
- SES chapitre 2 sociologie: Quels sont les fondements du commerce International et de l'internationalisation de la production ?
- Intro a la sociologie
- sociologie anglo-saxone
- UE 1.1. S1 Psychologie, sociologie, anthropologie Les grands domaines de la psychologie