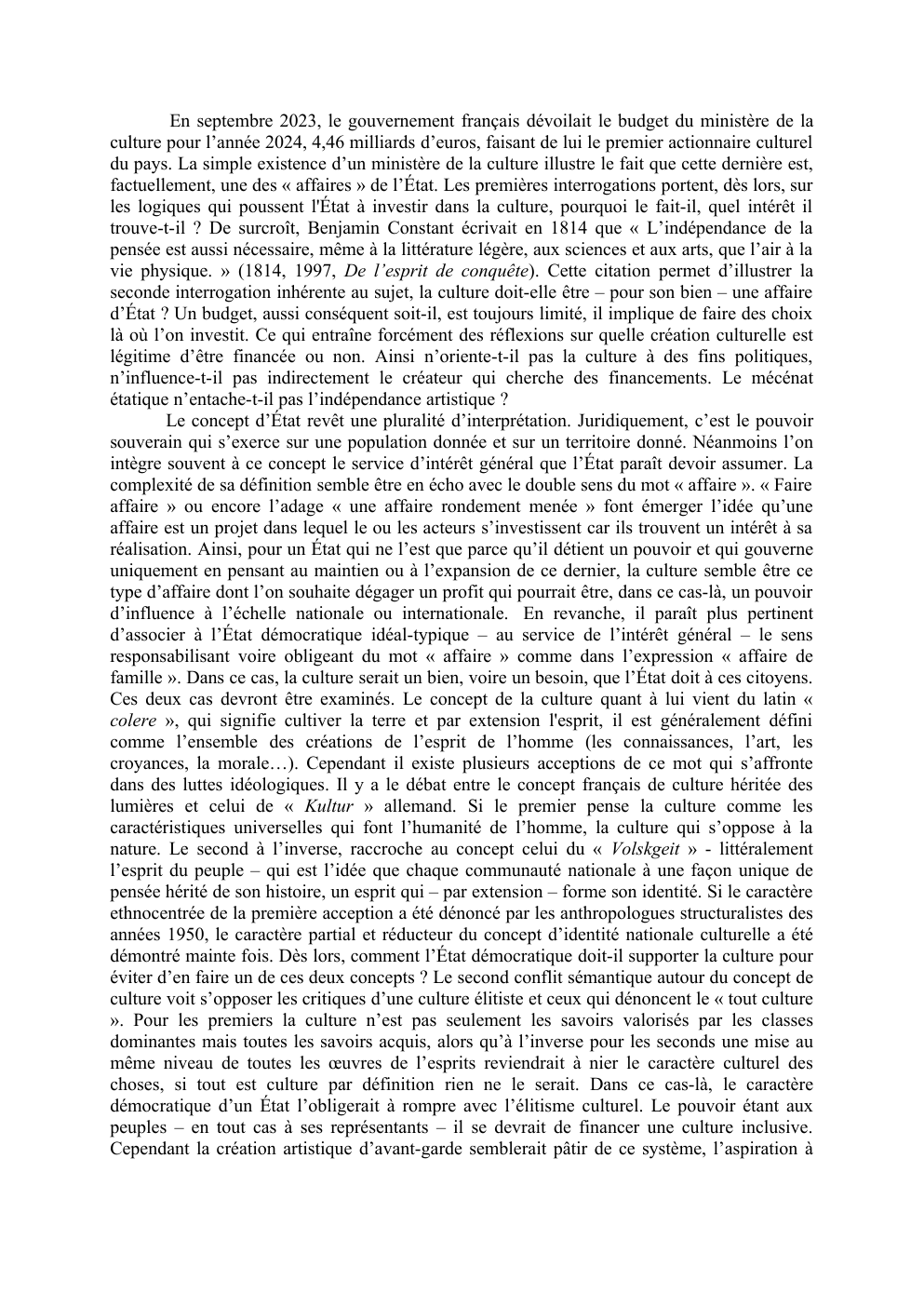La culture est elle une affaire d'État ?
Publié le 24/02/2024
Extrait du document
«
En septembre 2023, le gouvernement français dévoilait le budget du ministère de la
culture pour l’année 2024, 4,46 milliards d’euros, faisant de lui le premier actionnaire culturel
du pays.
La simple existence d’un ministère de la culture illustre le fait que cette dernière est,
factuellement, une des « affaires » de l’État.
Les premières interrogations portent, dès lors, sur
les logiques qui poussent l'État à investir dans la culture, pourquoi le fait-il, quel intérêt il
trouve-t-il ? De surcroît, Benjamin Constant écrivait en 1814 que « L’indépendance de la
pensée est aussi nécessaire, même à la littérature légère, aux sciences et aux arts, que l’air à la
vie physique.
» (1814, 1997, De l’esprit de conquête).
Cette citation permet d’illustrer la
seconde interrogation inhérente au sujet, la culture doit-elle être – pour son bien – une affaire
d’État ? Un budget, aussi conséquent soit-il, est toujours limité, il implique de faire des choix
là où l’on investit.
Ce qui entraîne forcément des réflexions sur quelle création culturelle est
légitime d’être financée ou non.
Ainsi n’oriente-t-il pas la culture à des fins politiques,
n’influence-t-il pas indirectement le créateur qui cherche des financements.
Le mécénat
étatique n’entache-t-il pas l’indépendance artistique ?
Le concept d’État revêt une pluralité d’interprétation.
Juridiquement, c’est le pouvoir
souverain qui s’exerce sur une population donnée et sur un territoire donné.
Néanmoins l’on
intègre souvent à ce concept le service d’intérêt général que l’État paraît devoir assumer.
La
complexité de sa définition semble être en écho avec le double sens du mot « affaire ».
« Faire
affaire » ou encore l’adage « une affaire rondement menée » font émerger l’idée qu’une
affaire est un projet dans lequel le ou les acteurs s’investissent car ils trouvent un intérêt à sa
réalisation.
Ainsi, pour un État qui ne l’est que parce qu’il détient un pouvoir et qui gouverne
uniquement en pensant au maintien ou à l’expansion de ce dernier, la culture semble être ce
type d’affaire dont l’on souhaite dégager un profit qui pourrait être, dans ce cas-là, un pouvoir
d’influence à l’échelle nationale ou internationale.
En revanche, il paraît plus pertinent
d’associer à l’État démocratique idéal-typique – au service de l’intérêt général – le sens
responsabilisant voire obligeant du mot « affaire » comme dans l’expression « affaire de
famille ».
Dans ce cas, la culture serait un bien, voire un besoin, que l’État doit à ces citoyens.
Ces deux cas devront être examinés.
Le concept de la culture quant à lui vient du latin «
colere », qui signifie cultiver la terre et par extension l'esprit, il est généralement défini
comme l’ensemble des créations de l’esprit de l’homme (les connaissances, l’art, les
croyances, la morale…).
Cependant il existe plusieurs acceptions de ce mot qui s’affronte
dans des luttes idéologiques.
Il y a le débat entre le concept français de culture héritée des
lumières et celui de « Kultur » allemand.
Si le premier pense la culture comme les
caractéristiques universelles qui font l’humanité de l’homme, la culture qui s’oppose à la
nature.
Le second à l’inverse, raccroche au concept celui du « Volskgeit » - littéralement
l’esprit du peuple – qui est l’idée que chaque communauté nationale à une façon unique de
pensée hérité de son histoire, un esprit qui – par extension – forme son identité.
Si le caractère
ethnocentrée de la première acception a été dénoncé par les anthropologues structuralistes des
années 1950, le caractère partial et réducteur du concept d’identité nationale culturelle a été
démontré mainte fois.
Dès lors, comment l’État démocratique doit-il supporter la culture pour
éviter d’en faire un de ces deux concepts ? Le second conflit sémantique autour du concept de
culture voit s’opposer les critiques d’une culture élitiste et ceux qui dénoncent le « tout culture
».
Pour les premiers la culture n’est pas seulement les savoirs valorisés par les classes
dominantes mais toutes les savoirs acquis, alors qu’à l’inverse pour les seconds une mise au
même niveau de toutes les œuvres de l’esprits reviendrait à nier le caractère culturel des
choses, si tout est culture par définition rien ne le serait.
Dans ce cas-là, le caractère
démocratique d’un État l’obligerait à rompre avec l’élitisme culturel.
Le pouvoir étant aux
peuples – en tout cas à ses représentants – il se devrait de financer une culture inclusive.
Cependant la création artistique d’avant-garde semblerait pâtir de ce système, l’aspiration à
une culture pour la majorité empêcherait l’émergence d’œuvre novatrice à contre-courant des
goûts majoritaires.
Ainsi sera questionner les logiques qui poussent l’État à soutenir la culture ainsi que
les avantages et les inconvénients que la culture trouve dans cette relation.
Si la culture est fondamentalement une affaire d’État puisqu’elle est à l’origine d’une
nation, et est un instrument politique clé (I), l’État démocratique à des obligations qui
l’obligent à servir la culture autant qu’elle le sert (II).
La culture est une affaire d’État dans la mesure où elle à l’origine de l’unité d’une
communauté et un instrument pour gouverner.
La culture est utilisée par l’État pour lier une communauté sur un territoire derrière une
idéologie.
Que l’on donne à la nation l’acception allemande ou française, une chose demeure.
Le
lien unissant les individus est un lien fortement culturel, une histoire partagée, des valeurs
héritées… Lorsque l’État nation se crée en prenant la place de l’État monarchique au XIXe
siècle, il construit une histoire, promeut une culture, qui fait office de référent identitaire pour
que les citoyens puissent se réunir sous un même concept.
Le récit national français rédigé par
E.
Renan et J.
Michelet en est le fruit.
Il permet à l’État de créer un sentiment d’appartenance
à ce dernier chez les individus, sentiment qui saura être exploité par l’État.
Louis Ferdinand
Céline montre brillamment dans Voyage au bout de la nuit comment l’amour de la patrie est
le mécanisme principal qui permet aux gouvernants de circonscrire les jeunes gens.
Pour
paraphraser G.
De Maupassant : "Si la guerre est une chose horrible, le patriotisme ne serait-il
pas l'idée-mère qui l'entretient ?".
La culture est ainsi instrumentalisée par l’État pour servir
une idéologie.
L’exemple totalitaire le montre.
Aucun État n’a plus fait de la culture son
affaire que l’Allemagne Nazi, et l’Italie fasciste.
Par un contrôle total de toutes les créations
artistiques et intellectuelles, les régimes totalitaires ont légitimé leur idéologie, et fanatisé leur
citoyen.
Mais la culture est aussi une nécessité vitale pour la bien-portante d’une démocratie.
L’idée même de la démocratique – un pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple –
suppose que ce même peuple soit capable de comprendre les logiques inhérentes à l’exercice
du pouvoir, et qu’il soit en mesure de ne pas être manipulé.
Rappelons que l'élection au
suffrage universel n’engage pas une démocratie, les régimes fascistes et nazis des années
1920’s et 1930’s ont élus par les citoyens.
La culture aurait donc une importance dans son
caractère émancipateur.
Permettant de développer l’esprit critique, un accès à cette dernière
serait essentiel pour que le citoyen soit indépendant et libre de choisir ses représentants sans
être manipulé par les rhétoriques populistes des candidats.
C’est en pensant cela, en estimant
qu’un des remparts au fascisme était de permettre au peuple d’accéder à la culture savante,
qu’André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, créa les maisons de la culture en
1961.
Des lieux d’expositions financés par l’État qui permettraient selon lui de « rendre
accessible les œuvres capitales de l'humanité au plus grand nombre de Français ».
La culture permet aussi d’acquérir un pouvoir d’influence à l’intérieur comme à
l’extérieur de ses frontières.
Kant parlait dans sa troisième critique, Critique de la faculté de juger, de l’universalité
du beau comme de ce qui permettait l’imposition d’une morale universelle.
C’est aussi ce que
pensait Leon Battista Alberti dans son traité d’architecture L’art d’édifier paru en 1485.
Ce
dernier, partant du principe que la beauté de l’architecture était le rempart contre la
destruction des villes par les envahisseurs, pensait la beauté de l’art comme ayant capacité à
soumettre l’homme à quelque chose de plus grand que lui, de transcendant.
Il est vrai que l’art
fut longtemps un moyen de légitimer le pouvoir du Roi.
Aujourd’hui encore l’on rattache à
François 1 l’image d’un roi cultivé qui aimait les arts, acteur principal de la renaissance
française.
Louis XIV aussi est rattaché à un courant artistique, le classicisme.
Les deux furent
de grands mécènes et subventionnèrent les artistes de leurs époques.
Ce mécénat jamais
désintéressé permettait d’orienter le travail des artistes qui glorifiait le souverain, et de
s’afficher comme cultivé et vertueux.
Des caractéristiques affirmées par tous les moyens à
une époque où la légitimation du pouvoir passait par l’exaltation des qualités du prince.
Cette
faculté de l’art servit aussi les gouvernements plus démocratiques.
Dans son ouvrage Conjurer
la peur, P.
Boucheron montre comment la Fresque du bon gouvernement peinte par Ambrogio
Lorenzetti en 1339 servit à influencer la population.
Commandé par le conseil des six (organe
politique principale de la République de Sienne), elle met côte à côte une allégorie du....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La culture est-elle une affaire d'Etat ?
- affaire boris johnson
- Dissertation sur la culture - Sujet : « Dans quelle mesure peut-on dire que l’on est enfermé dans sa culture ? »
- La culture parvient-elle à contenir les tendances agressives de l'Homme
- La culture éloigne-t-elle l’humain de la nature ?