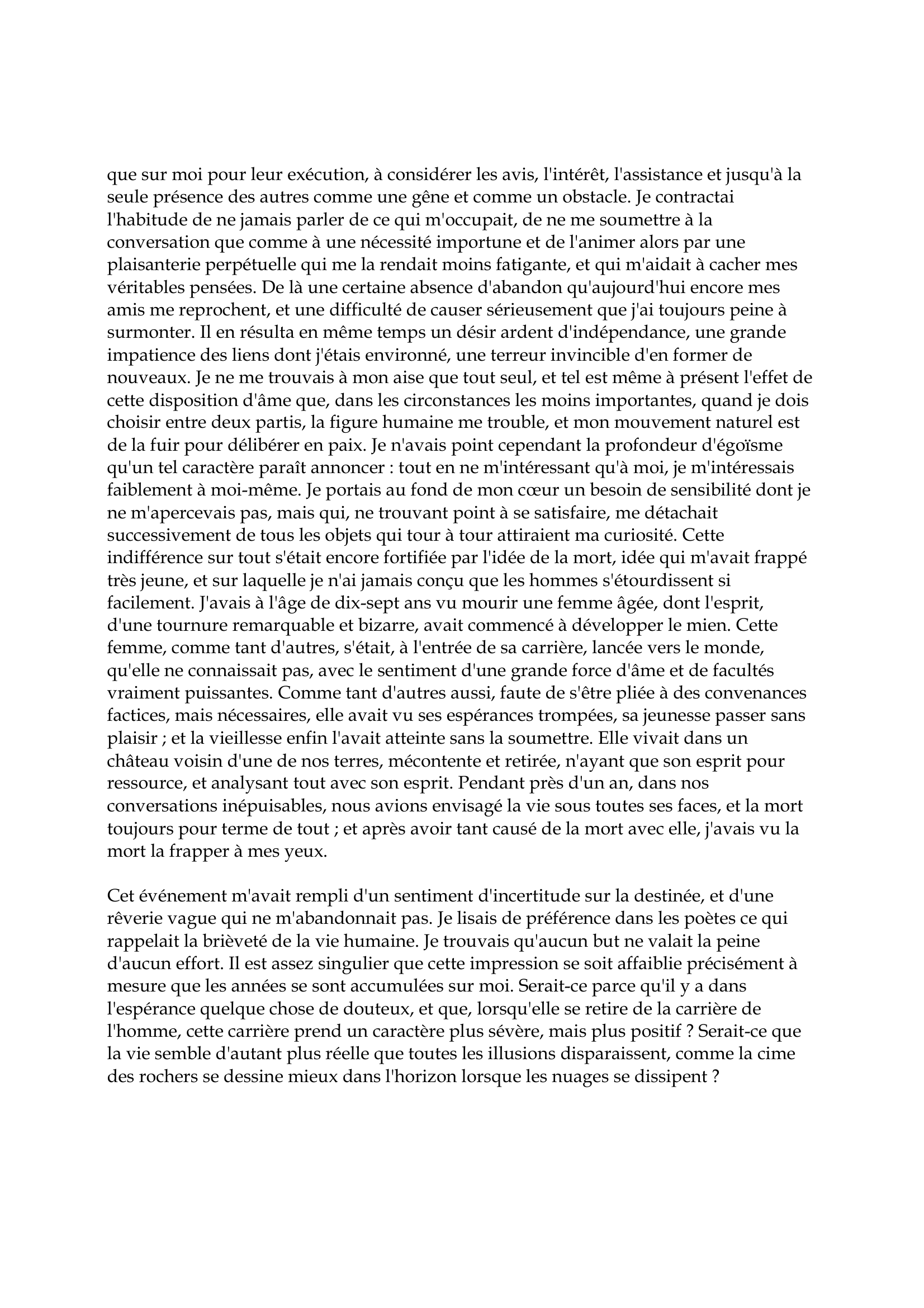Adolphe (1816) Chapitre Premier Benjamin Constant Je venais de finir à vingt-deux ans mes études à l'université de Gottingue.
Publié le 05/04/2015
Extrait du document


«
que sur moi pour leur exécution, à considérer les avis, l'intérêt, l'assistance et jusqu'à la
seule présence des autres comme une gêne et comme un obstacle.
Je contractai
l'habitude de ne jamais parler de ce qui m'occupait, de ne me soumettre à la
conversation que comme à une nécessité importune et de l'animer alors par une
plaisanterie perpétuelle qui me la rendait moins fatigante, et qui m'aidait à cacher mes
véritables pensées.
De là une certaine absence d'abandon qu'aujourd'hui encore mes
amis me reprochent, et une difficulté de causer sérieusement que j'ai toujours peine à
surmonter.
Il en résulta en même temps un désir ardent d'indépendance, une grande
impatience des liens dont j'étais environné, une terreur invincible d'en former de
nouveaux.
Je ne me trouvais à mon aise que tout seul, et tel est même à présent l'effet de
cette disposition d'âme que, dans les circonstances les moins importantes, quand je dois
choisir entre deux partis, la figure humaine me trouble, et mon mouvement naturel est
de la fuir pour délibérer en paix.
Je n'avais point cependant la profondeur d'égoïsme
qu'un tel caractère paraît annoncer : tout en ne m'intéressant qu'à moi, je m'intéressais
faiblement à moi-même.
Je portais au fond de mon c œur un besoin de sensibilité dont je
ne m'apercevais pas, mais qui, ne trouvant point à se satisfaire, me détachait
successivement de tous les objets qui tour à tour attiraient ma curiosité.
Cette
indifférence sur tout s'était encore fortifiée par l'idée de la mort, idée qui m'avait frappé
très jeune, et sur laquelle je n'ai jamais conçu que les hommes s'étourdissent si
facilement.
J'avais à l'âge de dix-sept ans vu mourir une femme âgée, dont l'esprit,
d'une tournure remarquable et bizarre, avait commencé à développer le mien.
Cette
femme, comme tant d'autres, s'était, à l'entrée de sa carrière, lancée vers le monde,
qu'elle ne connaissait pas, avec le sentiment d'une grande force d'âme et de facultés
vraiment puissantes.
Comme tant d'autres aussi, faute de s'être pliée à des convenances
factices, mais nécessaires, elle avait vu ses espérances trompées, sa jeunesse passer sans
plaisir ; et la vieillesse enfin l'avait atteinte sans la soumettre.
Elle vivait dans un
château voisin d'une de nos terres, mécontente et retirée, n'ayant que son esprit pour
ressource, et analysant tout avec son esprit.
Pendant près d'un an, dans nos
conversations inépuisables, nous avions envisagé la vie sous toutes ses faces, et la mort
toujours pour terme de tout ; et après avoir tant causé de la mort avec elle, j'avais vu la
mort la frapper à mes yeux.
Cet événement m'avait rempli d'un sentiment d'incertitude sur la destinée, et d'une
rêverie vague qui ne m'abandonnait pas.
Je lisais de préférence dans les poètes ce qui
rappelait la brièveté de la vie humaine.
Je trouvais qu'aucun but ne valait la peine
d'aucun effort.
Il est assez singulier que cette impression se soit affaiblie précisément à
mesure que les années se sont accumulées sur moi.
Serait-ce parce qu'il y a dans
l'espérance quelque chose de douteux, et que, lorsqu'elle se retire de la carrière de
l'homme, cette carrière prend un caractère plus sévère, mais plus positif ? Serait-ce que
la vie semble d'autant plus réelle que toutes les illusions disparaissent, comme la cime
des rochers se dessine mieux dans l'horizon lorsque les nuages se dissipent ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Adolphe 1816 Benjamin Constant (résume et analyse complète)
- CONSTANT, Benjamin Constant de Rebecque, dit Benjamin (1766-1817) Homme politique et écrivain, il est l'auteur de Adolphe (1816), véritable chef d'oeuvre d'analyse psychologique.
- Benjamin Constant, Adolphe : chapitre X de « C'était une de ces journée d'hiver… » à « j'allais à jamais cesser d'être aimé. »
- ADOLPHE, roman de Benjamin Constant
- ADOLPHE de BENJAMIN CoNSTANT (résumé)