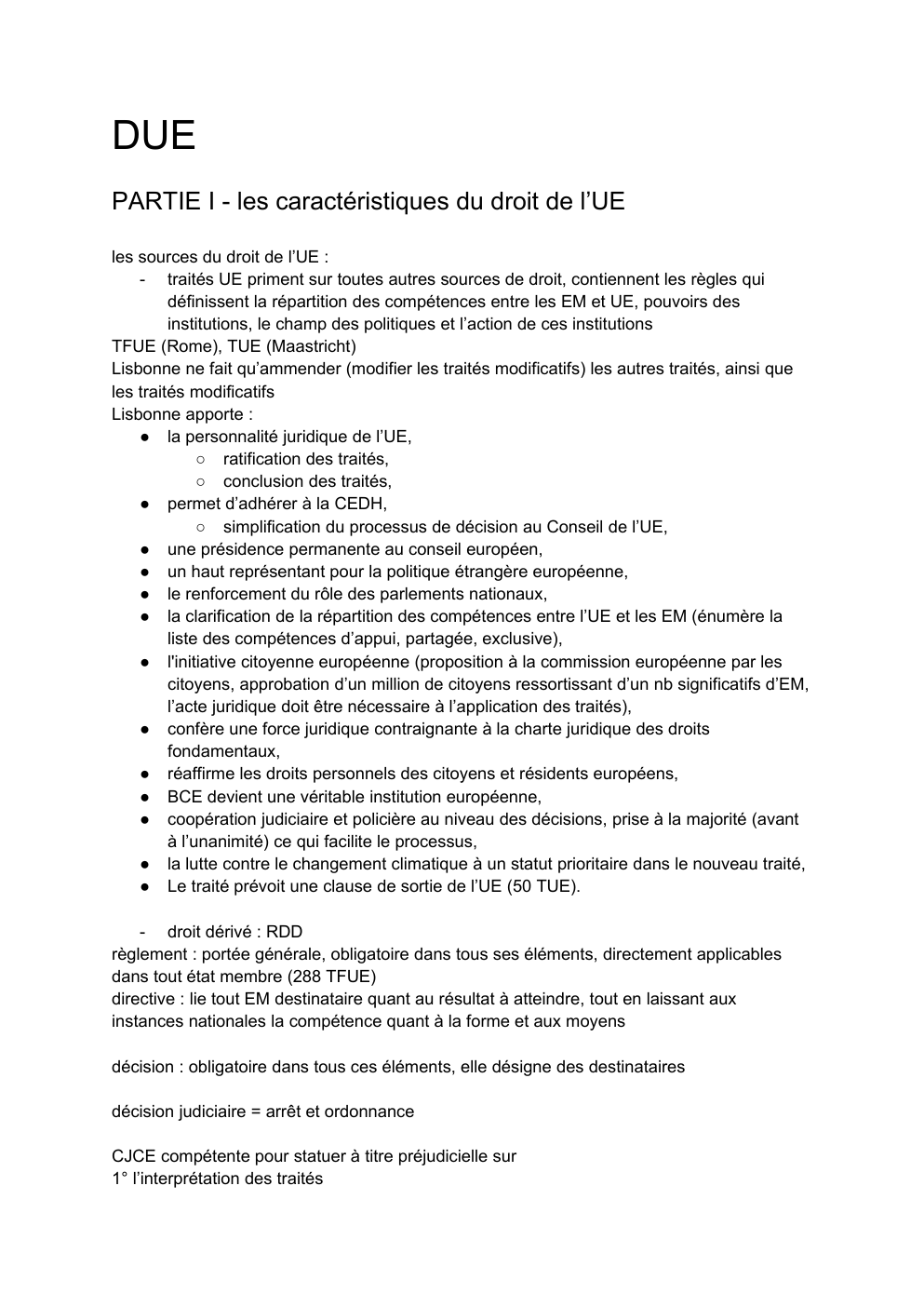Révision DIE DUE PARTIE I - les caractéristiques du droit de l’UE
Publié le 03/11/2023
Extrait du document
«
DUE
PARTIE I - les caractéristiques du droit de l’UE
les sources du droit de l’UE :
- traités UE priment sur toutes autres sources de droit, contiennent les règles qui
définissent la répartition des compétences entre les EM et UE, pouvoirs des
institutions, le champ des politiques et l’action de ces institutions
TFUE (Rome), TUE (Maastricht)
Lisbonne ne fait qu’ammender (modifier les traités modificatifs) les autres traités, ainsi que
les traités modificatifs
Lisbonne apporte :
● la personnalité juridique de l’UE,
○ ratification des traités,
○ conclusion des traités,
● permet d’adhérer à la CEDH,
○ simplification du processus de décision au Conseil de l’UE,
● une présidence permanente au conseil européen,
● un haut représentant pour la politique étrangère européenne,
● le renforcement du rôle des parlements nationaux,
● la clarification de la répartition des compétences entre l’UE et les EM (énumère la
liste des compétences d’appui, partagée, exclusive),
● l'initiative citoyenne européenne (proposition à la commission européenne par les
citoyens, approbation d’un million de citoyens ressortissant d’un nb significatifs d’EM,
l’acte juridique doit être nécessaire à l’application des traités),
● confère une force juridique contraignante à la charte juridique des droits
fondamentaux,
● réaffirme les droits personnels des citoyens et résidents européens,
● BCE devient une véritable institution européenne,
● coopération judiciaire et policière au niveau des décisions, prise à la majorité (avant
à l’unanimité) ce qui facilite le processus,
● la lutte contre le changement climatique à un statut prioritaire dans le nouveau traité,
● Le traité prévoit une clause de sortie de l’UE (50 TUE).
- droit dérivé : RDD
règlement : portée générale, obligatoire dans tous ses éléments, directement applicables
dans tout état membre (288 TFUE)
directive : lie tout EM destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux
instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens
décision : obligatoire dans tous ces éléments, elle désigne des destinataires
décision judiciaire = arrêt et ordonnance
CJCE compétente pour statuer à titre préjudicielle sur
1° l’interprétation des traités
2° la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de
l’union
recours préjudiciel
la répartition des pouvoirs et des compétences :
- exclusives (3 TFUE) : s’applique aux domaines suivants (recopier l’article) 1°
l’établissement de règles de concurrence, 2° la politique monétaire 3° l’union
douanière, 4° la conservation des ressources biologique de la mer dans la politique
commune de la pêche 5° politique commerciale commune 6° la conclusion d’accord
internationaux sous certaines conditions
-
partagée (4 TFUE) : concerne les domaines dans lesquelles l’UE et les EM sont
invités à légiférer et adopter des actes contraignants, 13 politiques concernés : 1°
marché intérieur 2° la politique sociale pour les aspects défini précisément par les
traités 3° la politique régionale 4° l’agriculture et la pêche 5° l’environnement 6° la
protection des consommateurs 7° les transports 8° les réseaux transeuropéen 9°
l’énergie 10° l’espace de liberté, de sécurité et de justice 11° les enjeux communs de
sécurité en matière de santé publique 12° recherche, dev technologique et l’espace
13° coopération, développement et l’aide humanitaire
-
compétence complémentaire, coordination, appui (6 TFUE) ;: l’UE ne peut intervenir
que pour soutenir, coordonner ou compléter les actions des pays de l’UE, EM.
Ce
n’est PAS une harmonisation.
se rapport aux domaines politiques suivants : 1° la
protection et amélioration de la santé humaine 2° l’industrie, la culture, le tourisme,
éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport, la protection civile et la
coopération administrative.
La compétence de l’UE n’est pas directement liée au mode décision, qu’elle soit exclusive,
partagée ou complémentaire, elle peut faire intervenir des votes à majorité qualifiée ou
unanimité au conseil en fonction du type de décision.
II - Les principes transversaux du droit de l’UE
L’UE est fondée sur plusieurs grands principes :
- principe d’attribution = l’UE n’agit que dans les limites des compétences que les EM
lui ont attribuées afin d’atteindre les objectifs établis par les traités, toute compétence
non-attribuée par les traités appartient aux EM.
- principe de subsidiarité = dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, l’UE intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action
-
envisagé ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les EM tant au
niveau central qu’au niveau régional et local mais peuvent l’être mieux en raison des
dimension ou des effets de l’action envisagé au niveau de l’UE.
principe de proportionnalité = le contenu et la forme de l’action de l’UE n'excèdent
pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.
Les principes qualifiés de valeurs : les valeurs de l’article 2 du TUE eeeeeh copier coller
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, communes aux EM
arrêt ériger en tant que principe pour la dignité humaine dans l’arrêt 21 dec 2011, CJCE, NS
contre secretary of state for home department
I - liberté de circulation des
marchandises dans l’espace européen
marchandise art 28 et 29 du TFUE : tout bien appréciable en argent et susceptible de faire
l’objet d’une transaction commerciale
JP : 2 par sous parties
(CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos) :
CJCE 1992 Delhaiz (??) frères : on peut préciser que ça fonctionne aussi pour justifier l’effet
directe
A - les obstacles tarifaires : les taxes d’effet équivalent à des droits de douanes
1.
la notion de TEED
art 30 du TFUE : interdiction
CJCE, 1962, commission contre luxembourg et belgique : TEED p-e considéré quelques
soit son appellation ou sa technique comme un droit unilatéralement imposé soit au moment
de l’importation ou ultérieurement, et qui, frappant spécifiquement un produit importé d’un
pays à l’exclusion du produit national similaire à pour résultat, en altérant son prix, d’avoir
ainsi sur la libre circulation des produits la même incidence qu’un droit de douane
CJCE 1975 Cadsky : une TEED p-e retenue même si elle n’est pas perçue au profit de l’état
CJCE 1969 Commission contre Italie, aff;24/68 : une charge pécuniaire, fut-elle minime,
unilatéralement imposée, quelque soit son appellation et sa technique qui frappe les
marchandises nationales ou étrangères franchissant la frontière, lorsqu’elle n’est pas un
droit de douane proprement dit, constitue une TEED au sens des article 9, 12, 13 et 16 du
traité, alors même qu’elle n’est pas perçue au profit de l’Etat, qu’elle n’exerce aucun effet
discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouve pas en concurrence avec
une production nationale”
2.
Le fait générateur de la taxe
Quel élément caractérise une TEED ?
- La frontière locale qui correspond à la séparation géographique entre les lieux de
production et les lieux de consommation des marchandises taxées.
CJCE, 1992, Legros : l’octroie de mer, cet octroie était perçu par des DOM TOM français,
sur les produits français et européen
CJCE, 1995, Simitzi : taxe ad valorem (taxe sur la valeur) = se dit d’une taxe ou d’un droit
de douane qui atteint à un bien proportionnellement à sa valeur.
En l’espèce, elle s'applique
à l’importation et l’exportation
- la situation intérieure qui correspond à une spécificité du territoire avec un statut
spécial par rapport à la métropole ou à une origine historique.
CJCE 2004, Comune di Carrara : Une taxe perçue dans une commune frappant une
catégorie de marchandises, en raison de leur transport, au-delà des limites territoriales
communales constitue une TEED à l’exportation (origine historique)
spécificité du territoire : confirmation de Comune di Carrara avec CJCE, 2005, Jersey
marketing : concerne des taxes perçues sur les livraisons de pommes de terre produite à
Jersey en direction de Grande Bretagne dite continentale, qualifiée de TEED
3.
l’objet de la taxe
La taxe est de nature pécuniaire, c’est le critère 1er de définition donnée par la CJUE.
C’est
le critère qui différencie également les TEED des MEERQ (mesure d’effet équivalent à des
restrictions quantitative)
Le montant de la taxe importe peu, la taxe conduit mécaniquement à un renchérissement du
coût du produit, aussi minime soit-il, sur le marché de consommation.
CJCE, 1977, Bauhuis : Ce point là suffit à condamner la taxe litigieuse, même
sans effet discriminatoire à l’égard du produit.
⇒ même sans effet
discriminatoire (la notion de non discriminatoire est fondamentale en droit de
l’UE)
CJCE, 1969, Commission contre Italie, aff.24/28 : la TEED est condamnée plus en
fonction de son objet que de ses effets, de par son existence, elle constitue un frein à la libre
circulation des marchandises = illicite.
La différence avec les MEERQ a été énoncé par la CJCE depuis l’arrêt 1993, Keck (KEK ?)
et mithouard : énonce le critère supposant l’existence d’un minimum d’incidence restrictive
sur les échanges intra communautaire.
4.
La distinction entre le TEED et certaines mesures spécifiques (les exceptions)
3 exceptions :
- 1° : lorsque la charge constitue la contrepartie d’un service rendu (ex : tout ce qui est
de l’ordre du sanitaire ??)
- 2° lorsque la charge est liée par un contrôle prévu par le droit de l’UE
- 3° lorsque la taxe relève d’un système général d’imposition intérieur, selon des
critères objectifs....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Kant, Métaphysique des mœurs (Première partie: «Doctrine du droit»)
- Emmanuel KANT, Métaphysique des moeurs, 1" partie : « Doctrine du droit... ».
- Qui ne voit que la cohésion sociale est due, en grande partie, à la nécessité pour une société de se défendre contre d'autres, et que c'est d'abord contre tous les autres hommes qu'on aime les hommes avec lesquels on vit ?
- Qui ne voit que la cohésion sociale est due, en grande partie, à la nécessité pour une société de se défendre contre d'autres, et que c'est d'abord contre tous les autres hommes qu'on aime les hommes avec lesquels on vit?
- Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs, Première partie : Doctrine du droit.