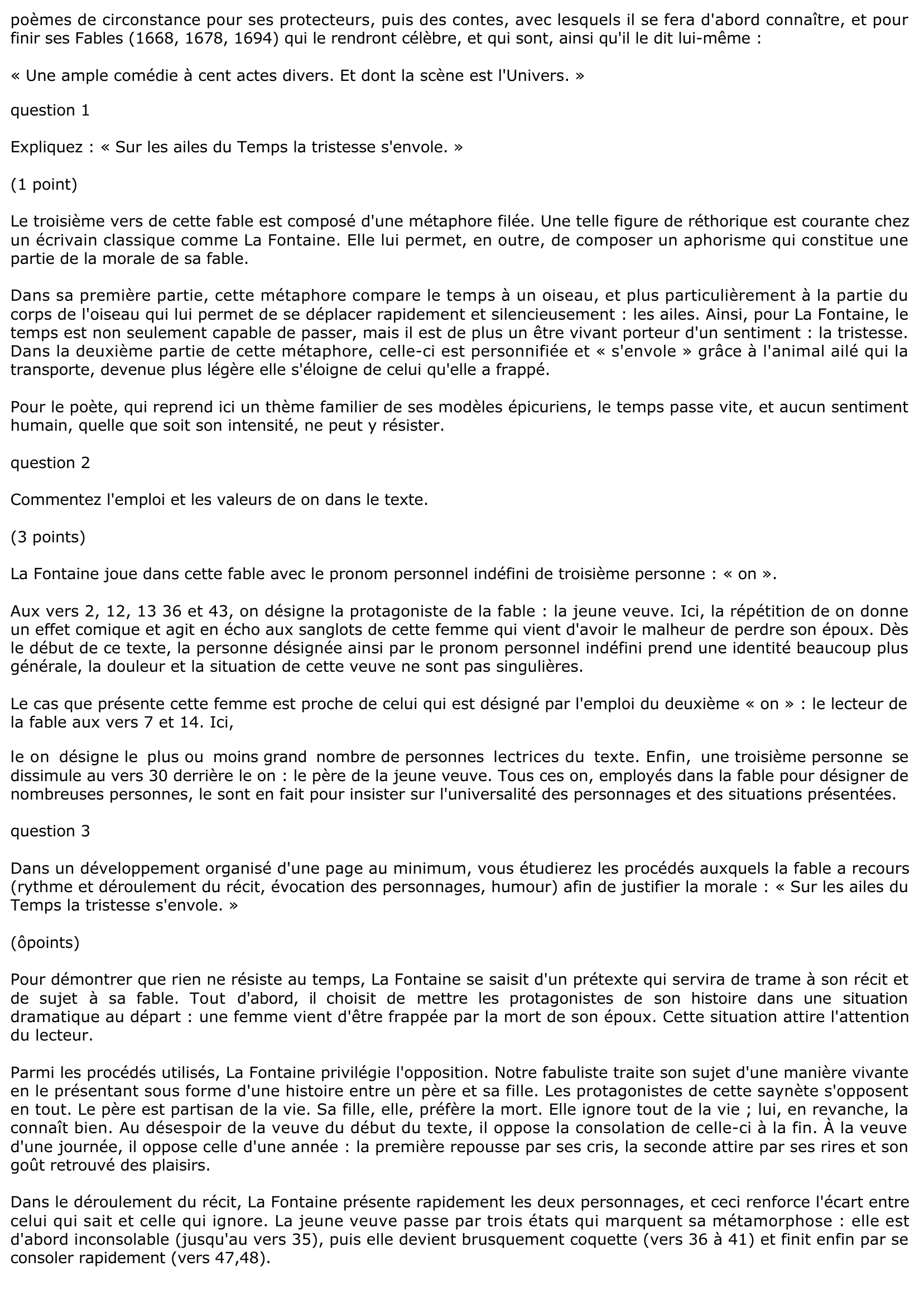LA JEUNE VEUVE - La Fontaine, Fables, Livre VI, 21
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
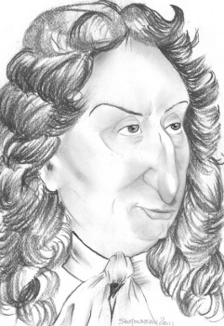
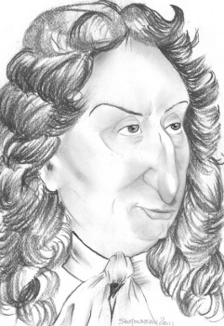
«
poèmes de circonstance pour ses protecteurs, puis des contes, avec lesquels il se fera d'abord connaître, et pourfinir ses Fables (1668, 1678, 1694) qui le rendront célèbre, et qui sont, ainsi qu'il le dit lui-même :
« Une ample comédie à cent actes divers.
Et dont la scène est l'Univers.
»
question 1
Expliquez : « Sur les ailes du Temps la tristesse s'envole.
»
(1 point)
Le troisième vers de cette fable est composé d'une métaphore filée.
Une telle figure de réthorique est courante chezun écrivain classique comme La Fontaine.
Elle lui permet, en outre, de composer un aphorisme qui constitue unepartie de la morale de sa fable.
Dans sa première partie, cette métaphore compare le temps à un oiseau, et plus particulièrement à la partie ducorps de l'oiseau qui lui permet de se déplacer rapidement et silencieusement : les ailes.
Ainsi, pour La Fontaine, letemps est non seulement capable de passer, mais il est de plus un être vivant porteur d'un sentiment : la tristesse.Dans la deuxième partie de cette métaphore, celle-ci est personnifiée et « s'envole » grâce à l'animal ailé qui latransporte, devenue plus légère elle s'éloigne de celui qu'elle a frappé.
Pour le poète, qui reprend ici un thème familier de ses modèles épicuriens, le temps passe vite, et aucun sentimenthumain, quelle que soit son intensité, ne peut y résister.
question 2
Commentez l'emploi et les valeurs de on dans le texte.
(3 points)
La Fontaine joue dans cette fable avec le pronom personnel indéfini de troisième personne : « on ».
Aux vers 2, 12, 13 36 et 43, on désigne la protagoniste de la fable : la jeune veuve.
Ici, la répétition de on donneun effet comique et agit en écho aux sanglots de cette femme qui vient d'avoir le malheur de perdre son époux.
Dèsle début de ce texte, la personne désignée ainsi par le pronom personnel indéfini prend une identité beaucoup plusgénérale, la douleur et la situation de cette veuve ne sont pas singulières.
Le cas que présente cette femme est proche de celui qui est désigné par l'emploi du deuxième « on » : le lecteur dela fable aux vers 7 et 14.
Ici,
le on désigne le plus ou moins grand nombre de personnes lectrices du texte.
Enfin, une troisième personne sedissimule au vers 30 derrière le on : le père de la jeune veuve.
Tous ces on, employés dans la fable pour désigner denombreuses personnes, le sont en fait pour insister sur l'universalité des personnages et des situations présentées.
question 3
Dans un développement organisé d'une page au minimum, vous étudierez les procédés auxquels la fable a recours(rythme et déroulement du récit, évocation des personnages, humour) afin de justifier la morale : « Sur les ailes duTemps la tristesse s'envole.
»
(ôpoints)
Pour démontrer que rien ne résiste au temps, La Fontaine se saisit d'un prétexte qui servira de trame à son récit etde sujet à sa fable.
Tout d'abord, il choisit de mettre les protagonistes de son histoire dans une situationdramatique au départ : une femme vient d'être frappée par la mort de son époux.
Cette situation attire l'attentiondu lecteur.
Parmi les procédés utilisés, La Fontaine privilégie l'opposition.
Notre fabuliste traite son sujet d'une manière vivanteen le présentant sous forme d'une histoire entre un père et sa fille.
Les protagonistes de cette saynète s'opposenten tout.
Le père est partisan de la vie.
Sa fille, elle, préfère la mort.
Elle ignore tout de la vie ; lui, en revanche, laconnaît bien.
Au désespoir de la veuve du début du texte, il oppose la consolation de celle-ci à la fin.
À la veuved'une journée, il oppose celle d'une année : la première repousse par ses cris, la seconde attire par ses rires et songoût retrouvé des plaisirs.
Dans le déroulement du récit, La Fontaine présente rapidement les deux personnages, et ceci renforce l'écart entrecelui qui sait et celle qui ignore.
La jeune veuve passe par trois états qui marquent sa métamorphose : elle estd'abord inconsolable (jusqu'au vers 35), puis elle devient brusquement coquette (vers 36 à 41) et finit enfin par seconsoler rapidement (vers 47,48)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA JEUNE VEUVE (FABLES DE LA FONTAINE) - COMMENTAIRE
- Dissertation Fables de La Fontaine (livre VII)
- Fiche lecture Fables de La Fontaine, livre 7, résumé
- Fiche de lecture: Les Fables de La Fontaine (livre par livre)
- Fables livre 7 Jean de la fontaine résumés + Morales