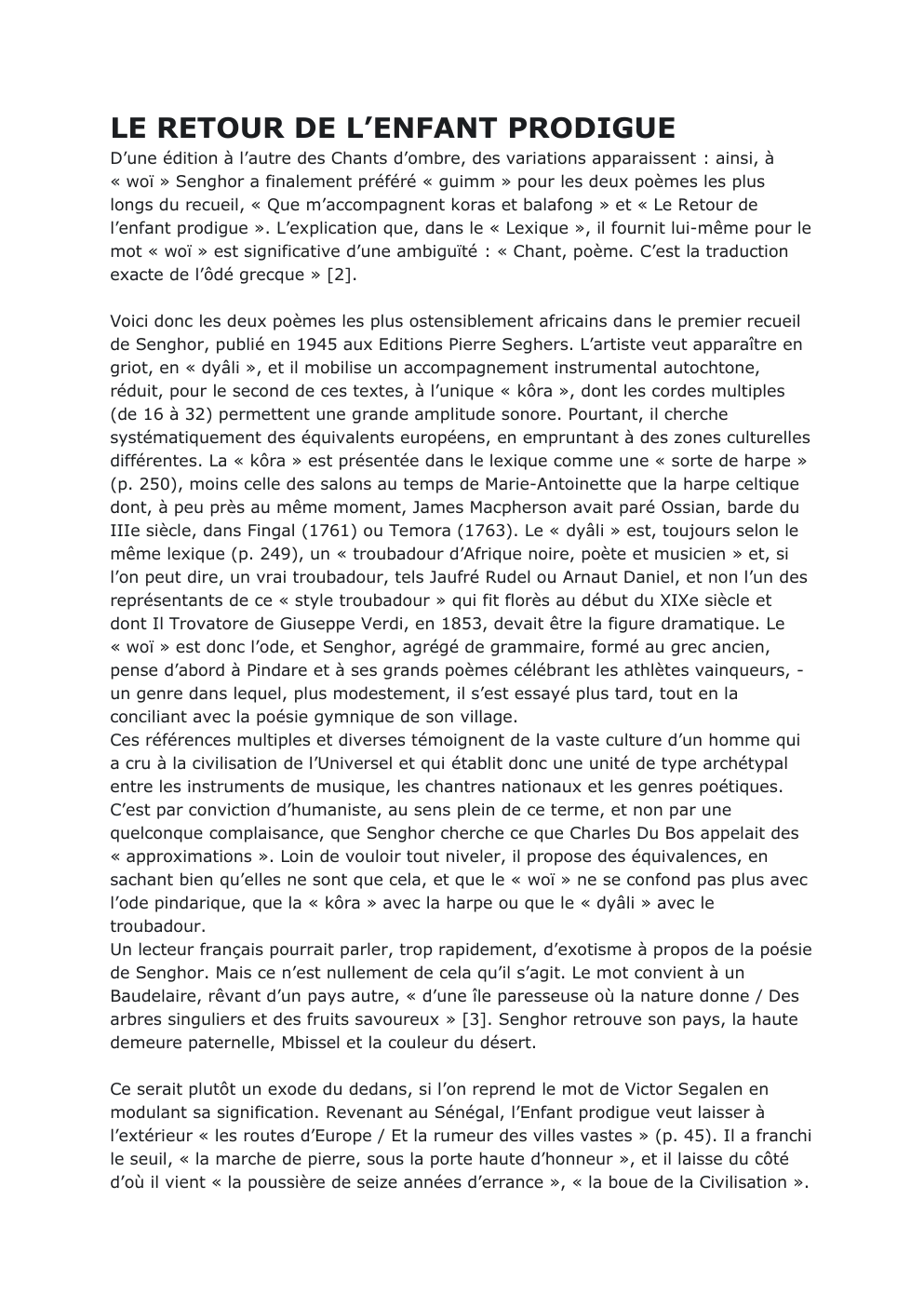EXPOSE SUR LE POEME RETOUR DE L'ENFANT PRODIGUE
Publié le 12/05/2023
Extrait du document
«
LE RETOUR DE L’ENFANT PRODIGUE
D’une édition à l’autre des Chants d’ombre, des variations apparaissent : ainsi, à
« woï » Senghor a finalement préféré « guimm » pour les deux poèmes les plus
longs du recueil, « Que m’accompagnent koras et balafong » et « Le Retour de
l’enfant prodigue ».
L’explication que, dans le « Lexique », il fournit lui-même pour le
mot « woï » est significative d’une ambiguïté : « Chant, poème.
C’est la traduction
exacte de l’ôdé grecque » [2].
Voici donc les deux poèmes les plus ostensiblement africains dans le premier recueil
de Senghor, publié en 1945 aux Editions Pierre Seghers.
L’artiste veut apparaître en
griot, en « dyâli », et il mobilise un accompagnement instrumental autochtone,
réduit, pour le second de ces textes, à l’unique « kôra », dont les cordes multiples
(de 16 à 32) permettent une grande amplitude sonore.
Pourtant, il cherche
systématiquement des équivalents européens, en empruntant à des zones culturelles
différentes.
La « kôra » est présentée dans le lexique comme une « sorte de harpe »
(p.
250), moins celle des salons au temps de Marie-Antoinette que la harpe celtique
dont, à peu près au même moment, James Macpherson avait paré Ossian, barde du
IIIe siècle, dans Fingal (1761) ou Temora (1763).
Le « dyâli » est, toujours selon le
même lexique (p.
249), un « troubadour d’Afrique noire, poète et musicien » et, si
l’on peut dire, un vrai troubadour, tels Jaufré Rudel ou Arnaut Daniel, et non l’un des
représentants de ce « style troubadour » qui fit florès au début du XIXe siècle et
dont Il Trovatore de Giuseppe Verdi, en 1853, devait être la figure dramatique.
Le
« woï » est donc l’ode, et Senghor, agrégé de grammaire, formé au grec ancien,
pense d’abord à Pindare et à ses grands poèmes célébrant les athlètes vainqueurs, un genre dans lequel, plus modestement, il s’est essayé plus tard, tout en la
conciliant avec la poésie gymnique de son village.
Ces références multiples et diverses témoignent de la vaste culture d’un homme qui
a cru à la civilisation de l’Universel et qui établit donc une unité de type archétypal
entre les instruments de musique, les chantres nationaux et les genres poétiques.
C’est par conviction d’humaniste, au sens plein de ce terme, et non par une
quelconque complaisance, que Senghor cherche ce que Charles Du Bos appelait des
« approximations ».
Loin de vouloir tout niveler, il propose des équivalences, en
sachant bien qu’elles ne sont que cela, et que le « woï » ne se confond pas plus avec
l’ode pindarique, que la « kôra » avec la harpe ou que le « dyâli » avec le
troubadour.
Un lecteur français pourrait parler, trop rapidement, d’exotisme à propos de la poésie
de Senghor.
Mais ce n’est nullement de cela qu’il s’agit.
Le mot convient à un
Baudelaire, rêvant d’un pays autre, « d’une île paresseuse où la nature donne / Des
arbres singuliers et des fruits savoureux » [3].
Senghor retrouve son pays, la haute
demeure paternelle, Mbissel et la couleur du désert.
Ce serait plutôt un exode du dedans, si l’on reprend le mot de Victor Segalen en
modulant sa signification.
Revenant au Sénégal, l’Enfant prodigue veut laisser à
l’extérieur « les routes d’Europe / Et la rumeur des villes vastes » (p.
45).
Il a franchi
le seuil, « la marche de pierre, sous la porte haute d’honneur », et il laisse du côté
d’où il vient « la poussière de seize années d’errance », « la boue de la Civilisation ».
Il devrait laisser aussi ce qu’il a appris, réduit de manière caricaturale dans « Le
Message » à la déclinaison de rosa et à « (N)os Ancêtres les Gaulois » (p.
17).
Or
peut-il faire, en 1944-45, comme si ces seize années étaient rayées de son
existence ? [4] Certes, il est rentré au Sénégal, mais titulaire d’une bourse du CNRS
qui lui permet de travailler à ses thèses pour le doctorat, le dernier diplôme français
à acquérir.
Sa tête, qu’il imagine « vide d’idées », est pourtant pleine de notions
acquises dont certaines passent dans le lexique : ode, harpe, troubadour...
Le titre même donné au « woï », « Le Retour de l’Enfant prodigue », ajoute à
l’ambiguïté fondamentale.
Senghor ne va pas chercher dans la tradition africaine la
figure de Chaka ou du Kaya-Magan, comme il le fera dans Ethiopiques, en 1956,
« sur fond sonore de tam-tam funèbre » (p.
116), ou dans un autre « woï pour
kôra » (p.
101).
Il emprunte à la Bible celle de l’Enfant prodigue, se référant à la
célèbre parabole qui n’est présente que dans l’un des Evangiles, celui de saint Luc
(XV, 11-32).
On ne change pas de religion comme on se transporte d’un continent à
un autre.
Particulièrement difficile est la conciliation que Senghor a voulu opérer en
lui entre l’animisme et le culte des Ancêtres dans lequel l’a élevé son oncle maternel
Tokô’ Waly et le catholicisme auquel il est toujours resté fidèle depuis sa formation
dans l’école chrétienne de Ngasobil.
A l’oncle Waly, le gardien du Royaume
d’Enfance, celui qui savait « écout(er) l’inaudible » et « expliqu(er) les signes que
disent les Ancêtres dans la sérénité marine des constellations », il rend hommage
dans la section IX de « Que m’accompagnent kôras et balafong » (p.
34).
Mais il se
souvient aussi, dans la deuxième section, du « curé noir dansant / Et sautant comme
le Psalmiste devant l’Arche de Dieu » (p.
27), et « Neige sur Paris », invocation au
« Seigneur » Jésus-Christ, un jour de Noël, s’organise autour de la parole
évangélique « Paix aux Hommes de bonne volonté » (p.
19), (celle-là même
qu’André Gide et Jean-Louis Barrault feront lire par le Joseph K..de Franz Kafka dans
leur adaptation scénique du Procès, en 19474 [5]).
Nul esprit de dérision à cet
égard, chez Senghor, dont la foi chrétienne a toujours été vive.
Mais, « sur les
marches de la haute demeure », il ne se prosterne pas devant Dieu, comme à
l’église : il « (s’) allonge à terre (aux) pieds » des Ancêtres, des « Ancêtres présents,
qui domin(ent) fiers la grand-salle de tous (leurs) masques qui défient le Temps ».
Nulle part pourtant l’ambiguïté de l’expression n’est plus sensible que dans la
quatrième section du poème où s’accentue ce geste de respect.
La civilisation
africaine est bien présente, avec les masques auxquels sont consacrés d’autres
poèmes des Chants d’ombre (« Masque nègre », « Prière aux masques »).
Mais si
l’apostrophe « mes Pères » s’adresse aux Ancêtres de la famille, la réminiscence de
l’Odyssée est mieux qu’implicite dans l’ordre donné à une autre Euryclée lavant les
pieds d’Ulysse à son retour en Ithaque :
« Servante fidèle de mon enfance, voici mes pieds où colle la boue de la
Civilisation » [6]
Cette servante, il est inutile de la voir, ici, maintenant, en chair et en os.
Elle est une
ombre du passé, et pourtant elle est présente comme si elle était vivante.
Et c’est là
sans doute l’un des traits les plus forts de l’ « africanité » de Senghor : aux
distinctions européennes trop tranchées, la vie et la mort par exemple, il préfère une
continuité, et même une conciliation des contraires, que « Nuit de Sine », dans le
même recueil des Chants d’ombre, exprime parfaitement, à la faveur d’une
apostrophe lancée à celle qui est à la fois la Servante, et la Mère, et l’Épouse, et
surtout l’Afrique personnifiée :
« Femme, allume la lampe au beurre clair, que causent autour les Ancêtres comme
les parents, les enfants au lit.
Ecoutons la voix des Anciens d’Elissa.
Comme nous exilés Ils n’ont pas
voulu mourir, que se perdît par les sables leur torrent séminal » (p.12-13).
On se rend compte plus nettement encore que retour doit être pris dans un double
sens.
C’est bien un retour au pays natal, comme dans le roman de Thomas Hardy
The Return of the Native.
Mais il va de pair avec le retour vers un passé qui doit
plutôt être conçu comme un éternel présent.
Certes, un « jadis » est inscrit dans la
deuxième section du texte, la plus bucolique, des visions qui pourraient être
nostalgiques sont exprimées à l’imparfait, mais tout doit être ressuscité (section VII).
Bien plus, et bien mieux, tout est déjà là, encore là : les ancêtres Guelwârs, les rois
de l’ancien royaume de Sine, la « théorie [7] des servantes », « les grandes
calebasses de lait », « la caravane des ânes et dromadaires ».
On imagine sans peine une continuité dans l’ordre des usages rustiques ; ou encore
celle qui existe dans l’ordre naturel (« Chassent les crocodiles dans la brousse des
profondeurs [8] et paissent en paix les vaches marines ! » [9]).
Mais c’est d’une
continuité bien plus profonde qu’il s’agit, et beaucoup plus surprenante pour le
lecteur européen :....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'enfant prodigue (Saint-Luc)
- ÉCOLE FLAMANDE : L'Enfant prodigue chez les courtisanes (analyse du tableau).
- Enfant prodigue (l'), personnage d'une parabole de l'Évangile (Luc, XV, 11-32).
- L'Enfant prodigue de RUBENS
- Raconter la parabole de l'enfant prodigue et en expliquer le sens suivant les intentions du Sauveur