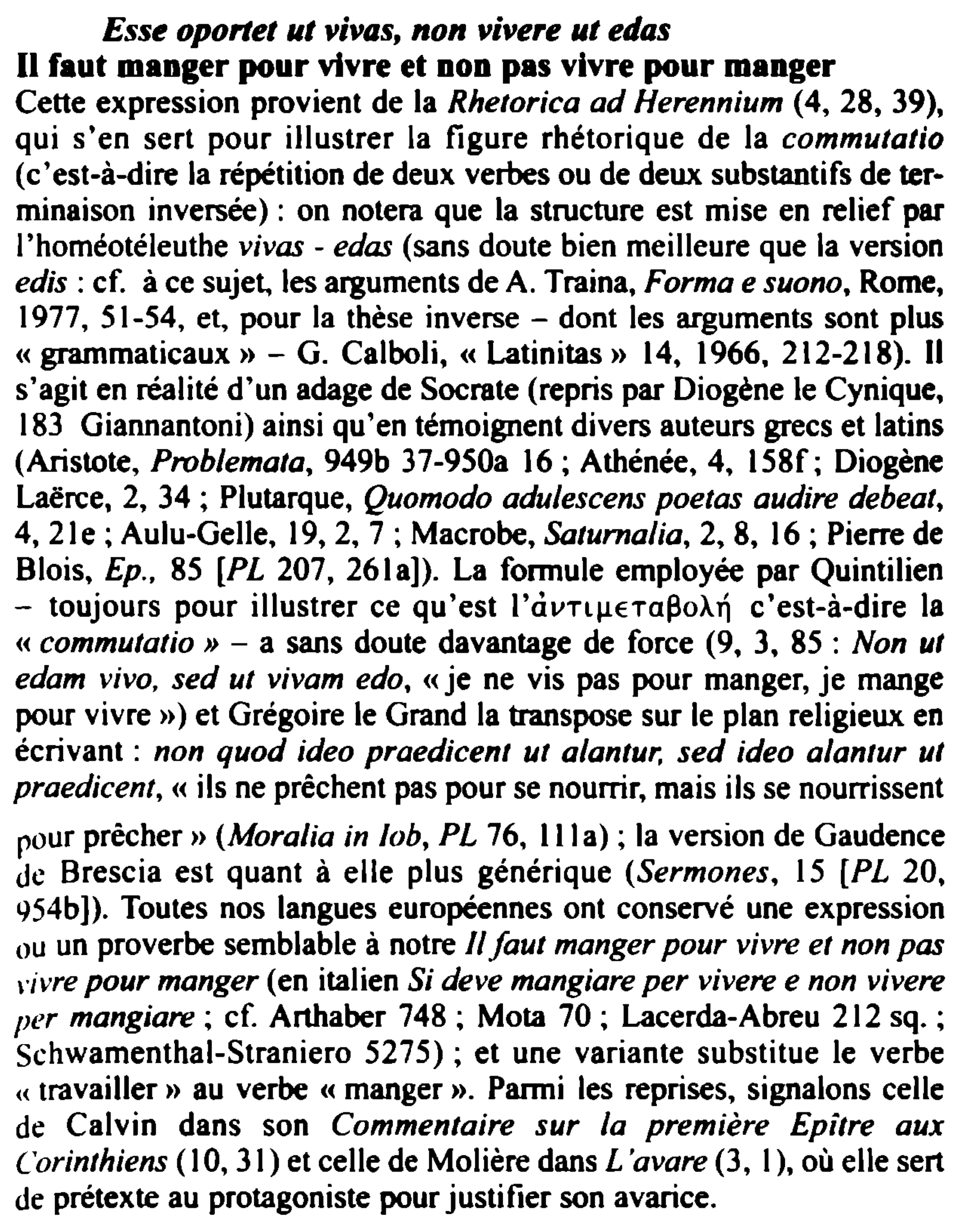Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas
Publié le 14/02/2022
Extrait du document
«
Ess~ oportet ut vivas, non vivere 111 edas
Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger
Cette expression provient de la Rhetorica ad Herennium (4, 28, 39),
qui s'en sert pour illustrer la figure rhétorique de la commutatio
(c'est-à-dire la répétition de deux verbes ou de deux substantifs de terminaison inversée): on notera que la structure est mise en relief par
l 'homéotéleuthe vivas - edas (sans doute bien meilleure que la version
edis : cf.
à ce sujet, les arguments de A.
Traina, Forma e suono, Rome,
1977, 51-54, et, pour la thèse inverse - dont les arguments sont plus
> - G.
Calboli, > 14, 1966, 212-218).
Il
s'agit en réalité d'un adage de Socrate (repris par Diogène le Cynique,
183 Giannantoni) ainsi qu'en témoignent divers auteurs grecs et latins
(Aristote, Prob/emata, 949b 37-9S0a 16; Athénée, 4, 158f; Diogène
Laërce, 2, 34 ; Plutarque, Quomodo adu/escens poetas audire debeat,
4, 21 e ; Aulu-Gelle..
19, 2, 7 ; Macrobe, Saturnalia, 2, 8, 16 ; Pie11e de
Blois, Ep., 85 [PL 207, 261 a]).
La fo111aule employée par Quintilien
- toujours pour illustrer ce qu'est l'àvTLµeTa~oÀ~ c'est-à-dire la
> - a sans doute davantage de force (9, 3, 85 : Non ut
edam vivo, sed ut vivam edo, >) et Grégoire le Grand la transpose sur le plan religieux en
écrivant : non quod ideo praedicent ut alantur, sed ideo alantur ut
praedicent, > {Moralia in Job, Pl 16, 111 a) ; la version de Gaudence
de Brescia est quant à elle plus générique (Sermones, 15 [PL 20,
954b)).
Toutes nos langues européennes ont conservé une expression
()U un proverbe semblable à notre //faut manger pour vivre et non pas
,·ivre pour manger (en italien Si deve mangiare per vivere e non vivere
/Jer mangiare ; cf.
Arthaber 748 ; Mota 70 ; Lacerda-Abreu 212 sq.
;
Schwamenthal-Straniero 5275) ; et une variante substitue le verbe
au verbe .
Parmi les reprises, signalons celle
de Calvin dans son Commentaire sur la première Epitre aux
l"orinthiens ( 10, 31) et celle de Molière dans l'avare (3, 1), où elle sert
de prétexte au protagoniste pour justifier son avarice..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Paupertatem certissimam esse, cum alicuius indigeas, uti eo nonposse
- Ad suom quemque hominem quaestum esse aequom est callidum
- Esse sibi similes alios fur iudicat omnes
- Boni pastoris esse tondere pecus, non deglubere
- Nihil esse utilius sale et sole