SAINT-DENYS GARNEAU Hector
Publié le 13/10/2018
Extrait du document
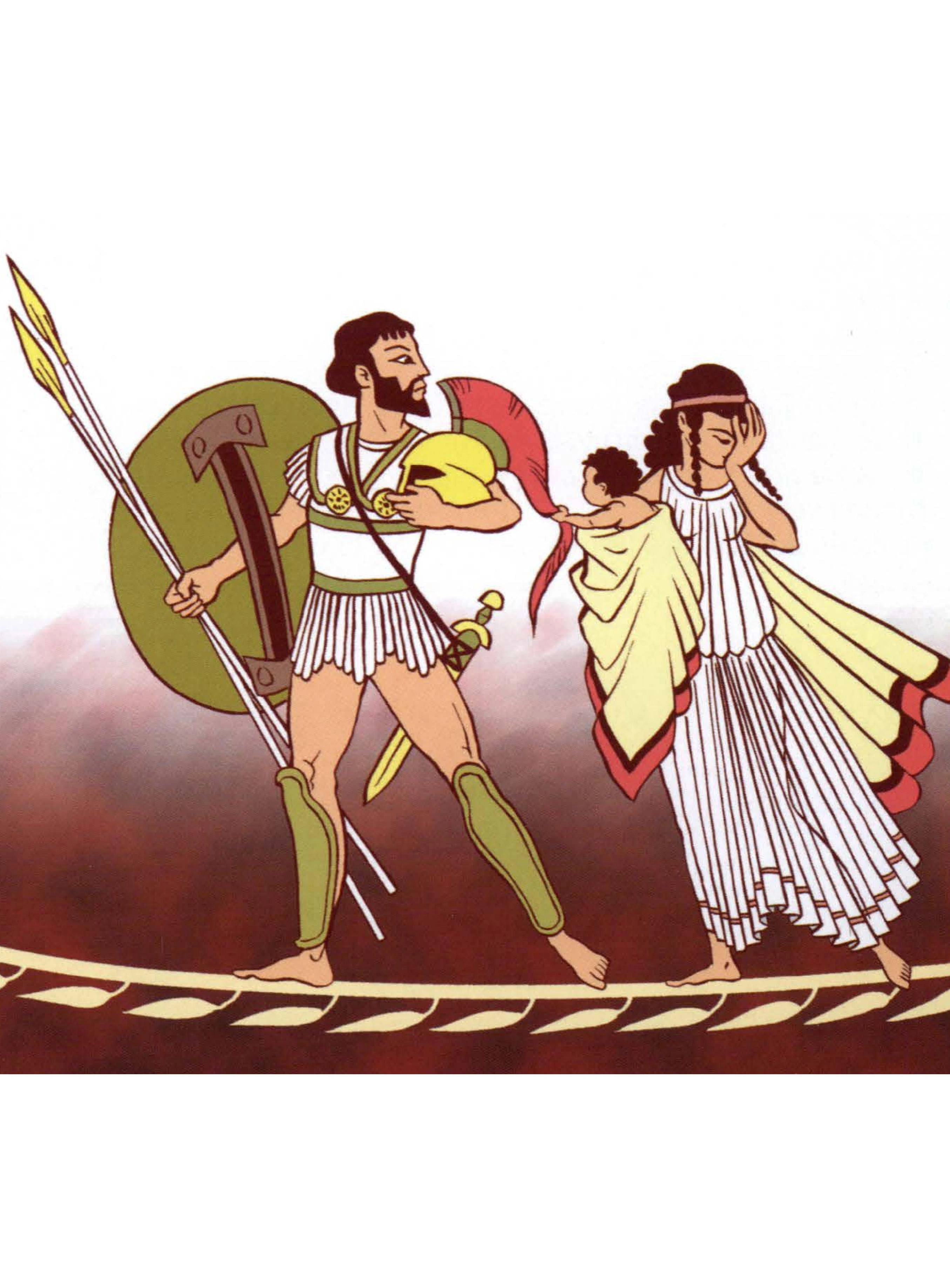
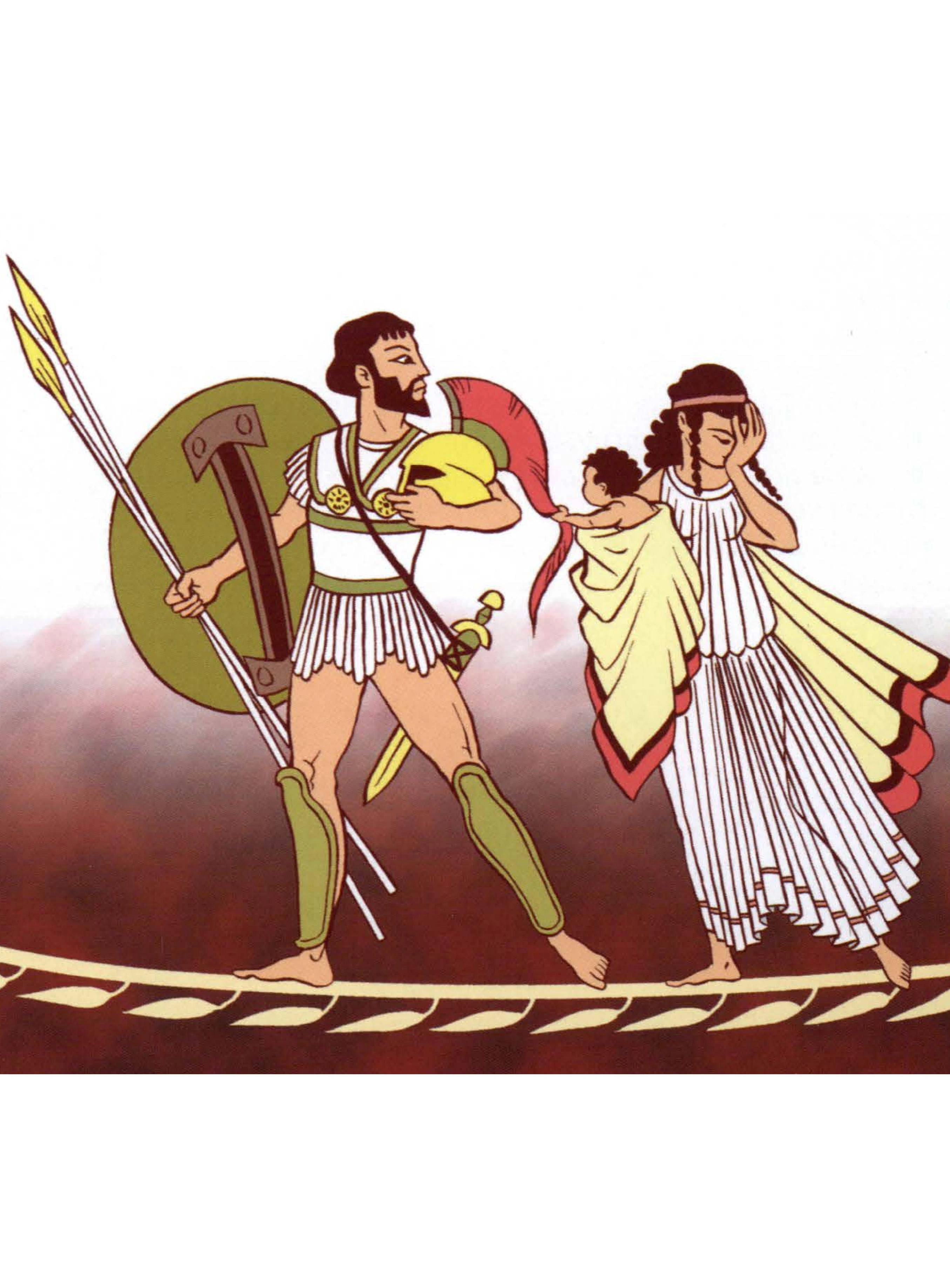
«
voix est fêlée [ ...
], le son n 'emplit plu s la forme » : lir e Sa int- Deny s Garneau, c 'es t e ntendr e à chaque instant
cette fêlur e, r essen tir cette inadéquation du langa ge qui
d evrait signifier la mo rt de la poé sie.
Loin du chan t , presque grin ça nt e, cette œuvre est
d 'abord l'élaboration d 'un e mylh ologie du suj et : s on régime dominant est celui d'u ne représentation assez
p r oche de la fable, réalisée dan s certains textes de prose comme «le Mauvais Pauvre », inséré dans Je Journal.
Ce sym bol e de J'étrange té et de la dépossessio n se déve
loppe jusqu'à l 'image inqu .i étante d'un être dont la colonne ve rté braJe est assaill ie à co ups de hache , et qui se trouve rédu it à « un seul tro nc vertic aJ, fran chem en t nu».
S'il fallait chercher ici de s pa rentés, c'est à R e mi Michaux que l 'on songerait, mais à un Michaux où ce serait moins la fable eUe -m ême qui s'im po serai t da ns
son insole nte absurdité, que le mouvement angoi ssé vers
elle, rendu plus app roximatif par la conscience analyti que qui l e traverse.
En ce sens , « le Mauvai s P a uvr e» est un texte clé; il définit un certain rapport au langage, caractérisé par une t ens ion entre l' ironie la plus profonde et une volont é de fig w·ation in tégra le du sujet, de ses enjeux existentiel s :inadéquation à soi; quête de tran spa
rence; cons cie nce de la mort.
ll y a chez Saint-De nys G arneau une insistance pres que panique dan s la rep résentation de soi, marqu ée for
melleme nt par des réitérations, p ar une syntaxe qui déve
l op pe l 'image sur un mode descriptif, avec une froid e
précisio n.
D e no mbreux poè mes de Rega rds et jeux dans l'espace rel èv ent de cette écriture, entre autres le célèbre « Accompagnement », devenu po ur plusieurs lecteur s la
figure idéale de J' aventure du poète :
Je ma rche à côté de moi en joie
J'enten ds mon pas en joie qui marche à côté de mo i
Ma is je ne peux chang er de place sur le trott oir Je ne puis pas mettr e mes pieds dans ce pas- là et dir e voil à, c'es t moi.
Mais une lecture psychologiqu e empêche de voi r que la représentati on se vit chez Saint-De nys Garneau comm e une crise : l'écritu re découvre qu 'elle a parti e liée avec la plac e vide du sujet; loin de com bler la diff é ren ce entre l e sujet de l 'énonc iatio n et celui de l'énon cé, elle la creuse irrémédiable m ent, dans un > ont soudain « soif de substan ce».
Saint -Deny s Garne au a été le premier poè te québécoi s à po uvo ir fanta sm er le langage e n ta nt que tel : son écri ture ne se met en bra r ùe que dan s cene
réflexi vüé, dan s une soif qui est la so if du désert , où le sujet se meur t d'être« so rti en plein air» .
On ne saurait trop insister sur le fait que ce mouv e
m e nt utilise en même temp s tout es les ressources du
di scours parl é, so uvent le plus fam iller.
Avant Ga ston Miron, dont les poèmes politiqu es de la Vie ago11iqu e portent la trace de 1" auteur de Regards et jeux dans l'es
pace, Sai nt- Denys Garneau a saisi la nécessité de «par
le r» dan s l 'éc riture, de transformer le mo no log ue poéti que en dialogue , en interpellation, même s'il y a que lque
c h ose de d ésespéré et d'inaccessible dans cette
fa miliarité.
On s'éton ne que la plupart de ses contemp orains
l ' aient ju gé obscur.
On compr e nd mieux qu e les poètes de la génération de 1 ' He xagone, en 1960 , aient préféré à cette proxim ité du dése spoir !.'ouverture cosmique des poèmes d'Alai n Grandbois.
Mai s la voix de Saint -D enys
Garn eau parle de ce qui ne vieillit pas : le sujet fab ul ant son desti n, cherchant à capter da ns une image la fo rm e de sa propre absence .
BIBLIOGRAPH1 E Édition .
- Œuvres, Montréal , P.U.M., « Bibliothèqu e des let tre s québ éco i ses», 1971 (texte établ i, anno té et pré senté par Jacques Brault et Benoit Lacroix ).
A con sulter.
- Études françaises, «Hommage à Saint- Den ys Garneau », novembre 1969, p.
455-488, et « Relire Saint-Denis Garneau», biver 1984-1985, p.
7-127; Jacques Blai s, Saint Den ys Garneau er le thème d'icare , Sherbrooke, Naaman, 1973;
Roland B oumeuf, Saint -D en ys Garn eau et ses lectur es eur opé
ennes, Qu ébec, P.U.L., 1969; Éva Ku shn er, Saint -D enys Gar nea u, P ari s, Seghers et Momr éal, Fidès, «Poètes d'au jourd'hui », 1967; Nicole Dur and -Lul< .y, Sai nt-D enys Gamea 1,.
La couleur de Die u, Montr éal, Fidès, 1981; P.
Popovic, «le Diff érend des dJscours dan s Rega rds et jeux dans l'espace », Voix et images n° 34, automne 1986; A.
Purd y, «Au seuil de la modernité: le jeu d'échec s de Saussure et le Jeu de Saint -D enys Garneau».
R evue romane, 1986-2: Georges Riser , CotJjonctiotl et disjonction dans la poésie de Saint -Denys Garneau, Ed.
Uni v.
Ottawa, 1984; R.
Vignea ult, Saint -Denys Garneau à travers «Rega rds et jeux dans l'espace», P .U.
Montréal, 1973.
P.
NEPVEU.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SAINT-DENYS GARNEAU Hector (vie et oeuvre)
- Cage D'oiseau Et O Tourments - Saint-Denys Garneau et Alain Grandbois
- A-t-on raison de penser que Saint-Denys Garneau et Alain Grandbois traitent, dans Cage d’oiseau et Ô tourments, le thème de la fatalité d’une façon similaire ? Discutez.
- La fatalité chez Saint-Denys Garneau et Grandbois
- A-t-on raison de penser que Saint-Denys Garneau et Émile Nelligan présentent, dans Cage d'oiseau et Les Corbeaux, une même vision de la fatalité ? Discutez.

































