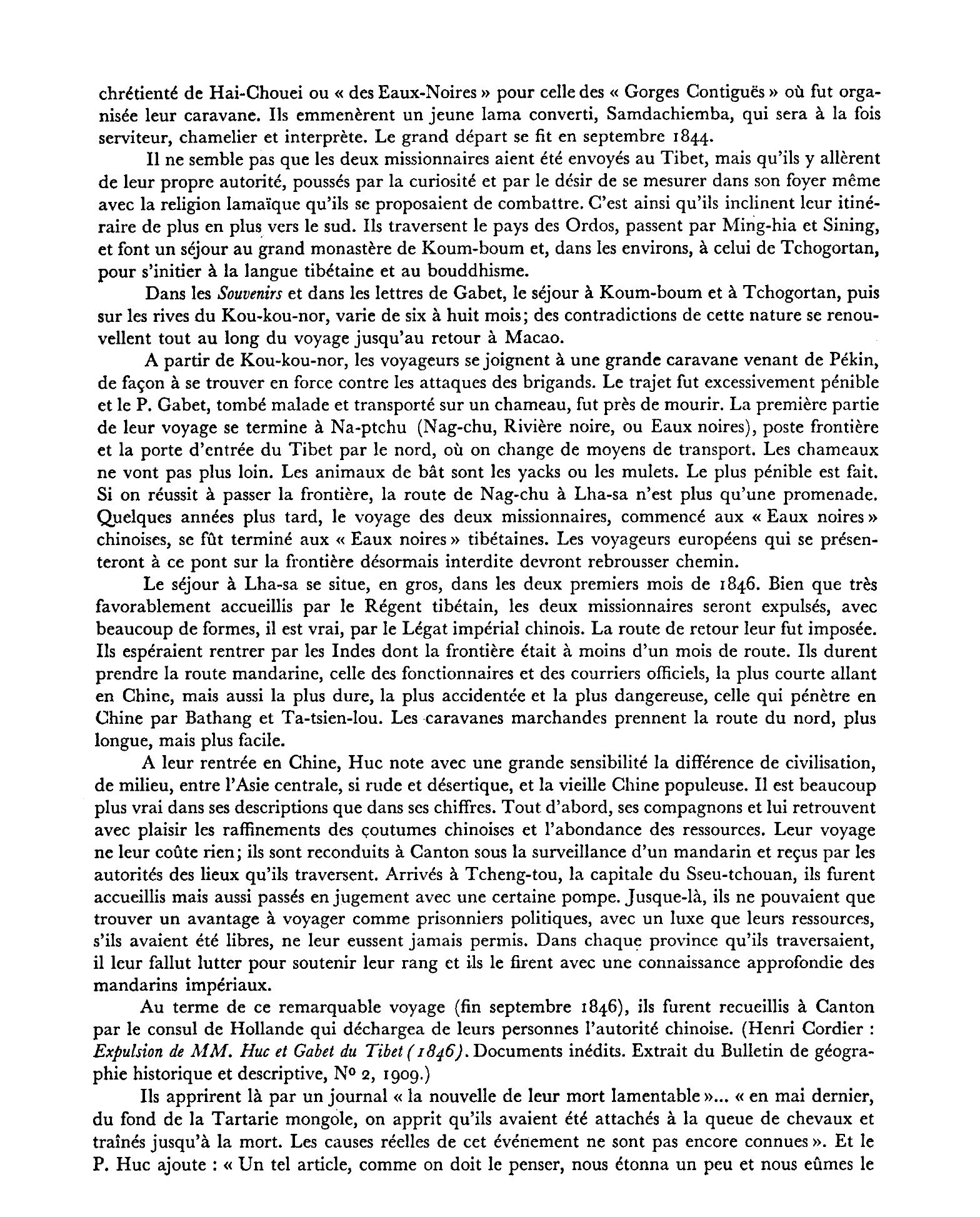LE PÈRE HUC
Publié le 25/04/2012
Extrait du document
Quant aux critiques de l'explorateur russe Prjevalskii, elles ne sont pas à retenir. Elles étonnent de la part d'un homme si épris de précision. Le prince Henri d'Orléans en a fait facilement justice dans une brochure intitulée : Le Père Huc et ses critiques (Calmann-Lévy, 1893). Il avait pu constater, lors de son voyage de 1889 avec Bonvalot, que le P. Huc avait une mémoire fidèle des lieux et que ce qu'on désigne par« route« en Asie centrale n'est pas une ligne unique, mais un très vaste réseau de pistes éloignées les unes des autres et où Prjevalskii avait fort mauvaise grâce, sinon mauvaise foi, à ne pas reconnaître les descriptions de Huc ....
«
chrétienté de Hai-Chouei ou« des Eaux-Noires» pour celle des« Gorges Contiguës» où fut orga
nisée leur caravane.
Ils emmenèrent
un jeune lama converti, Samdachiemba, qui sera à la fois
serviteur, chamelier et interprète.
Le grand départ se fit en septembre 18.1-4.
Il ne semble pas que les deux missionnaires aient été envoyés au Tibet, mais qu'ils y allèrent
de leur propre autorité, poussés par la curiosité et par le désir de se mesurer dans son foyer même
avec la religion Jamaïque qu'ils
se proposaient de combattre.
C'est ainsi qu'ils inclinent leur itiné
raire de plus en plus vers le sud.
Ils traversent le pays des Ordos, passent
par Ming-hia et Sining,
et font un séjour au grand monastère de Koum-boum et, dans les environs, à celui de Tchogortan,
pour s'initier à la langue tibétaine et au bouddhisme.
Dans les
Souvenirs et dans les lettres de Gabet, le séjour à Koum-boum et à Tchogortan, puis
sur les rives du Kou-kou-nor, varie de six à huit mois; des contradictions de cette nature se renou
vellent
tout au long du voyage jusqu'au retour à Macao.
A
partir de Kou-kou-nor, les voyageurs se joignent à une grande caravane venant de Pékin,
de façon à se trouver en force contre les attaques des brigands.
Le trajet fut excessivement pénible
et le P.
Gabet, tombé malade et transporté sur un chameau, fut près de mourir.
La première partie
de leur voyage se termine à Na-ptchu (Nag-chu, Rivière noire, ou Eaux noires), poste frontière
et la porte d'entrée du Tibet par le nord, où on change de moyens de transport.
Les chameaux
ne vont pas plus loin.
Les animaux de
bât sont les yacks ou les mulets.
Le plus pénible est fait.
Si
on réussit à passer la frontière, la route de Nag-chu à Lha-sa n'est plus qu'une promenade.
Quelques années plus tard, le voyage des deux missionnaires, commencé aux
«Eaux noires»
chinoises, se fût terminé aux « Eaux noires» tibétaines.
Les voyageurs européens qui se présen
teront à ce
pont sur la frontière désormais interdite devront rebrousser chemin.
Le séjour à Lha-sa
se situe, en gros, dans les deux premiers mois de 1846.
Bien que très
favorablement accueillis
par le Régent tibétain, les deux missionnaires seront expulsés, avec
beaucoup
de formes, il est vrai, par le Légat impérial chinois.
La route de retour leur fut imposée.
Ils espéraient rentrer
par les Indes dont la frontière était à moins d'un mois de route.
Ils durent
prendre la route mandarine, celle des fonctionnaires et des courriers officiels, la plus courte allant
en Chine, mais aussi la plus dure, la plus accidentée et la plus dangereuse, celle
qui pénètre en
Chine par Bathang et Ta-tsien-lou.
Les caravanes marchandes prennent la route du nord, plus
longue, mais plus facile.
A leur rentrée en Chine,
Huc note avec une grande sensibilité la différence de civilisation,
de milieu, entre l'Asie centrale, si rude et désertique, et la vieille Chine populeuse.
Il est beaucoup
plus vrai dans
ses descriptions que dans ses chiffres.
Tout d'abord, ses compagnons et lui retrouvent
avec plaisir les raffinements des çoutumes chinoises
et l'abondance des ressources.
Leur voyage
ne leur coûte rien;
ils sont reconduits à Canton sous la surveillance d'un mandarin et reçus par les
autorités des lieux qu'ils traversent.
Arrivés à Tcheng-tou, la capitale
du Sseu-tchouan, ils furent
accueillis mais aussi passés en
jugement avec une certaine pompe.
Jusque-là, ils ne pouvaient que
trouver
un avantage à voyager comme prisonniers politiques, avec un luxe que leurs ressourœs,
s'ils avaient été libres, ne leur eussent jamais permis.
Dans chaque province qu'ils traversaient,
il leur fallut lutter pour soutenir leur rang et ils le firent avec une connaissance approfondie des
mandarins impériaux.
Au terme
de ce remarquable voyage (fin septembre 1846), ils furent recueillis à Canton
par le consul de Hollande qui déchargea de leurs personnes l'autorité chinoise.
(Henri Cordier :
Expulsion de lvfM.
Huc et Cabet du Tibet ( 1846).
Documents inédits.
Extrait du Bulletin de géogra
phie historique
et descriptive, N° 2, 1909.)
Ils apprirent là par un journal « la nouvelle de leur mort lamentable» ...
« en mai dernier,
du fond de la Tartarie mongole, on apprit qu'ils avaient été attachés à la queue de chevaux et
traînés
jusqu'à la mort.
Les causes réelles de cet événement ne sont pas encore connues».
Et le
P.
Huc ajoute : «Un tel article, comme on doit le penser, nous étonna un peu et nous eûmes le
201.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le père Goriot: compte rendu de lecture
- critique film tel père tel fils
- Le père Goriot : analyse de la 1ère partie du roman
- Analyse Le père Goriot
- Le personnage d'ATHOS d’Alexandre Dumas père