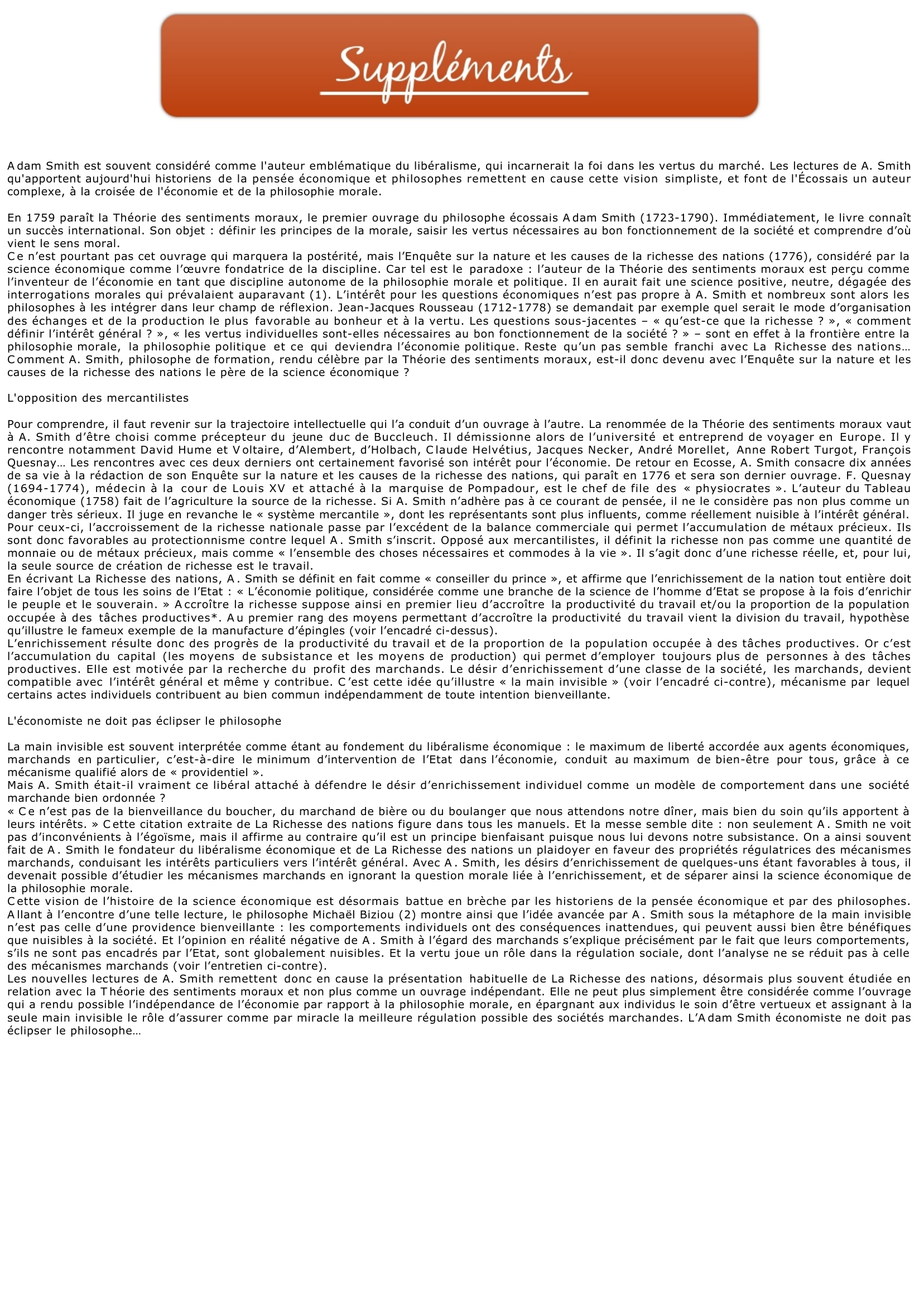La vie d'Adam Smith
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
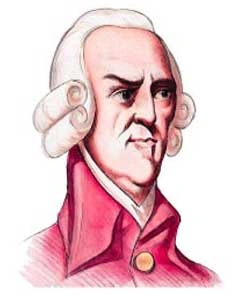
C'est à Kirkcaldy, dans le comté de Fife, en Écosse, qu'est né Adam Smith, le 5 juin 1723 (si du moins l'on peut penser que la date de son baptême est celle de sa naissance), quelques mois après la mort de son père. Celui-ci était contrôleur des douanes. Point notable, car lui-même finira commissaire des douanes. Quand on sait qu'Adam Smith passa sa vie à prôner le libre-échange et à combattre toutes les formes de protectionnisme, il est piquant de constater que ce sont les douanes qui auront nourri son enfance et sa vieillesse. Un psychanalyste aurait sans doute son mot à dire là-dessus. L'amateur des ruses de l'Histoire a du moins de quoi s'en amuser.
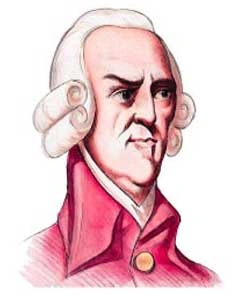
«
Adam Smith est souvent considéré comme l'auteur emblématique du libéralisme, qui incarnerait la foi dans les vertus du marché.
Les lectures de A.
Smithqu'apportent aujourd'hui historiens de la pensée économique et philosophes remettent en cause cette vision simpliste, et font de l'Écossais un auteurcomplexe, à la croisée de l'économie et de la philosophie morale.
En 1759 paraît la Théorie des sentiments moraux, le premier ouvrage du philosophe écossais A dam Smith (1723-1790).
Immédiatement, le livre connaîtun succès international.
Son objet : définir les principes de la morale, saisir les vertus nécessaires au bon fonctionnement de la société et comprendre d’oùvient le sens moral.Ce n’est pourtant pas cet ouvrage qui marquera la postérité, mais l’Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776), considéré par lascience économique comme l’œuvre fondatrice de la discipline.
Car tel est le paradoxe : l’auteur de la Théorie des sentiments moraux est perçu commel’inventeur de l’économie en tant que discipline autonome de la philosophie morale et politique.
Il en aurait fait une science positive, neutre, dégagée desinterrogations morales qui prévalaient auparavant (1).
L’intérêt pour les questions économiques n’est pas propre à A.
Smith et nombreux sont alors lesphilosophes à les intégrer dans leur champ de réflexion.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) se demandait par exemple quel serait le mode d’organisationdes échanges et de la production le plus favorable au bonheur et à la vertu.
Les questions sous-jacentes – « qu’est-ce que la richesse ? », « commentdéfinir l’intérêt général ? », « les vertus individuelles sont-elles nécessaires au bon fonctionnement de la société ? » – sont en effet à la frontière entre laphilosophie morale, la philosophie politique et ce qui deviendra l’économie politique.
Reste qu’un pas semble franchi avec La Richesse des nations…Comment A.
Smith, philosophe de formation, rendu célèbre par la Théorie des sentiments moraux, est-il donc devenu avec l’Enquête sur la nature et lescauses de la richesse des nations le père de la science économique ?
L'opposition des mercantilistes
Pour comprendre, il faut revenir sur la trajectoire intellectuelle qui l’a conduit d’un ouvrage à l’autre.
La renommée de la Théorie des sentiments moraux vautà A.
Smith d’être choisi comme précepteur du jeune duc de Buccleuch.
Il démissionne alors de l’université et entreprend de voyager en Europe.
Il yrencontre notamment David Hume et V oltaire, d’Alembert, d’Holbach, Claude Helvétius, Jacques Necker, André Morellet, Anne Robert Turgot, FrançoisQuesnay… Les rencontres avec ces deux derniers ont certainement favorisé son intérêt pour l’économie.
De retour en Ecosse, A.
Smith consacre dix annéesde sa vie à la rédaction de son Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, qui paraît en 1776 et sera son dernier ouvrage.
F.
Quesnay(1694-1774), médecin à la cour de Louis XV et attaché à la marquise de Pompadour, est le chef de file des « physiocrates ».
L’auteur du Tableauéconomique (1758) fait de l’agriculture la source de la richesse.
Si A.
Smith n’adhère pas à ce courant de pensée, il ne le considère pas non plus comme undanger très sérieux.
Il juge en revanche le « système mercantile », dont les représentants sont plus influents, comme réellement nuisible à l’intérêt général.Pour ceux-ci, l’accroissement de la richesse nationale passe par l’excédent de la balance commerciale qui permet l’accumulation de métaux précieux.
Ilssont donc favorables au protectionnisme contre lequel A .
Smith s’inscrit.
Opposé aux mercantilistes, il définit la richesse non pas comme une quantité demonnaie ou de métaux précieux, mais comme « l’ensemble des choses nécessaires et commodes à la vie ».
Il s’agit donc d’une richesse réelle, et, pour lui,la seule source de création de richesse est le travail.En écrivant La Richesse des nations, A.
Smith se définit en fait comme « conseiller du prince », et affirme que l’enrichissement de la nation tout entière doitfaire l’objet de tous les soins de l’Etat : « L’économie politique, considérée comme une branche de la science de l’homme d’Etat se propose à la fois d’enrichirle peuple et le souverain.
» Accroître la richesse suppose ainsi en premier lieu d’accroître la productivité du travail et/ou la proportion de la populationoccupée à des tâches productives*.
A u premier rang des moyens permettant d’accroître la productivité du travail vient la division du travail, hypothèsequ’illustre le fameux exemple de la manufacture d’épingles (voir l’encadré ci-dessus).L’enrichissement résulte donc des progrès de la productivité du travail et de la proportion de la population occupée à des tâches productives.
Or c’estl’accumulation du capital (les moyens de subsistance et les moyens de production) qui permet d’employer toujours plus de personnes à des tâchesproductives.
Elle est motivée par la recherche du profit des marchands.
Le désir d’enrichissement d’une classe de la société, les marchands, devientcompatible avec l’intérêt général et même y contribue.
C ’est cette idée qu’illustre « la main invisible » (voir l’encadré ci-contre), mécanisme par lequelcertains actes individuels contribuent au bien commun indépendamment de toute intention bienveillante.
L'économiste ne doit pas éclipser le philosophe
La main invisible est souvent interprétée comme étant au fondement du libéralisme économique : le maximum de liberté accordée aux agents économiques,marchands en particulier, c’est-à-dire le minimum d’intervention de l’Etat dans l’économie, conduit au maximum de bien-être pour tous, grâce à cemécanisme qualifié alors de « providentiel ».Mais A.
Smith était-il vraiment ce libéral attaché à défendre le désir d’enrichissement individuel comme un modèle de comportement dans une sociétémarchande bien ordonnée ?« Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent àleurs intérêts.
» C ette citation extraite de La Richesse des nations figure dans tous les manuels.
Et la messe semble dite : non seulement A .
Smith ne voitpas d’inconvénients à l’égoïsme, mais il affirme au contraire qu’il est un principe bienfaisant puisque nous lui devons notre subsistance.
On a ainsi souventfait de A.
Smith le fondateur du libéralisme économique et de La Richesse des nations un plaidoyer en faveur des propriétés régulatrices des mécanismesmarchands, conduisant les intérêts particuliers vers l’intérêt général.
Avec A .
Smith, les désirs d’enrichissement de quelques-uns étant favorables à tous, ildevenait possible d’étudier les mécanismes marchands en ignorant la question morale liée à l’enrichissement, et de séparer ainsi la science économique dela philosophie morale.Cette vision de l’histoire de la science économique est désormais battue en brèche par les historiens de la pensée économique et par des philosophes.Allant à l’encontre d’une telle lecture, le philosophe Michaël Biziou (2) montre ainsi que l’idée avancée par A .
Smith sous la métaphore de la main invisiblen’est pas celle d’une providence bienveillante : les comportements individuels ont des conséquences inattendues, qui peuvent aussi bien être bénéfiquesque nuisibles à la société.
Et l’opinion en réalité négative de A.
Smith à l’égard des marchands s’explique précisément par le fait que leurs comportements,s’ils ne sont pas encadrés par l’Etat, sont globalement nuisibles.
Et la vertu joue un rôle dans la régulation sociale, dont l’analyse ne se réduit pas à celledes mécanismes marchands (voir l’entretien ci-contre).Les nouvelles lectures de A.
Smith remettent donc en cause la présentation habituelle de La Richesse des nations, désormais plus souvent étudiée enrelation avec la Théorie des sentiments moraux et non plus comme un ouvrage indépendant.
Elle ne peut plus simplement être considérée comme l’ouvragequi a rendu possible l’indépendance de l’économie par rapport à la philosophie morale, en épargnant aux individus le soin d’être vertueux et assignant à laseule main invisible le rôle d’assurer comme par miracle la meilleure régulation possible des sociétés marchandes.
L’A dam Smith économiste ne doit paséclipser le philosophe….
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- THÉORIE DES SENTIMENTS MORAUX d’Adam Smith - Résumé
- THÉORIE DES SENTIMENTS MORAUX, Adam Smith (résumé & analyse)
- RECHERCHES SUR LA NATURE ET LES CAUSES DE LA RICHESSE DES NATIONS, Adam Smith
- SUR LA NATURE CAUSES DE LA RICHESSE DES NATIONS d'Adam Smith. Résumé et analyse
- Elsheimer, Adam - vie et oeuvre du peintre.