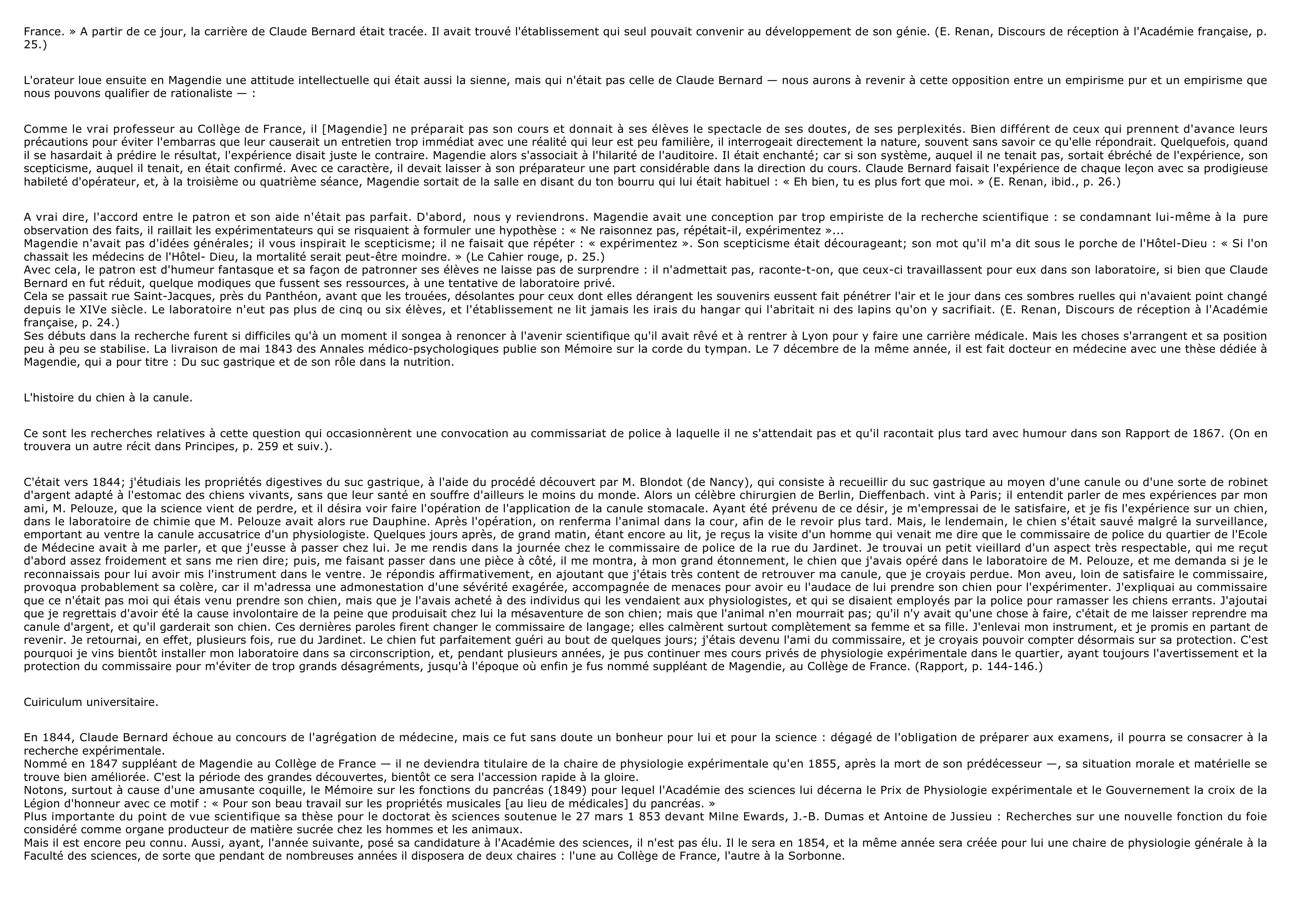CLAUDE BERNARD: DONNÉES BIOGRAPHIQUES
Publié le 17/01/2022
Extrait du document

Saint-Julien.
Claude Bernard naquit le 12 juillet 1813 à Saint-Julien (Rhône), petit bourg situé à une bonne lieue de Villefranche-sur-Saône, sur les coteaux qui se rattachent aux monts du Beaujolais. Dans une lettre de 1869, ayant fait depuis peu la connaissance de Mme Raffalovich — circonstance qui explique l'application d'écolier dont cette lettre donne l'impression — il lui décrivait ainsi son pays natal : Le Beaujolais est situé sur la rive droite de la Saône. J'habite sur les coteaux qui font face à la Dombes. J'ai pour horizon les Alpes dont j'aperçois les cîmes blanches quand le temps est propice. En arrière, mon imagination peut se promener jusqu'à l'Adriatique et, en avant mon regard passe au-dessus de Genève et de la Suisse qui me sont cachés par le Jura. Mais, pour rester dans le visible, je vois, quand je suis à mes fenêtres ou sur ma terrasse, se dérouler, à 7 ou 8 kilomètres devant moi, les vastes prairies de la vallée de la Saône que je domine. Lorsque le matin, comme aujourd'hui par exemple, le soleil se lève radieux derrière le majestueux Mont-Blanc qui est au loin en face de moi, la Saône et les prairies se couvrent de brouillards et d'une brume qui s'étendent et se dissipent peu à peu. Je ne distingue plus, alors, que les cîmes des grands peupliers et j'aperçois encore passer en longs serpents de fumée les trains du chemin de fer de Paris à Lyon dont j'entends parfois sous la direction du vent d'est, le roulement lointain. Sur les coteaux où je réside, je suis noyé dans des étendues incommensurables de vignes qui donneraient au pays un aspect très monotone s'il n'était coupé par des vallées ombragées et par de petits ruisseaux qui descendent des montagnes vers la Saône. Ma maison quoique sur la hauteur est entourée d'un nid de verdure par un petit bois à droite et un petit verger à gauche, ce qui est une rareté dans un pays où l'on défriche même les buissons pour planter de la vigne. (Lettres à Mme Raffalovich, Ms 3653, lettre 31.)

«
France.
» A partir de ce jour, la carrière de Claude Bernard était tracée.
Il avait trouvé l'établissement qui seul pouvait convenir au développement de son génie.
(E.
Renan, Discours de réception à l'Académie française, p.25.)
L'orateur loue ensuite en Magendie une attitude intellectuelle qui était aussi la sienne, mais qui n'était pas celle de Claude Bernard — nous aurons à revenir à cette opposition entre un empirisme pur et un empirisme quenous pouvons qualifier de rationaliste — :
Comme le vrai professeur au Collège de France, il [Magendie] ne préparait pas son cours et donnait à ses élèves le spectacle de ses doutes, de ses perplexités.
Bien différent de ceux qui prennent d'avance leursprécautions pour éviter l'embarras que leur causerait un entretien trop immédiat avec une réalité qui leur est peu familière, il interrogeait directement la nature, souvent sans savoir ce qu'elle répondrait.
Quelquefois, quandil se hasardait à prédire le résultat, l'expérience disait juste le contraire.
Magendie alors s'associait à l'hilarité de l'auditoire.
Il était enchanté; car si son système, auquel il ne tenait pas, sortait ébréché de l'expérience, sonscepticisme, auquel il tenait, en était confirmé.
Avec ce caractère, il devait laisser à son préparateur une part considérable dans la direction du cours.
Claude Bernard faisait l'expérience de chaque leçon avec sa prodigieusehabileté d'opérateur, et, à la troisième ou quatrième séance, Magendie sortait de la salle en disant du ton bourru qui lui était habituel : « Eh bien, tu es plus fort que moi.
» (E.
Renan, ibid., p.
26.)
A vrai dire, l'accord entre le patron et son aide n'était pas parfait.
D'abord, nous y reviendrons.
Magendie avait une conception par trop empiriste de la recherche scientifique : se condamnant lui-même à la pureobservation des faits, il raillait les expérimentateurs qui se risquaient à formuler une hypothèse : « Ne raisonnez pas, répétait-il, expérimentez »...Magendie n'avait pas d'idées générales; il vous inspirait le scepticisme; il ne faisait que répéter : « expérimentez ».
Son scepticisme était décourageant; son mot qu'il m'a dit sous le porche de l'Hôtel-Dieu : « Si l'onchassait les médecins de l'Hôtel- Dieu, la mortalité serait peut-être moindre.
» (Le Cahier rouge, p.
25.)Avec cela, le patron est d'humeur fantasque et sa façon de patronner ses élèves ne laisse pas de surprendre : il n'admettait pas, raconte-t-on, que ceux-ci travaillassent pour eux dans son laboratoire, si bien que ClaudeBernard en fut réduit, quelque modiques que fussent ses ressources, à une tentative de laboratoire privé.Cela se passait rue Saint-Jacques, près du Panthéon, avant que les trouées, désolantes pour ceux dont elles dérangent les souvenirs eussent fait pénétrer l'air et le jour dans ces sombres ruelles qui n'avaient point changédepuis le XIVe siècle.
Le laboratoire n'eut pas plus de cinq ou six élèves, et l'établissement ne lit jamais les irais du hangar qui l'abritait ni des lapins qu'on y sacrifiait.
(E.
Renan, Discours de réception à l'Académiefrançaise, p.
24.)Ses débuts dans la recherche furent si difficiles qu'à un moment il songea à renoncer à l'avenir scientifique qu'il avait rêvé et à rentrer à Lyon pour y faire une carrière médicale.
Mais les choses s'arrangent et sa positionpeu à peu se stabilise.
La livraison de mai 1843 des Annales médico-psychologiques publie son Mémoire sur la corde du tympan.
Le 7 décembre de la même année, il est fait docteur en médecine avec une thèse dédiée àMagendie, qui a pour titre : Du suc gastrique et de son rôle dans la nutrition.
L'histoire du chien à la canule.
Ce sont les recherches relatives à cette question qui occasionnèrent une convocation au commissariat de police à laquelle il ne s'attendait pas et qu'il racontait plus tard avec humour dans son Rapport de 1867.
(On entrouvera un autre récit dans Principes, p.
259 et suiv.).
C'était vers 1844; j'étudiais les propriétés digestives du suc gastrique, à l'aide du procédé découvert par M.
Blondot (de Nancy), qui consiste à recueillir du suc gastrique au moyen d'une canule ou d'une sorte de robinetd'argent adapté à l'estomac des chiens vivants, sans que leur santé en souffre d'ailleurs le moins du monde.
Alors un célèbre chirurgien de Berlin, Dieffenbach.
vint à Paris; il entendit parler de mes expériences par monami, M.
Pelouze, que la science vient de perdre, et il désira voir faire l'opération de l'application de la canule stomacale.
Ayant été prévenu de ce désir, je m'empressai de le satisfaire, et je fis l'expérience sur un chien,dans le laboratoire de chimie que M.
Pelouze avait alors rue Dauphine.
Après l'opération, on renferma l'animal dans la cour, afin de le revoir plus tard.
Mais, le lendemain, le chien s'était sauvé malgré la surveillance,emportant au ventre la canule accusatrice d'un physiologiste.
Quelques jours après, de grand matin, étant encore au lit, je reçus la visite d'un homme qui venait me dire que le commissaire de police du quartier de l'Ecolede Médecine avait à me parler, et que j'eusse à passer chez lui.
Je me rendis dans la journée chez le commissaire de police de la rue du Jardinet.
Je trouvai un petit vieillard d'un aspect très respectable, qui me reçutd'abord assez froidement et sans me rien dire; puis, me faisant passer dans une pièce à côté, il me montra, à mon grand étonnement, le chien que j'avais opéré dans le laboratoire de M.
Pelouze, et me demanda si je lereconnaissais pour lui avoir mis l'instrument dans le ventre.
Je répondis affirmativement, en ajoutant que j'étais très content de retrouver ma canule, que je croyais perdue.
Mon aveu, loin de satisfaire le commissaire,provoqua probablement sa colère, car il m'adressa une admonestation d'une sévérité exagérée, accompagnée de menaces pour avoir eu l'audace de lui prendre son chien pour l'expérimenter.
J'expliquai au commissaireque ce n'était pas moi qui étais venu prendre son chien, mais que je l'avais acheté à des individus qui les vendaient aux physiologistes, et qui se disaient employés par la police pour ramasser les chiens errants.
J'ajoutaique je regrettais d'avoir été la cause involontaire de la peine que produisait chez lui la mésaventure de son chien; mais que l'animal n'en mourrait pas; qu'il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de me laisser reprendre macanule d'argent, et qu'il garderait son chien.
Ces dernières paroles firent changer le commissaire de langage; elles calmèrent surtout complètement sa femme et sa fille.
J'enlevai mon instrument, et je promis en partant derevenir.
Je retournai, en effet, plusieurs fois, rue du Jardinet.
Le chien fut parfaitement guéri au bout de quelques jours; j'étais devenu l'ami du commissaire, et je croyais pouvoir compter désormais sur sa protection.
C'estpourquoi je vins bientôt installer mon laboratoire dans sa circonscription, et, pendant plusieurs années, je pus continuer mes cours privés de physiologie expérimentale dans le quartier, ayant toujours l'avertissement et laprotection du commissaire pour m'éviter de trop grands désagréments, jusqu'à l'époque où enfin je fus nommé suppléant de Magendie, au Collège de France.
(Rapport, p.
144-146.)
Cuiriculum universitaire.
En 1844, Claude Bernard échoue au concours de l'agrégation de médecine, mais ce fut sans doute un bonheur pour lui et pour la science : dégagé de l'obligation de préparer aux examens, il pourra se consacrer à larecherche expérimentale.Nommé en 1847 suppléant de Magendie au Collège de France — il ne deviendra titulaire de la chaire de physiologie expérimentale qu'en 1855, après la mort de son prédécesseur —, sa situation morale et matérielle setrouve bien améliorée.
C'est la période des grandes découvertes, bientôt ce sera l'accession rapide à la gloire.Notons, surtout à cause d'une amusante coquille, le Mémoire sur les fonctions du pancréas (1849) pour lequel l'Académie des sciences lui décerna le Prix de Physiologie expérimentale et le Gouvernement la croix de laLégion d'honneur avec ce motif : « Pour son beau travail sur les propriétés musicales [au lieu de médicales] du pancréas.
»Plus importante du point de vue scientifique sa thèse pour le doctorat ès sciences soutenue le 27 mars 1 853 devant Milne Ewards, J.-B.
Dumas et Antoine de Jussieu : Recherches sur une nouvelle fonction du foieconsidéré comme organe producteur de matière sucrée chez les hommes et les animaux.Mais il est encore peu connu.
Aussi, ayant, l'année suivante, posé sa candidature à l'Académie des sciences, il n'est pas élu.
Il le sera en 1854, et la même année sera créée pour lui une chaire de physiologie générale à laFaculté des sciences, de sorte que pendant de nombreuses années il disposera de deux chaires : l'une au Collège de France, l'autre à la Sorbonne..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Claude Bernard : Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (fiche de lecture)
- INTRODUCTION A L’ÉTUDE DE LA MÉDECINE EXPÉRIMENTALE, 1865. Claude Bernard - résumé de l'oeuvre
- INTRODUCTION À L’ÉTUDE DE LA MÉDECINE EXPÉRIMENTALE de Claude Bernard (résumé & analyse)
- INTRODUCTION À L’ÉTUDE DE LA MÉDECINE EXPÉRIMENTALE Claude Bernard (résumé & analyse)
- Claude BERNARD: le physiologiste et le médecin