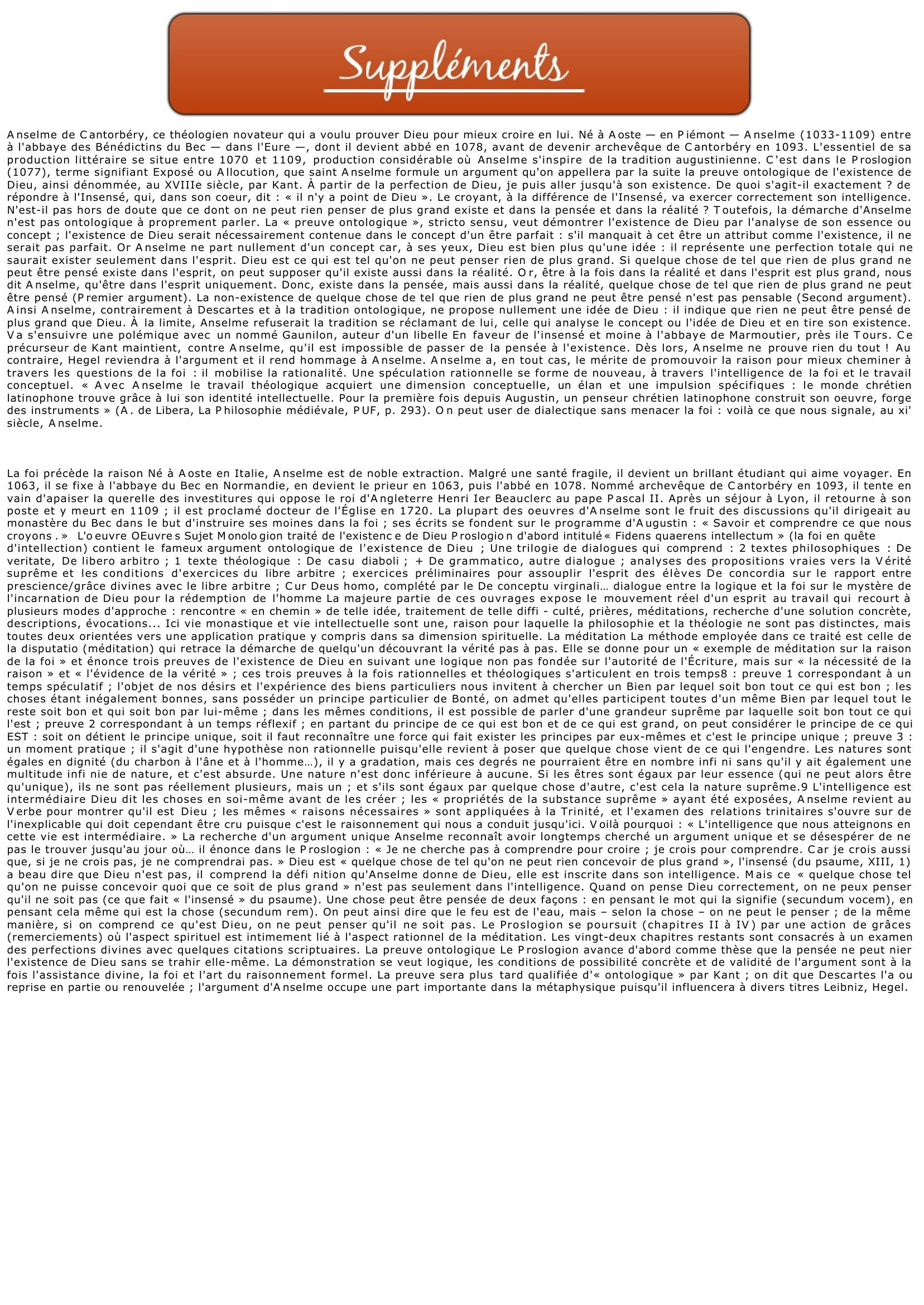Biographie de Saint ANSELME
Publié le 23/02/2010
Extrait du document

- Saint Anselme

«
Anselme de C antorbéry, ce théologien novateur qui a voulu prouver Dieu pour mieux croire en lui.
Né à A oste — en Piémont — Anselme (1033-1109) entreà l'abbaye des Bénédictins du Bec — dans l'Eure —, dont il devient abbé en 1078, avant de devenir archevêque de C antorbéry en 1093.
L'essentiel de saproduction littéraire se situe entre 1070 et 1109, production considérable où Anselme s'inspire de la tradition augustinienne.
C 'est dans le Proslogion(1077), terme signifiant Exposé ou A llocution, que saint Anselme formule un argument qu'on appellera par la suite la preuve ontologique de l'existence deDieu, ainsi dénommée, au XVIIIe siècle, par Kant.
À partir de la perfection de Dieu, je puis aller jusqu'à son existence.
De quoi s'agit-il exactement ? derépondre à l'Insensé, qui, dans son coeur, dit : « il n'y a point de Dieu ».
Le croyant, à la différence de l'Insensé, va exercer correctement son intelligence.N'est-il pas hors de doute que ce dont on ne peut rien penser de plus grand existe et dans la pensée et dans la réalité ? T outefois, la démarche d'Anselmen'est pas ontologique à proprement parler.
La « preuve ontologique », stricto sensu, veut démontrer l'existence de Dieu par l'analyse de son essence ouconcept ; l'existence de Dieu serait nécessairement contenue dans le concept d'un être parfait : s'il manquait à cet être un attribut comme l'existence, il neserait pas parfait.
Or Anselme ne part nullement d'un concept car, à ses yeux, Dieu est bien plus qu'une idée : il représente une perfection totale qui nesaurait exister seulement dans l'esprit.
Dieu est ce qui est tel qu'on ne peut penser rien de plus grand.
Si quelque chose de tel que rien de plus grand nepeut être pensé existe dans l'esprit, on peut supposer qu'il existe aussi dans la réalité.
O r, être à la fois dans la réalité et dans l'esprit est plus grand, nousdit Anselme, qu'être dans l'esprit uniquement.
Donc, existe dans la pensée, mais aussi dans la réalité, quelque chose de tel que rien de plus grand ne peutêtre pensé (P remier argument).
La non-existence de quelque chose de tel que rien de plus grand ne peut être pensé n'est pas pensable (Second argument).Ainsi A nselme, contrairement à Descartes et à la tradition ontologique, ne propose nullement une idée de Dieu : il indique que rien ne peut être pensé deplus grand que Dieu.
À la limite, Anselme refuserait la tradition se réclamant de lui, celle qui analyse le concept ou l'idée de Dieu et en tire son existence.Va s'ensuivre une polémique avec un nommé Gaunilon, auteur d'un libelle En faveur de l'insensé et moine à l'abbaye de Marmoutier, près ile T ours.
Ceprécurseur de Kant maintient, contre Anselme, qu'il est impossible de passer de la pensée à l'existence.
Dès lors, Anselme ne prouve rien du tout ! Aucontraire, Hegel reviendra à l'argument et il rend hommage à A nselme.
Anselme a, en tout cas, le mérite de promouvoir la raison pour mieux cheminer àtravers les questions de la foi : il mobilise la rationalité.
Une spéculation rationnelle se forme de nouveau, à travers l'intelligence de la foi et le travailconceptuel.
« Avec Anselme le travail théologique acquiert une dimension conceptuelle, un élan et une impulsion spécifiques : le monde chrétienlatinophone trouve grâce à lui son identité intellectuelle.
Pour la première fois depuis Augustin, un penseur chrétien latinophone construit son oeuvre, forgedes instruments » (A .
de Libera, La Philosophie médiévale, P UF, p.
293).
On peut user de dialectique sans menacer la foi : voilà ce que nous signale, au xi'siècle, Anselme.
La foi précède la raison Né à A oste en Italie, Anselme est de noble extraction.
Malgré une santé fragile, il devient un brillant étudiant qui aime voyager.
En1063, il se fixe à l'abbaye du Bec en Normandie, en devient le prieur en 1063, puis l'abbé en 1078.
Nommé archevêque de C antorbéry en 1093, il tente envain d'apaiser la querelle des investitures qui oppose le roi d'Angleterre Henri Ier Beauclerc au pape Pascal II.
Après un séjour à Lyon, il retourne à sonposte et y meurt en 1109 ; il est proclamé docteur de l'Église en 1720.
La plupart des oeuvres d'A nselme sont le fruit des discussions qu'il dirigeait aumonastère du Bec dans le but d'instruire ses moines dans la foi ; ses écrits se fondent sur le programme d'A ugustin : « Savoir et comprendre ce que nouscroyons.
» L'o euvre OEuvre s Sujet Monologion traité de l'existenc e de Dieu Proslogion d'abord intitulé « Fidens quaerens intellectum » (la foi en quêted'intellection) contient le fameux argument ontologique de l'existence de Dieu ; Une trilogie de dialogues qui comprend : 2 textes philosophiques : Deveritate, De libero arbitro ; 1 texte théologique : De casu diaboli ; + De grammatico, autre dialogue ; analyses des propositions vraies vers la V éritésuprême et les conditions d'exercices du libre arbitre ; exercices préliminaires pour assouplir l'esprit des élèves De concordia sur le rapport entreprescience/grâce divines avec le libre arbitre ; C ur Deus homo, complété par le De conceptu virginali… dialogue entre la logique et la foi sur le mystère del'incarnation de Dieu pour la rédemption de l'homme La majeure partie de ces ouvrages expose le mouvement réel d'un esprit au travail qui recourt àplusieurs modes d'approche : rencontre « en chemin » de telle idée, traitement de telle diffi - culté, prières, méditations, recherche d'une solution concrète,descriptions, évocations...
Ici vie monastique et vie intellectuelle sont une, raison pour laquelle la philosophie et la théologie ne sont pas distinctes, maistoutes deux orientées vers une application pratique y compris dans sa dimension spirituelle.
La méditation La méthode employée dans ce traité est celle dela disputatio (méditation) qui retrace la démarche de quelqu'un découvrant la vérité pas à pas.
Elle se donne pour un « exemple de méditation sur la raisonde la foi » et énonce trois preuves de l'existence de Dieu en suivant une logique non pas fondée sur l'autorité de l'Écriture, mais sur « la nécessité de laraison » et « l'évidence de la vérité » ; ces trois preuves à la fois rationnelles et théologiques s'articulent en trois temps8 : preuve 1 correspondant à untemps spéculatif ; l'objet de nos désirs et l'expérience des biens particuliers nous invitent à chercher un Bien par lequel soit bon tout ce qui est bon ; leschoses étant inégalement bonnes, sans posséder un principe particulier de Bonté, on admet qu'elles participent toutes d'un même Bien par lequel tout lereste soit bon et qui soit bon par lui-même ; dans les mêmes conditions, il est possible de parler d'une grandeur suprême par laquelle soit bon tout ce quil'est ; preuve 2 correspondant à un temps réflexif ; en partant du principe de ce qui est bon et de ce qui est grand, on peut considérer le principe de ce quiEST : soit on détient le principe unique, soit il faut reconnaître une force qui fait exister les principes par eux-mêmes et c'est le principe unique ; preuve 3 :un moment pratique ; il s'agit d'une hypothèse non rationnelle puisqu'elle revient à poser que quelque chose vient de ce qui l'engendre.
Les natures sontégales en dignité (du charbon à l'âne et à l'homme…), il y a gradation, mais ces degrés ne pourraient être en nombre infi ni sans qu'il y ait également unemultitude infi nie de nature, et c'est absurde.
Une nature n'est donc inférieure à aucune.
Si les êtres sont égaux par leur essence (qui ne peut alors êtrequ'unique), ils ne sont pas réellement plusieurs, mais un ; et s'ils sont égaux par quelque chose d'autre, c'est cela la nature suprême.9 L'intelligence estintermédiaire Dieu dit les choses en soi-même avant de les créer ; les « propriétés de la substance suprême » ayant été exposées, A nselme revient auVerbe pour montrer qu'il est Dieu ; les mêmes « raisons nécessaires » sont appliquées à la Trinité, et l'examen des relations trinitaires s'ouvre sur del'inexplicable qui doit cependant être cru puisque c'est le raisonnement qui nous a conduit jusqu'ici.
V oilà pourquoi : « L'intelligence que nous atteignons encette vie est intermédiaire.
» La recherche d'un argument unique Anselme reconnaît avoir longtemps cherché un argument unique et se désespérer de nepas le trouver jusqu'au jour où… il énonce dans le Proslogion : « Je ne cherche pas à comprendre pour croire ; je crois pour comprendre.
C ar je crois aussique, si je ne crois pas, je ne comprendrai pas.
» Dieu est « quelque chose de tel qu'on ne peut rien concevoir de plus grand », l'insensé (du psaume, XIII, 1)a beau dire que Dieu n'est pas, il comprend la défi nition qu'Anselme donne de Dieu, elle est inscrite dans son intelligence.
M ais ce « quelque chose telqu'on ne puisse concevoir quoi que ce soit de plus grand » n'est pas seulement dans l'intelligence.
Quand on pense Dieu correctement, on ne peux penserqu'il ne soit pas (ce que fait « l'insensé » du psaume).
Une chose peut être pensée de deux façons : en pensant le mot qui la signifie (secundum vocem), enpensant cela même qui est la chose (secundum rem).
On peut ainsi dire que le feu est de l'eau, mais – selon la chose – on ne peut le penser ; de la mêmemanière, si on comprend ce qu'est Dieu, on ne peut penser qu'il ne soit pas.
Le Proslogion se poursuit (chapitres II à IV ) par une action de grâces(remerciements) où l'aspect spirituel est intimement lié à l'aspect rationnel de la méditation.
Les vingt-deux chapitres restants sont consacrés à un examendes perfections divines avec quelques citations scriptuaires.
La preuve ontologique Le P roslogion avance d'abord comme thèse que la pensée ne peut nierl'existence de Dieu sans se trahir elle-même.
La démonstration se veut logique, les conditions de possibilité concrète et de validité de l'argument sont à lafois l'assistance divine, la foi et l'art du raisonnement formel.
La preuve sera plus tard qualifiée d'« ontologique » par Kant ; on dit que Descartes l'a oureprise en partie ou renouvelée ; l'argument d'Anselme occupe une part importante dans la métaphysique puisqu'il influencera à divers titres Leibniz, Hegel..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PROSLOGION, Fides Quaerens Intellectum id est Proslogion, Anselme de Cantorbéry (saint)
- POURQUOI DIEU SE FIT HOMME de saint Anselme de Cantorbéry (résumé et analyse de l’oeuvre)
- MONOLOGION de saint Anselme de Cantorbéry - résumé, analyse
- PROSLOGION de saint Anselme de Cantorbéry (résumé & analyse)
- La preuve ontologique de l'existence de Dieu SAINT ANSELME