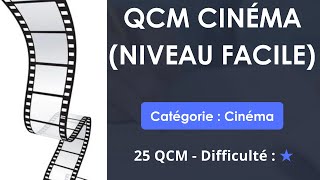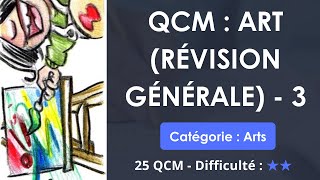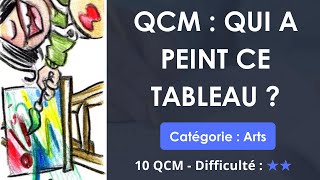QUATUORS de Beethoven.
Publié le 01/10/2015
Extrait du document
QUATUORS de Beethoven. Ils sont au nombre de seize, plus la Grande Fugue, également pour quatuor à cordes, clairement subdivisés en trois groupes chronologiques et stylistiques. Ce n’est qu’assez tard, et après nombre d’essais et d’hésitations, que Ludwig van Beethoven (1770-1827) affronta cette forme instrumentale qui requiert la maîtrise absolue d’un langage musical équilibré, correctement réparti selon les lois du contrepoint entre les deux violons, l’alto et le violoncelle, de manière à ce qu’aucun des instruments ne soit sacrifié à un emploi de pur soutien harmonique ou de redoublement.
En 1801, furent publiés les six Quatuors op. 18. composés probablement à partir de 1799. Bien qu’à cette époque la douleur physique et morale eût déjà tenaillé l’âme de Beethoven de son étreinte inexorable, les Quatuors op. 18 sont généralement frais et souriants, d’une insouciante sérénité juvénile, et mêlent la grâce suave de Mozart à la vigueur humoristique de Haydn, acceptant du premier, presque docilement, les schémas formels. Dans l'Op. 18 n° 1, en « fa majeur », le second mouvement seulement, « Adagio affettuoso e appassionato », révèle une note vraiment personnelle, et c’est une des pages les plus profondes que Beethoven ait écrites avant 1800. L’Op. 18 n° 2. en «sol majeur », est appelé communément « Quatuor des salutations » à cause du caractère cérémonieux de 1’ «Allegro». Dans l'«Adagio» on peut remarquer l’irruption soudaine d’un Allegro et la reprise de l’Adagio par le violoncelle. L’Op. 18 n° 3. en « ré majeur - est chronologiquement, le premier ; c’est aussi le quatuor le plus fidèle aux modèles classiques de Haydn et de Mozart, dont il peut être considéré comme une sage et parfaite imitation. L’Op. 18 n° 4. en «do mineur», occupe, parmi les quatuors, une position analogue à celle que la Pathétique occupe parmi les Sonates pour piano ; c’est un des sommets' de la première manière beethovénienne, grâce au premier et au dernier mouvement, tous deux « Allegro » : le premier dramatique et résolu, plein d’une force héroïque ; le second, d’un humour puissant et presque vulgaire. Par contre l’Op. 18 n° 5. en «la majeur », semble encore « un hommage aux mânes de Mozart » (De Lenz). Le dernier quatuor de l’Op. 18. le n° fi. en « si bémol -. se distingue par la grande originalité du dernier mouvement, intitulé par Beethoven lui-même « La Malinconia » (« La Mélancolie ») et constitué par la succession d’un « Adagio », d’un « Allegretto quasi allegro » et d’un « Prestissimo » ; c’est la peinture d’une àme tendre et juvénile qui se consume de regrets et de nostalgies, mais sur laquelle, peu à peu. les forces exubérantes et souriantes de la vie reprennent leur pouvoir.
Un très grand écart chronologique sépare ce quatuor du premier des trois célèbres Quatuors op. 59. dédiés à l’ambassadeur russe à Vienne, le comte Rasumowsky. Composés en 1806 (l’élaboration. à en juger par les ébauches qui nous sont restées, en fut difficile), ils sont vraiment au cœur de la seconde manière beethovénienne, celle des grandes Sonates pour piano (Sonates pour piano) et de la Svmphonie «° 5 (Symphonies). La sonorité de quatuor est tendue vers l’effort maximum dans une aspiration à la puissance symphonique, dès le Quatuor op. 59 n° I, en « fa majeur ». qui est encore cependant le plus proche de l'ancien style. Un idéalisme noble et serein, d’une élévation poétique remarquable, empreint le premier « Allegro », auquel fait suite un « Allegretto vivace « sempre scherzando », sorte de jeu aérien mi-humoristique, mi-dramatique. dans une alternance continuelle de lumière et d’ombre. Simple et sculptural, au contraire, est le sublime » Adagio molto e mesto ». construit sur deux thèmes d’une réelle valeur expressive. Le finale est un « Allegro » bâti sur un thème russe d’expression sentimentale ambigu6. L’Op. 59 n° 2. en « mi mineur ». s’ouvre par un « Allegro » tout de passion : c’est le Beethoven le plus typique. courroucé et héroïque, celui que l’on a coutume de désigner par la formule, dont on a abusé, de « la lutte cortre le destin ».
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CONCERTO POUR VIOLON ET ORCHESTRE de Beethoven. (résumé & analyse)
- CONCERTOS POUR PIANO ET ORCHESTRE de Beethoven. (résumé & analyse)
- Beethoven : les grandes époques créatrices, Romain Rolland
- QUATRE QUATUORS (résumé) Thomas Stearns Eliot
- Le personnage de LÉONORE de Beethoven.