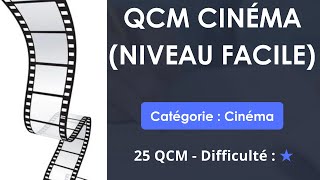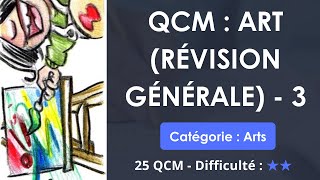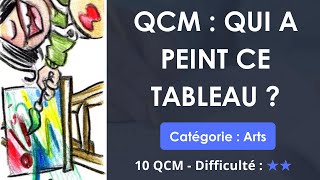Marivaux-Strehler : une rencontre tant attendue
Publié le 06/12/2018
Extrait du document

que parfois, sous le masque, il n’y a rien. Epreuve souvent cruelle où le « moi » se perd, mais pour se découvrir comme être sensible : j’aime, donc j’existe... De l’indignation offensée de Madame à son « Je ne sais où j’en suis » et à l’étreinte finale avec Silvia, c’est le parcours type du théâtre marivaudien que trace l’île des esclaves, plus proche peut-être de ce schéma fondamental que les autres « îles » de Marivaux, l ’île de la Raison et la Colonie.
Mais ce philosophe manipulateur appartient aussi au monde familier de Strehler. Médiateur du théâtre et de la vie, de l’illusion et du réel, despote éclairé à la manière du xvm6 siècle, porteur du rêve maçonnique de fraternité humaine au-delà des inégalités sociales, Trivelin évoque le Prospero de la Tempête (mise en scène par Strehler en 1978), l’Alcandre de l’illusion comique (1984), mais aussi, du côté de l’opéra, l’autre passion du maestro, le Selim de son Enlèvement au sérail (1965) ou le Sarastro de sa Flûte enchantée (1974). Face à eux, Arlequin (ou Caliban...), inquiétant dans sa force brute, « populaire », mais dont la chorégraphie sauvage est à l’image du jaillissement de la vie : de 1947 à 1987, avant d’aborder l’Arlequin marivaudien, Strehler n’a pas moins de six fois repris et retravaillé l’Arlequin serviteur de deux maîtres, de Goldoni !
Il aura fallu attendre le soir de sa vie pour que Giorgio Strehler, le directeur fondateur du Piccolo Teatro de Milan et le metteur en scène italien le plus important de notre époque, confronte son univers à celui du plus italien des écrivains français. De leur rencontre est née cette nouvelle production de l'ile des esclaves, créée en 1725 à Paris par les Comédiens-Italiens, où l’« humanisme expérimental » de Marivaux, entre commedia dell’arte et philosophie des Lumières, transforme une utopie classique en un voyage au bout de soi-même.
Liens utiles
- Explication linéaire n°9 Madame Bovary: Dans quelle mesure cette rencontre amoureuse, bien que classique, est-elle magnifiée par le regard du héros ?
- Les Fausses Confidences, Marivaux (1737) - Résumé de la pièce
- « Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre » JEAN-PAUL SARTRE
- Marivaux - les fausses confidences (1737) scène 14 - acte I
- Lecture linéaire : Le piège d’Araminte. Acte II scène 13, Les fausses Confidences, Marivaux