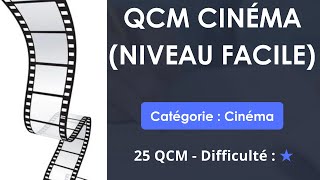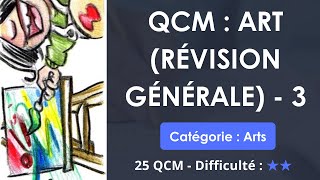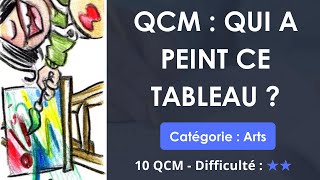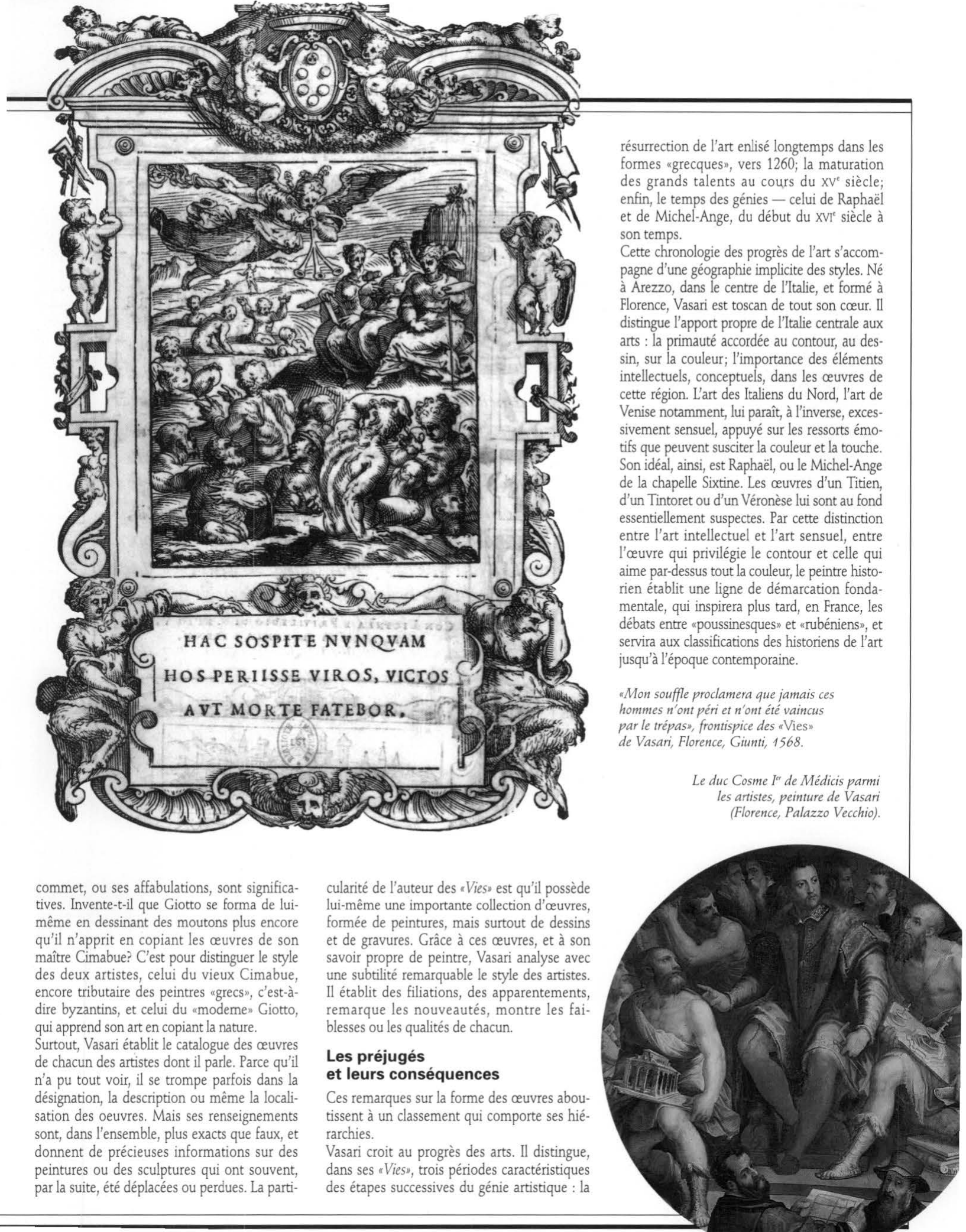LES «VIES» DE VASARI
Publié le 14/09/2014
Extrait du document


«
commet, ou ses affabulations, sont significa
tives.
Invent e+il que Giotto se forma de lui
même en dessinant des moutons plus encore
qu'il n'apprit en copiant l es œuvres de son
maître Cimabue? C'est pour distinguer le style
des deux artistes , celui du vieux Cimab ue,
encore tributaire des peint res «grecs », c'est-à
dire byzantins , et celui du •m oderne• Giotto ,
qui apprend son art en copiant la nature.
Surtout, Vasari établit le catalogue des œuvres
de chacun d es arti stes dont il parl e.
Parce qu'il
n 'a pu t out voir, il se trompe par fois dan s la
désignation , la description ou même la locali
sation des oeuvre s.
Mai s ses ren seignements
son t , dans l'ensemble , plus exacts que faux, et
donnent de précieuses informations sur des
peintures ou des scu lpture s q ui ont souvent,
par la suite, été dépla cées ou perdues .
La parti-
c ularité de l'au teur des •Vies• est qu'il possède
lui-même une importante collection d'œuvres,
formée de peintures, mais surtou t de dessins
et d e gravu res.
Grâce à ces œuvres, et à son
savoir propre de peintre , Vasari ana lyse avec
une subtili té re m arquable le style des artistes.
Il établit des filiation s, des apparentements,
remarque les nouveautés, montre les
fai
blesses ou l es qualit és de chacun.
Les préjugés
et leurs conséquences
Ces remarques sur la forme des œuvres abou
tissent à un classement qui comp ort e ses hié
rarchie s.
Vasari croi t au pro grès des arts.
Il distingue,
dans ses •Vies•, trois période s caracté ristiqu es
des étapes successives du génie artistique : l a
résurrection de l'art enlisé longtemps dans les
formes •grecques•, vers 1260 ; la maturation
des grands talents au co~s du xv• siècle;
enfin, le temp s des génies - celui de Rapha ël
et de Michel-Ange , du début du XVI ' siècle à
son temps.
Cette chronologie des progrès de l'art s'accom
pagne d'une géographie implicite des styles.
Né
à Arezz o, dans le centre de l'Italie, et fonné à
Florence , Vasari est toscan de tout son cœ ur.
Il
distingue l'apport propre de l'Italie centrale aux
arts : la primauté accordée au contour , au des
sin, sur la couleur; l'importance des é léments
intellectuels , conceptuels, dans les œuvres de
cette région.
L'art des Italiens du Nord , l'art de
Venise notamment, lui paraît, à l'inverse, exces
sivement sens uel, appuyé sur les ressorts émo
tifs que peuvent susciter la couleur et la touche .
Son idéal, ainsi, est Raphaël , ou le Michel-Ange
de la chapelle Sixtine.
Les œuvres d'un Titien ,
d'un
Tintoret ou d 'un Véronèse lui sont au fond
essentiellement susp ectes.
Par cette distinction
entre l'art intellectuel et l'a rt sensue l, entre
l'œ
uvre qui privilégie le contour et celle qui
aime par-dessus tout la couleur, le peintre histo
rien établit une ligne de démarcation fonda
mentale , qui inspirera plus tard, en France, les
débats entre • pouss ine squ es• et •rubéniens •, et
servira aux classifications des historiens de l'art
j u
squ'à l'é poque contemporaine .
•M on souffle proclamera q u e jamai s ces homnu s n'ont pén· et n'ont été vaincu s
par le trépas• , frontispi ce des •Vies•
de Vasari , Florence , G iunti , 1568 .
Le duc Cos me/" de Médicis parmi
l es arti s tes, peinture de Vasari (Florence , Pala zzo Vecch io)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- VIES IMAGINAIRES de Marcel Schwob (résumé & analyse)
- VIES DES HOMMES ILLUSTRES de Jacques Amyot (résumé & analyse)
- VIES DES PLUS CÉLÈBRES ARCHITECTES DE TOUS LES TEMPS ET DE TOUS LES PAYS (résumé & analyse de l’oeuvre)
- VIES DES TROUBADOURS. (résumé & analyse de l’oeuvre)
- des pratiques médicales pour sauver des vies