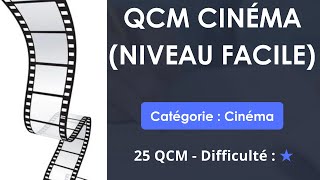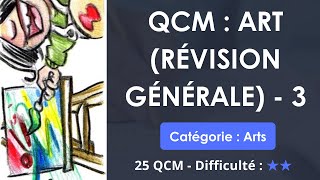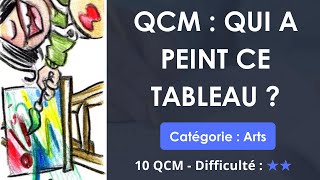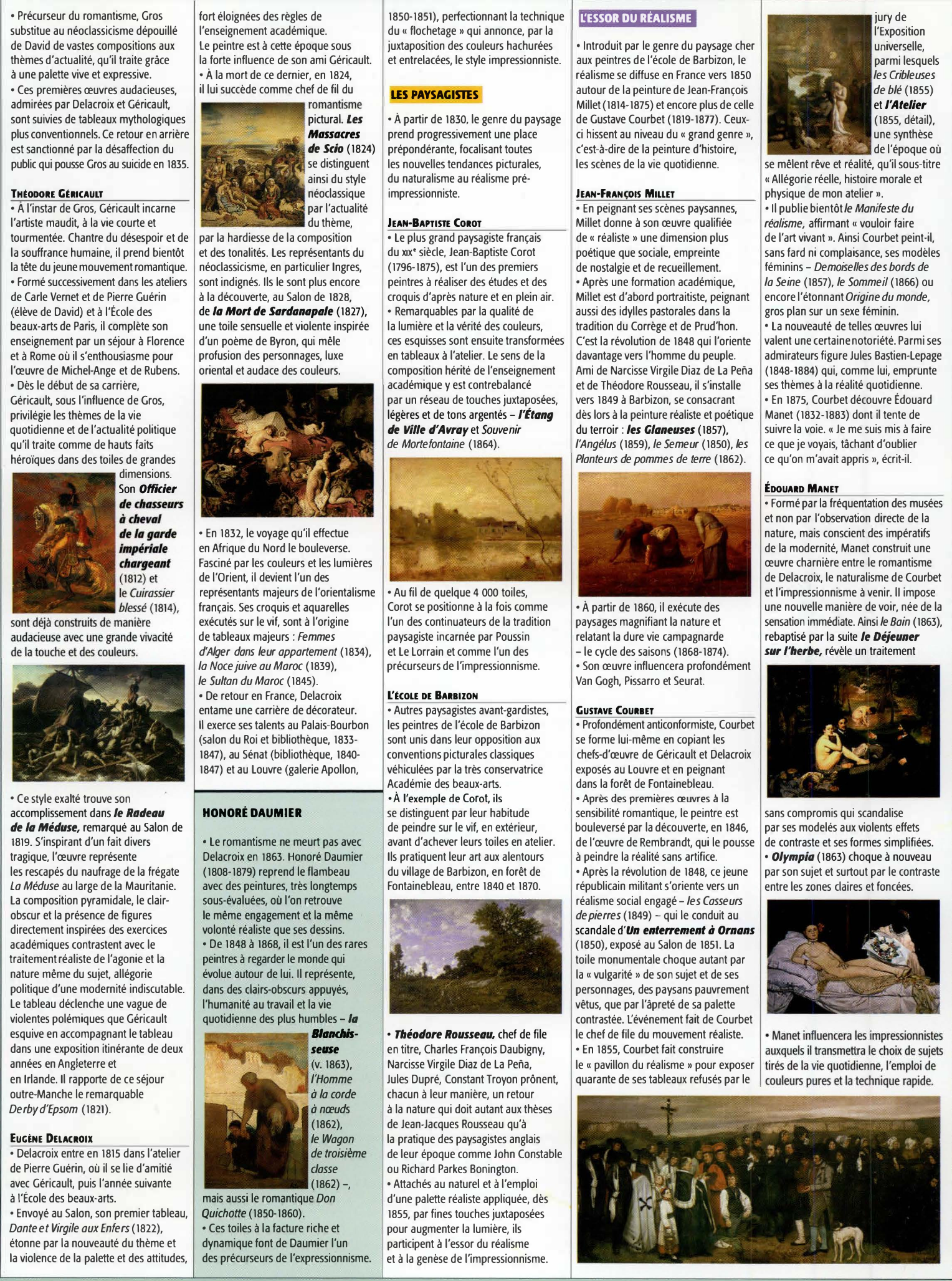La peinture française de David à Manet (Exposé – Art – Collège/Lycée)
Publié le 15/11/2018

Extrait du document
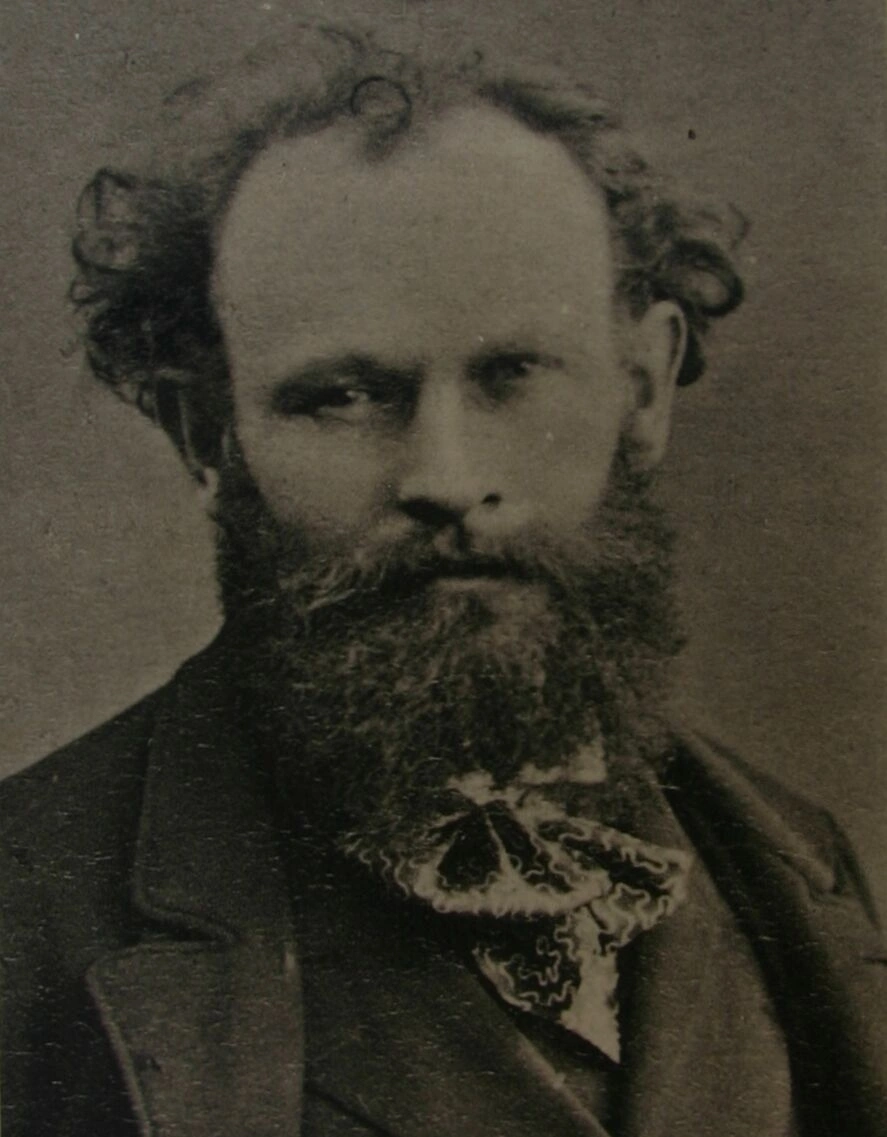
MAÎTRES DE LA LIGNE, MAITRES DE LA COULEUR
La peinture française de la fin du xviiie siècle et du xixe siècle est marquée par une succession de mouvements artistiques demeurés majeurs dans l'histoire de cet art. Détachée des autres arts plastiques - en recul -, cette production picturale en pleine mutation, commence par le Serment des Horaces (1784), premier tableau néoclassique de Jacques-Louis David, et s'achève avec l'œuvre d'Édouard Manet dont la « vision moderne » ouvre la voie à la nouvelle génération des peintres impressionnistes.
LE RETOUR À L'ANTIQUE
• Le néoclassicisme, caractérisé par le retour aux formes gréco-romaines, domine la peinture française de la Révolution et de l'Empire, jusque vers 1830.
• Mouvement aux composantes multiples, il illustre plus qu'un simple regain d’intérêt pour l'Antiquité classique : lié aux événements politiques de l'époque, il substitue au style xviii', jugé frivole et artificiel, un style simple fondé sur des valeurs de clarté, de lisibilité et d'ordre rationnel.
• C'est ainsi que l'esthétique néoclassique devient l'art officiel des régimes républicains issus de la Révolution française, choisie parce qu'elle est associée à la démocratie de la Grèce antique et à l'héroïsme de la République romaine.
• Jacques-Louis David (1748-1825) donne toute son ampleur à ce nouveau style parti de Rome en l'orientant vers une plus grande austérité. Il fait de son atelier, de la Révolution jusqu'à la chute de Napoléon Ier, je foyer rayonnant de l'école néoclassique.
Jacques-Louis David
• C'est à Rome où il séjourne entre 1775 et 1780 que David se passionne, sous l'influence de Winckelmann et des disciples de celui-ci, pour la ligne pure et les vestiges antiques ainsi que pour l'œuvre du peintre du xviie siècle Nicolas Poussin.
• Dès lors, il privilégie le dessin et le volume qui priment sur la couleur, réduite à quelques tons froids sans modulation chromatique.
• David devient célèbre avec sa première commande, le Serment des Horaces (1784), véritable manifeste du nouvel idéal. Cette toile, porteuse d'un thème moral et patriotique, présente une composition structurée où l'agencement des personnages sculpturaux rappelle celui des frises antiques.
• Cette forme de peinture historique, noble et héroïque, à l'antipode des œuvres frivoles du temps de Louis XV, continue de s'illustrer dans la Mort de Socrate (1787) et Brutus (1789). Elle est plébiscitée par la Révolution. Mettant son art au service de la nation, David adopte un style plus réaliste comme l'attestent le Serment du Jeu de paume, resté inachevé, et Marat assassiné (1793).
• Après la chute de Robespierre, David peint les Sabines (1799), toile qui lui vaut la faveur de Bonaparte, grand admirateur de l'ordre romain.
• Il peint alors le portrait équestre de Bonaparte au col du Grand Saint-Bernard (1800), plus flatteur que véridique, avant de s'atteler, durant près de trois ans, à la commande du Sacre de Napoléon I\" (1807), une immense galerie de portraits à la composition savante. C'est l'une des quatre toiles destinées à glorifier l'Empire avec l'intronisation, /'Arrivée à l'Hôtel de Ville et la Distribution des aigles. Seule la dernière, un tableau imposant au souffle épique, est finalement exécutée (1810), en plus du Sacre.
• Après la chute de l’Empire, David s'exile à Bruxelles où il travaille jusqu'à sa mort en 1825.
• Plutôt libéral, axé sur la valeur primordiale du dessin d’après nature, l'enseignement qu'il dispense toute sa vie influence de nombreux peintres. Parmi eux, de jeunes talents se distinguent, opposant à la tension héroïque prônée par leur maître une douceur personnelle : Gérard (1770-1837) peint ainsi Psyché reçoit le premier baiser de l'Amour et Girodet-Trioson (1767-1824) le Sommeil d'Endymion etAtala au tombeau. Figurent aussi parmi ses élèves des artistes à la personnalité indépendante, qui seront à la source des courants majeurs de la peinture au xixe siècle, tels Pierre-Paul Prud'hon (1758-1823), Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-1867) ou Antoine Gros (1771-1835).
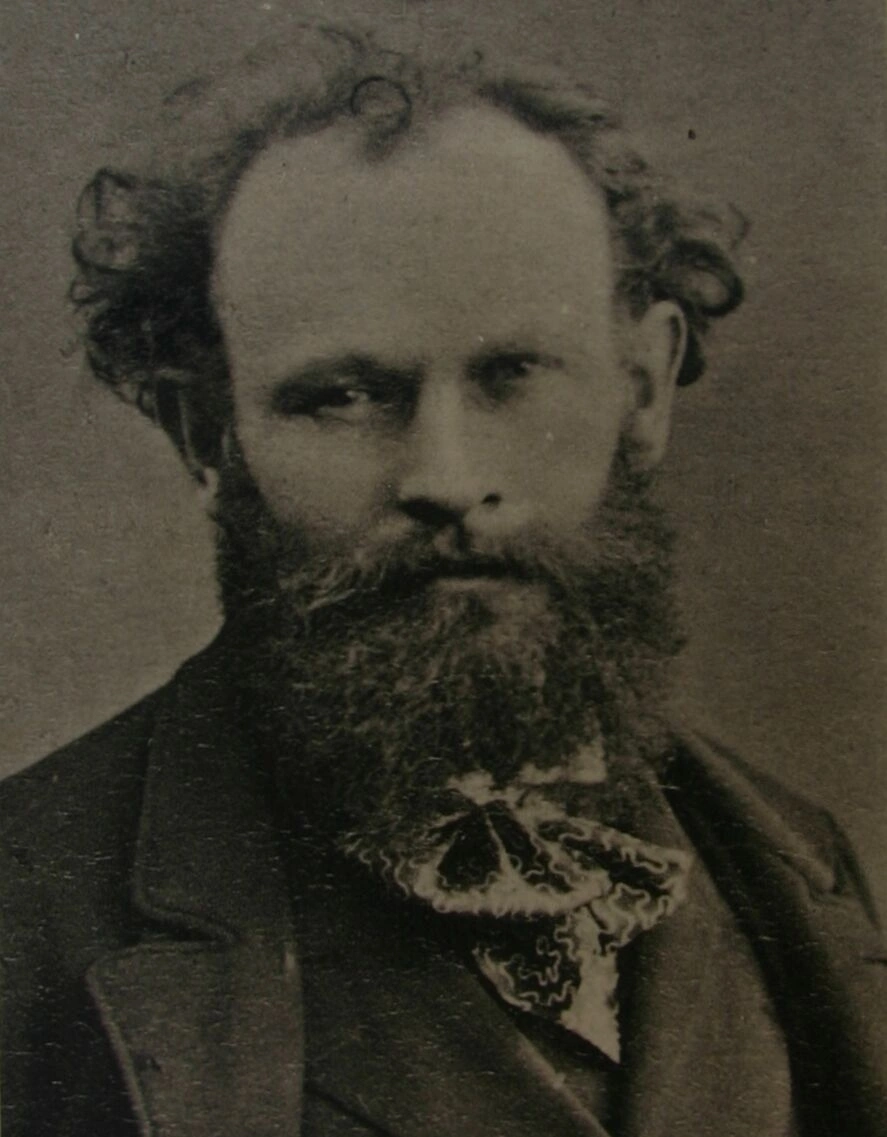
«
•
Précurseur du romantisme, Gros
substitue au néoclassicisme dépouillé
de David de vastes compositions aux
thèmes d'actualité, qu'il traite grâce
à une palette vive et expressive.
• Ces premières œuvres audacieuses,
admirées par Delacroix et Géricault,
sont suivies de tableaux mythologiques
plus conventionnels.
Ce retour en arrière
est sanctionné par la désaffection du
public qui pousse Gros au suicide en 1835.
THÉODORE (ÎÉRICAULT
• A l'instar de Gros, Géricault incarne
l'artiste maudit à la vie courte et
tourmentée.
Chantre du désespoir et de
la souffrance humaine, il prend bientôt
la tête du jeune mouvement romantique.
• Formé successivement dans les ateliers
de Carle Vernet et de Pierre Guérin
(élève de David) et à l'École des
beaux-arts de Paris, il complète son
enseignement par un séjour à Florence
et à Rome où il s'enthousiasme pour
l'œuvre de Michel-Ange et de Rubens.
• Dès le début de sa carrière,
Géricault, sous l'influence de Gros,
privilégie les thèmes de la vie
quotidienne et de l'actualité politique
qu'il traite comme de hauts faits
héroïques dans des toiles de grandes
dimensions.
Son Officier
• Ce style exalté trouve son
accomplissement dans le Rode11u
de /11 Méduse, remarqué au Salon de
1819.
S'inspirant d'un fait divers
tragique, l'œuvre représente
les rescapés du naufrage de la frégate
La Méduse au large de la Mauritanie.
La composition pyramidale, le clair
obscur et la présence de figures
directement inspirées des exercices
académiques contrastent avec le
traitement réaliste de l'agonie et la
nature même du sujet, allégorie
politique d'une modernité indiscutable.
Le tableau déclenche une vague de
violentes polémiques que Géricault
esquive en accompagnant le tableau
dans une exposition itinérante de deux
années en Angleterre et
en Irlande.
Il rapporte de ce séjour
outre-Manche le remarquable
Derby d'Epsom (1821).
EUCENE DELACROIX
• Delacroix entre en 1815 dans l'atelier
de Pierre Guérin, où il se lie d'amitié
avec Géricault, puis l'année suivante
à l'École des beaux-arts.
• Envoyé au Salon, son premier tableau,
Dante et Virgile aux Enfers (1822),
étonne par la nouveauté du thème et
la violence de la palette et des attitudes, fort
éloignées des règles de
l'enseignement académique.
Le peintre est à cette époque sous
la forte influence de son ami Géricault.
· À la mort de ce dernier, en 1824,
il lui succède comme chef de fil du
·�····· romantisme
pictural.
Les
MIISSIICres de Scio (1824)
se distinguent
ainsi du style
néoclassique
par l'actualité
du thème,
par la hardiesse de la composition
et des tonalités.
Les représentants du
néoclassicisme, en particulier Ingres,
sont indignés.
Ils le sont plus encore
à la découverte, au Salon de 1828,
de 111 Mort de Sllrdllnllptlle (1827),
une toile sensuelle et violente inspirée
d'un poème de Byron, qui mêle
profusion des personnages, luxe
oriental et audace des couleurs.
• En 1832, le voyage qu'il effectue
en Afrique du Nord le bouleverse.
Fasciné par les couleurs et les lumières
de l'Orient il devient l'un des
représentants majeurs de l'orientalisme
français.
Ses croquis et aquarelles
exécutés sur le vif, sont à l'origine
de tableaux majeurs : Femmes
d'Alger dans leur apparte ment (1834),
la Noce juive au Maroc (1839),
le Sultan du Maroc (1845).
• De retour en France, Delacroix
entame une carrière de décorateur.
Il exerce ses talents au Palais-Bourbon
(salon du Roi et bibliothèque, 1833-
1847), au Sénat (bibliothèque, 1840-
1847) et au Louvre (galerie Apollon, 1850-1851),
perfectionnant la technique
du « flochetage » qui annonce, par la
juxtaposition des couleurs hachurées
et entrelacées, le style impressionniste.
WPAYSAGimS
· À partir de 1830, le genre du paysage
prend progressivement une place
prépondérante, focalisant toutes
les nouvelles tendances picturales,
du naturalisme au réalisme pré
impressionniste.
lEAN-BAPTISTE COROT
• Le plus grand paysagiste français
du x1x' siècle, Jean-Baptiste Corot
(1796-1875), est l'un des premiers
peintres à réaliser des études et des
croquis d'après nature et en plein air.
• Remarquables par la qualité de
la lumière et la vérité des couleurs,
ces esquisses sont ensuite transformées
en tableaux à l'atelier.
Le sens de la
composition hérité de l'enseignement
académique y est contrebalancé
par un réseau de touches juxtaposées,
légères et de tons argentés -I'Ét11ng
de Ville d'Avr11y et Souvenir
de Mortefontaine (1864).
• Au fil de quelque 4 000 toiles,
Corot se positionne à la fois comme
l'un des continuateurs de la tradition
paysagiste incarnée par Poussin
et Le Lorrain et comme l'un des
précurseurs de l'impressionnisme.
l'ÉCOLE DE BARBIZON
• Autres paysagistes avant-gardistes,
les peintres de l'école de Barbizon
sont unis dans leur opposition aux
conventions picturales classiques
véhiculées par la très conservatrice
Académie des beaux-arts.
1-------------� ·À l'exemple de Corot, ils
HONORÉ DAUMIER
• Le romantisme ne meurt pas avec
Delacroix en 1863.
Honoré Daumier
(1808-1879) reprend le flambeau
avec des peintures, très longtemps
sous-évaluées, où 1 'on retrouve
le même engagement et la même
volonté réaliste que ses dessins.
• De 1848 à 1868, il est l'un des rares
peintres à regarder le monde qui
évolue autour de lui.
Il représente,
dans des clairs-obscurs appuyés,
l'humanité au travail et la vie
quotidienne des plus humbles -1•
BIIIIKhls
seuse
(v.
1863),
l'Homme
à la corde
à nœuds
(1862),
le Wagon
de troisiéme
classe (1862) -,
mais aussi le romantique Don
Quichotte {1850-1860).
• Ces toiles à la facture riche et
dynamique font de Daumier l'un
des précurseurs de l'expressionnisme.
se
distinguent par leur habitude
de peindre sur le vif, en extérieur,
avant d'achever leurs toiles en atelier.
Ils pratiquent leur art aux alentours
du village de Barbizon, en forêt de
Fontainebleau, entre 1840 et 1870.
• Théodore Rousse11u, chef de file
en titre, Charles François Daubigny,
Narcisse Virgile Diaz de La Peiia,
Jules Dupré, Constant Troyon prônent,
chacun à leur manière, un retour
à la nature qui doit autant aux thèses
de Jean-Jacques Rousseau qu'à
la pratique des paysagistes anglais
de leur époque comme John Constable
ou Richard Parkes Bonington.
• Attachés au naturel et à l'emploi
d'une palette réaliste appliquée, dès
1855, par fines touches juxtaposées
pour augmenter la lumière, ils
participent à l'essor du réalisme
et à la genèse de l'impressionnisme.
l'ESSOR
DU RÉALISME
• Introduit par le genre du paysage cher
aux peintres de l'école de Barbizon, le
réalisme se diffuse en France vers 1850
autour de la peinture de Jean-François
Millet {1814-1875) et encore plus de celle
de Gustave Courbet (1819-18n).
Ceux
ci hissent au niveau du « grand genre »,
c'est-à-dire de la peinture d'histoire,
les scènes de la vie quotidienne.
lEAN-fRAN 015 MILLET
• En peignant ses scènes paysannes,
Millet donne à son œuvre qualifiée
de « réaliste » une dimension plus
poétique que sociale, empreinte
de nostalgie et de recueillement.
• Après une formation académique,
Millet est d'abord portraitiste, peignant
aussi des idylles pastorales dans la
tradition du Corrège et de Prud'hon.
C'est la révolution de 1848 qui l'oriente
davantage vers l'homme du peuple.
Ami de Narcisse Virgile Diaz de La Peiia
et de Théodore Rousseau, il s'installe
vers 1849 à Barbizon, se consacrant
dès lors à la peinture réaliste et poétique
du terroir : les G/11neuses (1857),
l'Angélus {1859), le Semeur (1850), les
Planteurs de pommes de terre (1862).
• À partir de 1860, il exécute des
paysages magnifiant la nature et
relatant la dure vie campagnarde
-l e cycle des saisons (1868-1874).
• Son œuvre influencera profondément
Van Gogh, Pissarro et Seurat.
GUSTAVE COURBET
• Profondément anticonformiste, Courbet
se forme lui-même en copiant les
chefs-d'œuvre de Géricault et Delacroix
exposés au Louvre et en peignant
dans la forêt de Fontainebleau.
• Après des premières œuvres à la
sensibilité romantique, le peintre est
bouleversé par la découverte, en 1846,
de l'œuvre de Rembrandt, qui le pousse
à peindre la réalité sans artifice.
• Après la révolution de 1848, ce jeune
républicain militant s'oriente vers un
réalisme social engagé -les Casseurs
de pierres (1849) -qui le conduit au
scandale d'Un enterrement il Orn11ns
{1850), exposé au Salon de 1851.
La
toile monumentale choque autant par
la «vulgarité » de son sujet et de ses
personnages, des paysans pauvrement
vêtus, que par l'âpreté de sa palette
contrastée.
t:événement fait de Courbet
le chef de file du mouvement réaliste.
• En 1855, Courbet fait construire
le « pavillon du réalisme » pour exposer
quarante de ses tableaux refusés par le jury
de
l'Exposition
universelle, parmi lesquels
les Cribleuses
de blé {1855)
et l'Atelier
{1855, détail),
une synthèse
de l'époque où
se mêlent rêve et réalité, qu'il sous-titre
« Allégorie réelle, histoire morale et
physique de mon atelier ».
• Il publie bientôt le Manifeste du
réalisme, affirmant« vouloir faire
de l'art vivant».
Ainsi Courbet peint-il,
sans fard ni complaisance, ses modèles
féminins -Demoiselles des bords de
la Seine {1857), le Sommeil {1866) ou
encore l'étonnant Origine du monde,
gros plan sur un sexe féminin.
• La nouveauté de telles œuvres lui
valent une certaine notoriété.
Parmi ses
admirateurs figure Jules Bastien-Lepage
(1848-1884) qui, comme lui, emprunte
ses thèmes à la réalité quotidienne.
• En 1875, Courbet découvre Édouard
Manet {1832-1883) dont il tente de
suivre la voie.
"Je me suis mis à faire
ce que je voyais , tâchant d'oublier
ce qu'on m'avait appris», écrit-il.
ÉDOUARD MANET
• Formé par la fréquentation des musées
et non par l'observation directe de la
nature, mais conscient des impératifs
de la modernité, Manet construit une
œuvre charnière entre le romantisme
de Delacroix, le naturalisme de Courbet
et l'impressionnisme à venir.
li impose
une nouvelle manière de voir, née de la
sensation immédiate.
Ainsi le Bain (1863),
rebaptisé par la suite le Déjeuner
sur l'herbe, révèle un traitement
sans compromis qui scandalise
par ses modelés aux violents effets
de contraste et ses formes simplifiées.
• Olympi• (1863) choque à nouveau
par son sujet et surtout par le contraste
entre les zones claires et foncées..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La peinture française du xviie siècle (Exposé – Art – Collège/Lycée)
- La peinture française sous Louis XV (Exposé – Art & Littérature – Collège/Lycée)
- La peinture française du xviie siècle (Exposé – Art & Littérature – Collège/Lycée)
- LA PEINTURE ESPAGNOLE (Exposé – Art & Littérature – Collège/Lycée)
- LA PEINTURE SYMBOLISTE (Exposé – Art & Littérature – Collège/Lycée)