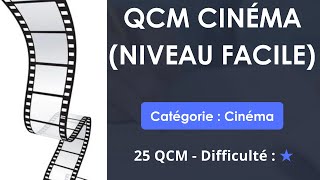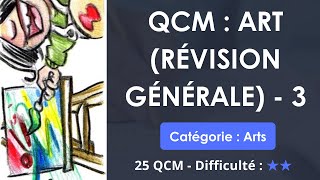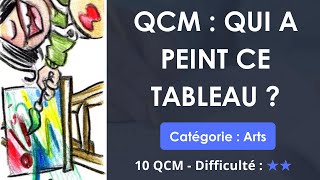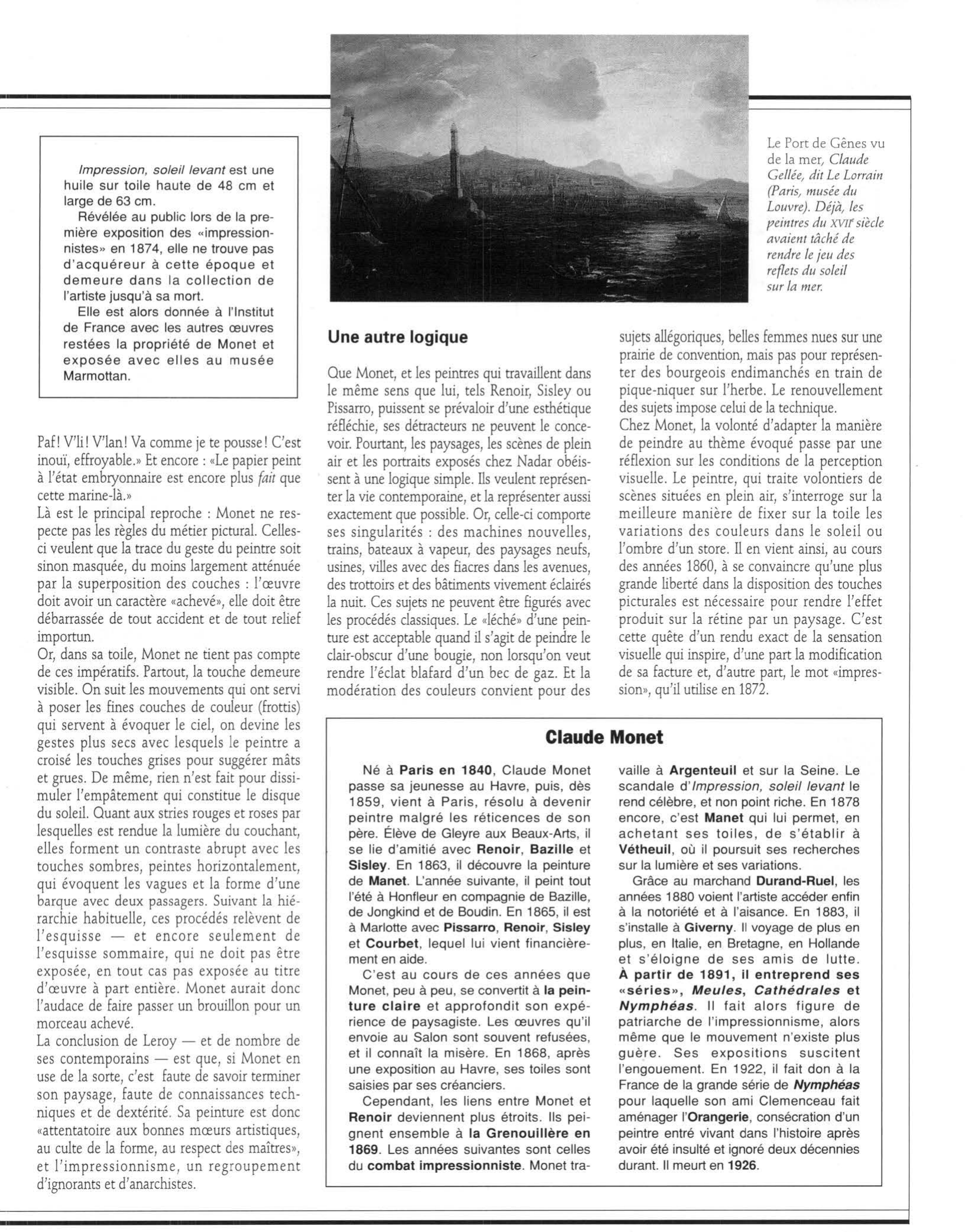IMPRESSION, SOLEIL LEVANT
Publié le 14/09/2014

Extrait du document
«
Impression , soleil levant est une
hu ile sur toile hau te de 48 c m et large de 63 c m.
Révélée au publi c lor s de la pre
mière exposition des
"impression
nistes » en 1874 , elle ne tr ouv e pa s
d ' acquéreu r à c ette époque et demeure dan s la c ollec tion de l'art iste jusqu 'à sa mort.
Elle est alors donnée à l'Institut de France avec les autr es œuvres
r
estées la propriét é de Monet et exposée avec elles au musée Marmottan .
Paf! V'li! V'lan! Va comme je te pousse! C'est
i n
ouï, effroyable. » Et encore : •Le pap ier peint
à l'état embryonnaire est enco re plus fait que
cette marine-là. »
Là est le p rinc ipal reproche : Monet ne res
pecte pas les règles du métier pictu ral.
Celles
ci veulent que la trace du geste du peintre soit
sinon masquée, du moins largemen t attén u ée
par la superposition des couches : l'œuvre
doit avoir un caractère •achevé » , elle doit être
débarrassée de tout accident et de tout relief
importun.
Or, dans sa toile, Monet ne tien t pas compte
de ces im p érat ifs.
Partout, la touche demeure
visible .
On suit les mouvements qui ont servi
à poser les fines couches de couleur (frottis )
qui servent à évoquer le ciel , on devine les
gestes plus secs avec lesquels le peintre a
croisé les touches grises pour suggérer mâts
et grues .
De même , rien n 'est fait pour dissi
muler l' e m pâtement qui consti tue le disque
du soleil.
Quant aux stries rouges et roses par
lesque lles est rendue la lumière du couchant ,
elles forment un contras te abrupt avec les
touches sombres, peintes horizontalement ,
qui évoquent les vagues et la forme d'u ne
barque avec deux passagers.
Suivant la hié
rarchie habituelle , ces procédés relèvent de
l' esquisse -et encore seulemen t de
l'esquisse sommaire, qui ne doit pas être
exposée, en tout cas pas expo sée au titre
d 'œuvre à part entière .
Monet aura it donc
l'audace d e faire passe r un brouillon pour un
mo rceau achevé.
La conclusion de Leroy - et de nom bre de
ses contemporains -est qu e, s i Monet en
use de la sorte , c'est faut e de sav oir terminer
son paysage , faute de connaissan ce s tech
niques et de dextérité .
Sa peinture est donc
•attentatoi re aux bonnes mœurs artistiques ,
au culte de la forme , au resp ect des maîtres »,
e t l'impressionni sm e, un reg roupem ent
d 'i g
norants et d 'anar chiste s.
Une autre logique
Oue Monet , et les peintres qui travaillent dans
le même sens que lui, tels Reno ir, Si sley ou
Pissarro, puissen t se prévaloir d'une esthétique
réfléchie , ses détrac teurs ne peuvent le conce
voir.
Pourtant, les paysages, les scènes de plein
air et les portraits exposés che z Nadar obéis
sen t à une logique simple.
Ils veulent représen
ter la vie contemporaine , et la représente r aussi
exac temen t que poss ible.
Or, celle -ci comporte
ses singu l ari tés : des machines nouvelles,
trains, bateau x à vapeur , des paysages neufs ,
usines , villes avec des fiacres dans les avenues ,
des trottoirs et des bâtiments vivement éclairés
la nui t.
Ces sujets ne peuvent être figurés avec
les procédés classiques.
Le •léché » d'une pein
ture est acceptable quand il s 'agit de peind re le
clair-obscur d 'une bougie , non lorsqu'on veut
rendre l'éclat blafard d'un bec de gaz .
Et la
modéra tion des couleurs conv i ent pou r des
Le Port de Gênes vu
de la m er, Claud e
Ge llée, dit l e lorrain (Pari s, mus ée du
Lou vre).
D éjà, les peintr es du XVlf siècle a vai e nt tâch é de re ndr e le jeu d es
reflets du soleil
s ur l a me r.
sujets allégoriques, belles femmes nues sur une
prairie de convention , mais pas pou r représen
t
er des bourgeois end imanchés en tra i n de
p ique-nique r sur l'herbe.
Le renouvellement
des sujets impose celu i de la techni que.
Chez Mone t, la volonté d 'a d apte r la manière
de peindre au thème évo qué passe par une
réflexion sur les conditions de la perception
visuelle.
Le peint re , qui traite volont ie rs de
scènes s ituées en plein air, s' interroge sur la
mei lleure mani ère de fixer sur la toile l es
variations des cou leurs dans le s o leil ou
l'om bre d'un st o re.
Il en vient ainsi , au cou rs
des années 1860 , à se convaincre qu'une p lus
grande liberté dans la d ispositi on des touches
picturales est nécessai re pour rendre leffet
produi t sur la rétine par un p ay sage .
C' est
cette quête d'un rendu exact de la sensation
v isue lle qui inspire , d'une part la modif ication
de sa facture et, d' autre par t, le mot •imp res
sion », qu'il utilise en 1872.
Claude Monet
N é à Pari s e n 1840 , Cl aude Mon et
passe sa j eun esse au Havr e, pui s, dès
1859 , vient à Par is , résolu à devenir peintr e m a lgr é le s ré ti ce nces de son pèr e.
Élève de G le y re aux Beaux-Art s, il s e lie d 'amiti é av ec Re noir , Ba zill e et Sisley .
En 1863 , il déc ouvre la p einture
de Manet.
L'anné e s uivante , il peint tout l'é té à Honfleur en compagni e de Bazill e, de Jongkind et de Boudin.
En 1865 , il est à Marlott e ave c Pi ssa rro , R e noir , Si sle y et Courb e t, lequ el lu i vient financiè re
ment en a ide .
C '
est au cours de ce s année s que Monet , p e u à p eu , se conv ertit à la pe in ture c la ire et appr o fo nd it s on expé rien ce de pay sagi ste.
Les œ uvres qu 'il envoie au Salon s ont souvent refusée s, et il c onnaît la mi sère.
En 1868 , apr ès
une expos ition au Havre , se s toil es son t
sais ies par ses créa ncier s.
Ce pe nd a
nt, les lie ns entre Monet et
R eno ir devie nn ent plu s étr oits.
Ils pei
gn ent ense mb le à la Gren ouill è re e n
1 869.
Les année s suivantes sont
c elle s du c omb at i mp ress ionnist e.
M onet tr a-
vai lle à A rg e nteu il et su r la S eine .
Le scandale d ' Impression, soleil levan t le r end cé lè br e, e t non point ric he .
En 1878
e nco re, c' est M an et q ui lui p erm et, en ac het an t ses to i les, d e s'ét ab lir à V é theu il, où il pour su it ses reche rches
s u r la lu mi ère e t s es v ariation s.
G râc e au mar chand Durand -Ru e!, le s ann ées 1880 voi ent l'arti ste accéder enfin à l a n o to rié té et à l'ai sance .
En 1883 , il
s 'i nstalle à Giv erny .
Il v o ya ge de plus en p lus , en It a lie, en B retagne, en H olla nde e t s'é lo igne de ses amis de lutte.
À p art ir d e 1891 , il entr eprend ses «sé ries », M e ules, Ca thédrales et
N y mph éas .
Il fa it alors fig ure de
p atri arc he de l'i m press ion ni sme, alors mêm e qu e le mouve ment n' exis te p lu s gu ère .
Ses expositions s u sciten t l'e ng ou emen t.
En 1922, il fai t don à la F ran ce de la gran de sé rie de Nym ph éas pou r la quell e son ami Clemencea u fai t
am énage r !'Orangerie , con sécra tion d'un
p ei ntre entré vivant dans
l'hi sto ire après
a voi r été ins ulté e t ig nor é de ux déce nnies
du rant.
Il meu rt en 1926..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Claude Monet : Impression, soleil levant
- Claude MONET : IMPRESSION, SOLEIL LEVANT
- Impression, soleil levant [Claude Monet] - étude du tableau.
- IMPRESSION, SOLEIL LEVANT DE MONET
- Monet: Impression Soleil Levant