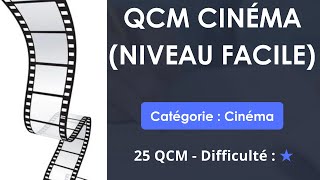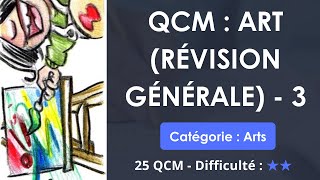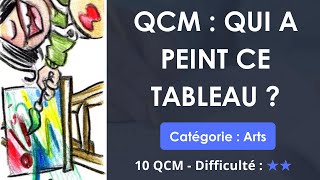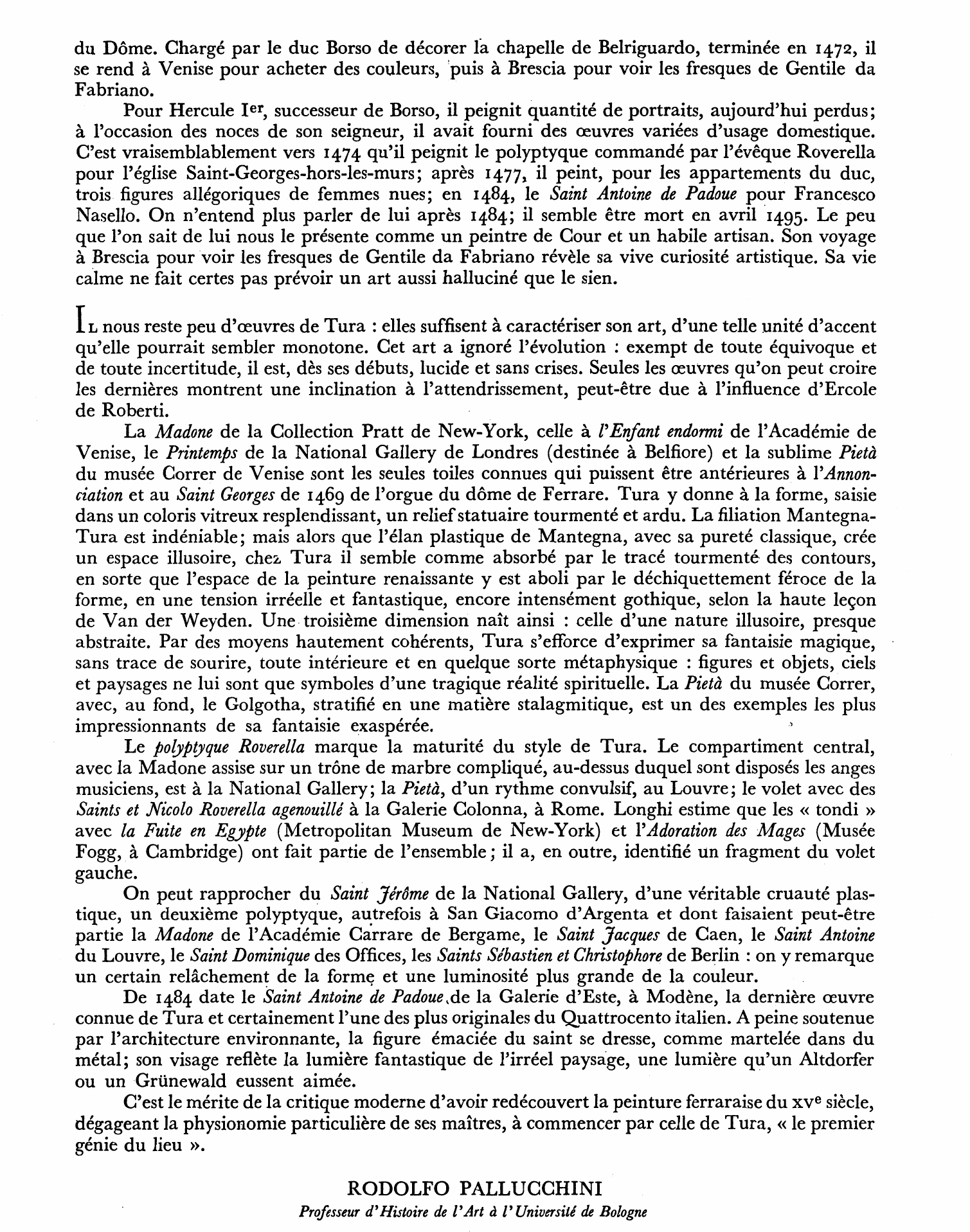COSME TURA
Publié le 25/06/2012
Extrait du document
On peut rapprocher du Saint Jérôme de la National Gallery, d'une véritable cruauté plastique, un deuxième polyptyque, autrefois à San Giacomo d'Argenta et dont faisaient peut-être partie la Madone de l'Académie Carrare de Bergame, le Saint Jacques de Caen, le Saint Antoine du Louvre, le Saint Dominique des Offices, les Saints Sébastien et Christophore de Berlin : on y remarque un certain relâchement de la forme et une luminosité plus grande de la couleur.
«
du Dôme.
Chargé par le duc Borso de décorer la chapelle de Belriguardo, terminée en 1472, il
se rend à Venise pour acheter des couleurs, 'puis à Brescia pour voir les fresques de Gentile da
Fabriano.
Pour Hercule Jer, successeur de Borso, il peignit quantité de portraits, aujourd'hui perdus;
à l'occasion des noces de son seigneur, il avait fourni des œuvres variées d'usage domestique.
C'est vraisemblablement vers 1474 qu'il peignit le polyptyque commandé par l'évêque Roverella
pour l'église Saint-Georges-hors-les-murs; après 1477, il peint, pour les appartements du duc,
trois figures allégoriques
de femmes nues; en 1484, le Saint Antoine de Padoue pour Francesco
Nasello.
On n'entend plus parler de lui après 1484; il semble être mort en avril 1495.
Le peu
que l'on sait de lui nous le présente comme un peintre de Cour et un habile artisan.
Son voyage
à Brescia pour voir les fresques de Gentile da Fabriano révèle sa vive curiosité artistique.
Sa vie
calme ne fait certes pas prévoir un art aussi halluciné que le sien.
IL nous reste peu d'œuvres de Tura: elles suffisent à caractériser son art, d'une telle unité d'accent
qu'elle pourrait sembler monotone.
Cet art a ignoré l'évolution : exempt de toute équivoque et
de toute incertitude, il est, dès ses débuts, lucide et sans crises.
Seules les œuvres qu'on peut croire
les dernières montrent une inclination à l'attendrissement, peut-être due à l'influence d'Ercole
de Roberti.
La Madone de la Collection Pratt de New-York, celle à l'Enfant endormi de l'Académie de
Venise, le Printemps de la National Gallery de Londres (destinée à Belfiore) et la sublime Pietà
du musée Carrer de Venise sont les seules toiles connues qui puissent être antérieures à l'Annon
ciation et au Saint Georges de 1469 de l'orgue du dôme de Ferrare.
Tura y donne à la forme, saisie
dans
un coloris vitreux resplendissant, un relief statuaire tourmenté et ardu.
La filiation Mantegna
Tura est indéniable; mais alors que l'élan plastique de Mantegna, avec sa pureté classique, crée
un espace illusoire, che:t.
Tura il semble comme absorbé par le tracé tourmenté des contours,
en sorte que l'espace de la peinture renaissante y est aboli par le déchiquettement féroce de la
forme,
en une tension irréelle et fantastique, encore intensément gothique, selon la haute leçon
de
Van der Weyden.
Une troisième dimension naît ainsi : celle d'une nature illusoire, presque
abstraite.
Par des moyens hautement cohérents, Tura s'efforce d'exprimer sa fantaisie magique,
sans trace de sourire, toute intérieure
et en quelque sorte métaphysique : figures et objets, ciels
et paysages ne lui sont
que symboles d'une tragique réalité spirituelle.
La Pietà du musée Carrer,
avec, au fond, le Golgotha, stratifié en une matière stalagmitique, est un des exemples les plus
impressionnants
de sa fantaisie exaspérée.
Le
polyptyque Roverella marque la maturité du style de Tura.
Le compartiment central,
avec
la Madone assise sur un trône de marbre compliqué, au-dessus duquel sont disposés les anges
musiciens, est
à la National Gallery; la Pietà, d'un rythme convulsif, au Louvre; le volet avec des
Saints et Nicola Roverella agenouillé à la Galerie Colonna, à Rome.
Longhi estime que les « tondi »
avec la Fuite en Egypte (Metropolitan Museum de New-York) et l'Adoration des Mages (Musée
Fogg,
à Cambridge) ont fait partie de l'ensemble; il a, en outre, identifié un fragment du volet
gauche.
On peut rapprocher du Saint Jérdme de la National Gallery, d'une véritable cruauté plas
tique,
un deuxième polyptyque, a~trefois à San Giacomo d'Argenta et dont faisaient peut-être
partie
la Madone de l'Académie Carrare de Bergame, le Saint Jacques de Caen, le Saint Antoine
du Louvre, le Saint Dominique des Offices, les Saints Sébastien et Christophore de Berlin : on y remarque
un certain relâchement de la formç et une luminosité plus grande de la couleur.
De 1484 date le Saint Antoine de Padoue ,de la Galerie d'Este, à Modène, la dernière œuvre
connue de Tura et certainement l'une des plus originales du Quattrocento italien.
A peine soutenue
par l'architecture environnante, la figure émaciée du saint se dresse, comme martelée dans du
métal; son visage reflète la lumière fantastique de l'irréel paysage, une lumière qu'un Altdorfer
ou
un Grünewald eussent aimée.
C'est le mérite de la critique moderne d'avoir redécouvert la peinture ferraraise du xve siècle,
dégageant
la physionomie particulière de ses maîtres, à commencer par celle de Tura, « le premier
génie
du lieu ».
RODOLFO PALLUCCHINI
Professeur d'Histoire de l'Art à l'Université de Bologne
139.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TURA Cosme: Madone et enfant endormi (analyse du tableau).
- Cosme Tura
- Tura, Cosmè - peintre.
- Cosme Ier de Médicis par Luciano Berti Directeur de la Galerie des
- Tura, Cosmè - biographie.