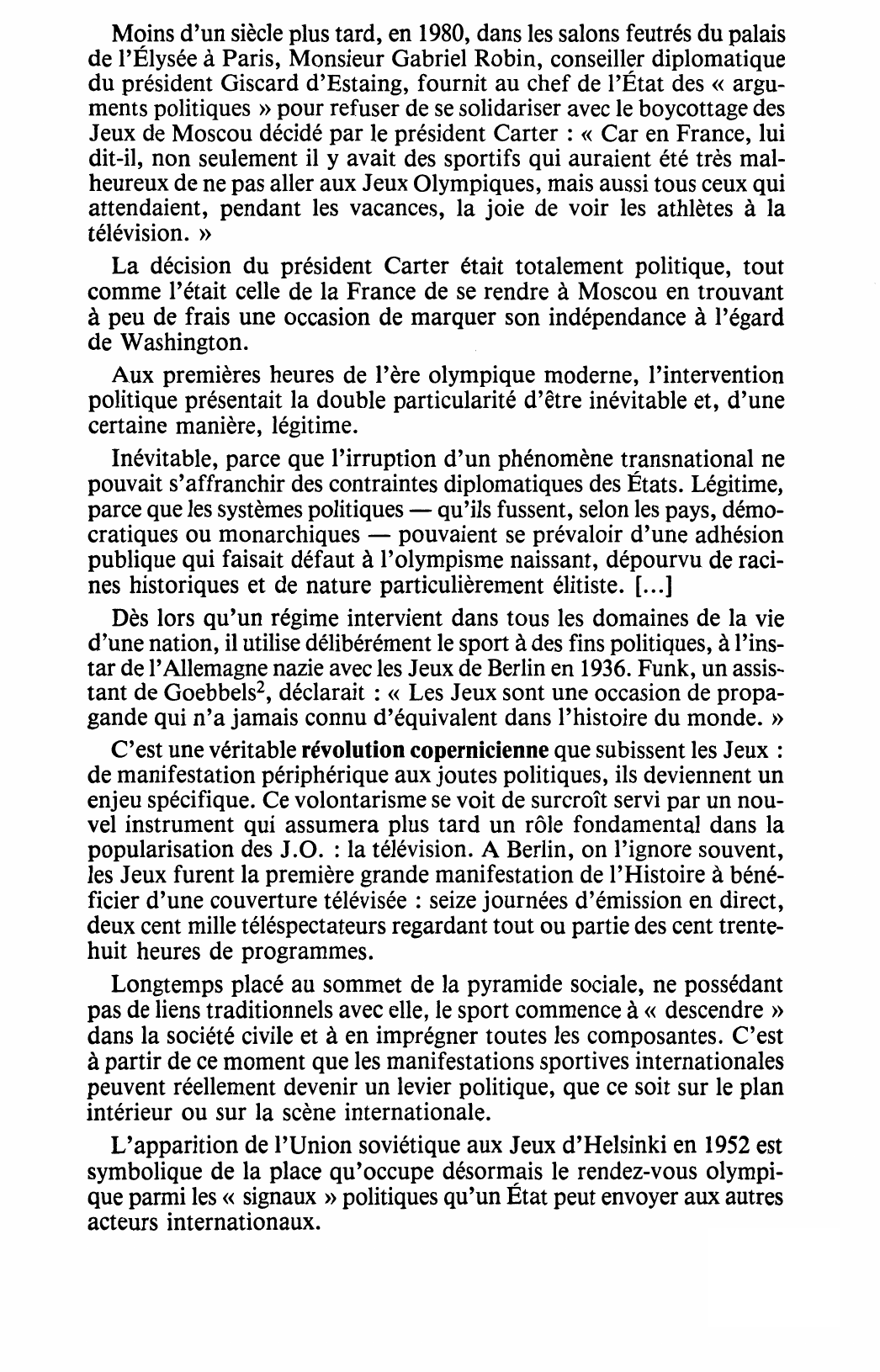Xavier DELACROIX, Le Monde diplomatique
Publié le 21/06/2012
Extrait du document
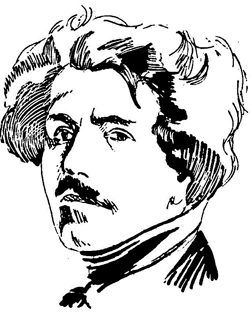
septembre 1988.
Paraphrasant Clemenceau, un observateur attentif aux récents développements
intervenus sur la scène sportive internationale pourrait dire
que le sport est une chose trop sérieuse pour être confiée à des sportifs.
La politique n'a pas fait soudainement irruption dans le sportet
en particulier dans l'arène olympique- au gré de circonstances fortuites
ou injustes.
Dès 1896, elle lui était associée. Cela se passait à Athènes, à l'occasion
des premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, lorsque le prince
héritier Constantin descendit sur la piste pour accompagner son compatriote
Spiridon Louis dans les dernières foulées de son marathon victorieux.
Cette même année, le jeune journaliste Charles Maurras', parlant
de ces Jeux, écrivait, visionnaire : « Cet internationalisme-là ne
tuera pas les patries, mais les fortifiera. «
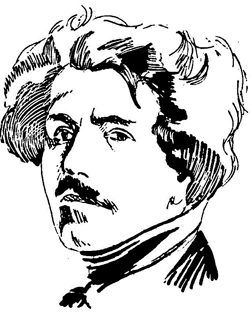
«
RÉSUMÉ.
QUESTIONS DE VOCABULAIRE DISCUSSION
Moins d'un siècle plus tard, en 1980, dans les salons feutrés du palais
de l'Élysée
à Paris, Monsieur Gabriel Robin, conseiller diplomatique
du président Giscard d'Estaing, fournit
au chef de l'État des« argu
ments politiques
» pour refuser de se solidariser avec le boycottage des
Jeux de Moscou décidé par
le président Carter : « Car en France, lui
dit-il, non seulement
il y avait des sportifs qui auraient été très mal
heureux de ne pas aller aux Jeux Olympiques, mais aussi tous ceux qui
attendaient, pendant
les vacances, la joie de voir les athlètes à la
télévision.
))
La décision du président Carter était totalement politique, tout
comme l'était celle de
la France de se rendre à Moscou en trouvant
à peu de frais une occasion de marquer son indépendance à l'égard
de Washington.
Aux premières heures de l'ère olympique moderne, l'intervention
politique présentait la double particularité d'être inévitable et, d'une
certaine manière, légitime.
Inévitable, parce que l'irruption
d'un phénomène transnational ne
pouvait s'affranchir
des contraintes diplomatiques des États.
Légitime,
parce que
les systèmes politiques- qu'ils fussent, selon les pays, démo
cratiques ou monarchiques -pouvaient
se prévaloir d'une adhésion
publique qui faisait défaut
à l'olympisme naissant, dépourvu de raci
nes historiques et de nature particulièrement élitiste.
[ ...
]
Dès lors
qu'un régime intervient dans tous les domaines de la vie
d'une nation,
il utilise délibérément le sport à des fins politiques, à l'ins
tar de l'Allemagne nazie avec les Jeux de Berlin en 1936.
Funk, un assis
tant de Goebbels 2
, déclarait : « Les Jeux sont une occasion de propa
gande qui
n'a jamais connu d'équivalent dans l'histoire du monde.
))
C'est une véritable révolution copernicienne que subissent les Jeux :
de manifestation périphérique aux joutes politiques,
ils deviennent un
enjeu spécifique.
Ce volontarisme
se voit de surcroît servi par un nou
vel instrument qui assumera plus tard un rôle fondamental dans la
popularisation des J
.0.
: la télévision.
A Berlin, on l'ignore souvent,
les Jeux furent la première grande manifestation de l'Histoire
à béné
ficier d'une couverture télévisée : seize journées d'émission en direct,
deux cent mille téléspectateurs regardant tout ou partie des cent trente
huit heures de programmes.
Longtemps placé
au sommet de la pyramide sociale, ne possédant
pas de liens traditionnels avec elle,
le sport commence à « descendre ))
dans la société civile et à en imprégner toutes les composantes.
C'est
à partir de ce moment que les manifestations sportives internationales
peuvent réellement devenir un levier politique, que
ce soit sur le plan
intérieur ou sur la scène internationale.
L'apparition de
l'Union soviétique aux Jeux d'Helsinki en 1952 est
symbolique de la place qu'occupe désormais
le rendez-vous olympi
que parmi
les « signaux )) politiques qu'un État peut envoyer aux autres
acteurs internationaux..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Si l'ensemble est intéressant, le lecteur regrettera que les exemples restent totalement anonymes afin de « ne pas gêner » l'AFD, où exerce l'auteur. ? Le Monde diplomatique.fr
- La majorité des articles de presse sont ainsi devenus virtuellement invisibles. Le Monde diplomatique.fr
- Claude JULIEN, Le Monde diplomatique, Liberté
- Ignacio RAMONET, Le Monde diplomatique, mai 1988, «Une culture de l'exclusion»
- « Un journal n'a pas à suivre ses lecteurs, à leur complaire. S'il se veut à leur service, ce ne saurait être pour flatter leurs tendances naturelles. Il honore son public en refusant de céder aux engouements, à la mode du jour ! » En appuyant votre réflexion sur des arguments et des exemples précis, vous discuterez ces propos de Beuve-Méry —fondateur du journal Le Monde — rapportés par Claude Julien dans Le Monde diplomatique de septembre 1989.