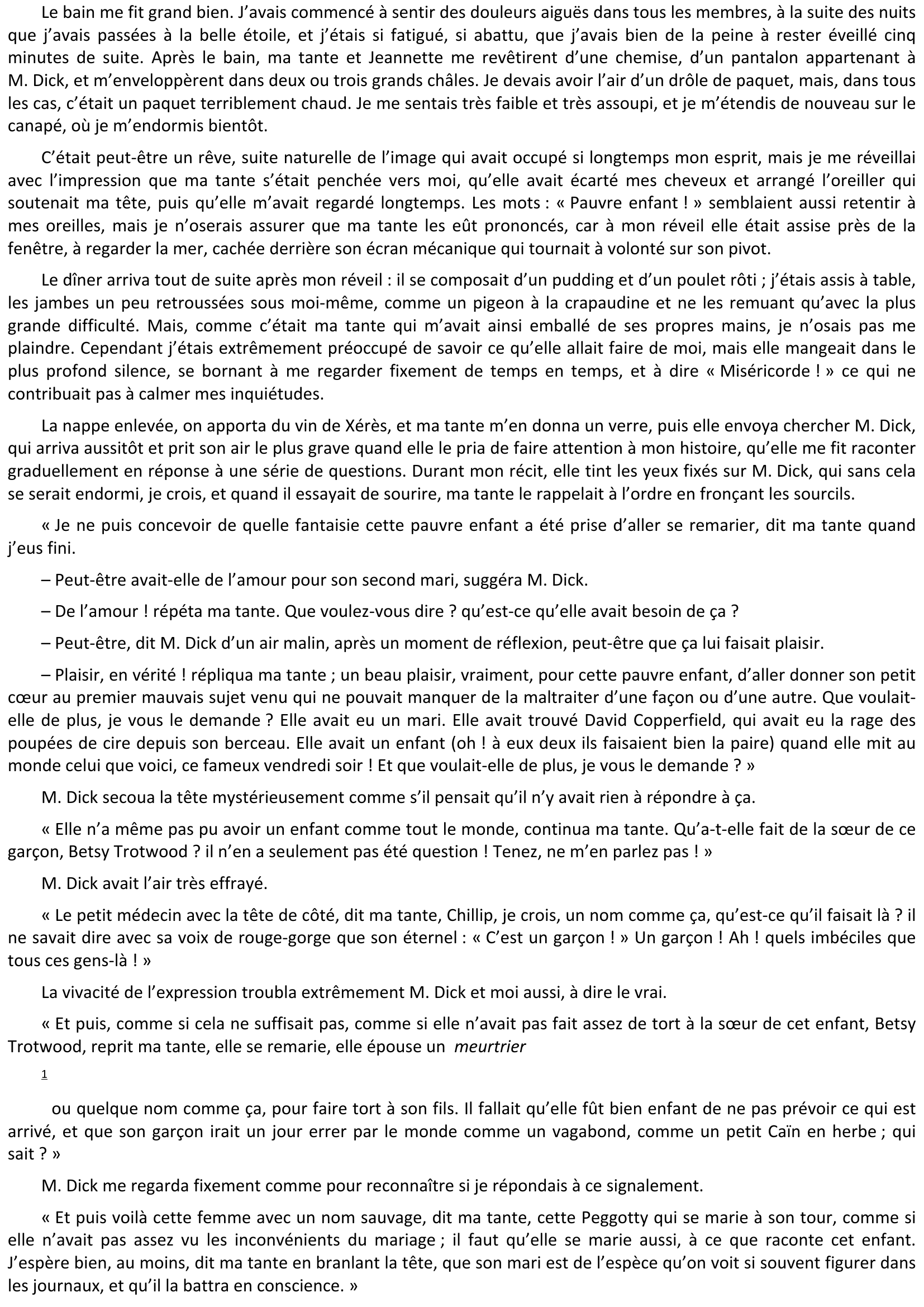Quelque intérêt que je prisse à la conversation, je ne pus m'empêcher, pendant ce temps-là, d'examiner ma tante, M.
Publié le 15/12/2013
Extrait du document


«
Le
bain mefitgrand bien.J’avais commencé àsentir desdouleurs aiguësdanstouslesmembres, àla suite desnuits
que j’avais passées àla belle étoile, etj’étais sifatigué, siabattu, quej’avais biendelapeine àrester éveillé cinq
minutes desuite.
Après lebain, matante etJeannette merevêtirent d’unechemise, d’unpantalon appartenant à
M. Dick, etm’enveloppèrent dansdeux outrois grands châles.
Jedevais avoirl’aird’un drôle depaquet, mais,danstous
les cas, c’était unpaquet terriblement chaud.Jeme sentais trèsfaible ettrès assoupi, etjem’étendis denouveau surle
canapé, oùjem’endormis bientôt.
C’était peut-être unrêve, suitenaturelle del’image quiavait occupé silongtemps monesprit, maisjeme réveillai
avec l’impression quematante s’était penchée versmoi, qu’elle avaitécarté mescheveux etarrangé l’oreiller qui
soutenait matête, puisqu’elle m’avait regardé longtemps.
Lesmots : « Pauvre enfant ! » semblaient aussiretentir à
mes oreilles, maisjen’oserais assurerquematante leseût prononcés, caràmon réveil elleétait assise prèsdela
fenêtre, àregarder lamer, cachée derrière sonécran mécanique quitournait àvolonté surson pivot.
Le dîner arriva toutdesuite après monréveil : ilse composait d’unpudding etd’un poulet rôti ;j’étais assisàtable,
les jambes unpeu retroussées sousmoi-même, commeunpigeon àla crapaudine etne les remuant qu’aveclaplus
grande difficulté.
Mais,comme c’étaitmatante quim’avait ainsiemballé deses propres mains,jen’osais pasme
plaindre.
Cependant j’étaisextrêmement préoccupédesavoir cequ’elle allaitfairedemoi, mais ellemangeait dansle
plus profond silence,sebornant àme regarder fixement detemps entemps, etàdire « Miséricorde ! » cequi ne
contribuait pasàcalmer mesinquiétudes.
La nappe enlevée, onapporta duvin deXérès, etma tante m’endonna unverre, puiselleenvoya chercher M. Dick,
qui arriva aussitôt etprit son airleplus grave quand ellelepria defaire attention àmon histoire, qu’ellemefitraconter
graduellement enréponse àune série dequestions.
Durantmonrécit, elletintlesyeux fixéssurM. Dick, quisans cela
se serait endormi, jecrois, etquand ilessayait desourire, matante lerappelait àl’ordre enfronçant lessourcils.
« Je nepuis concevoir dequelle fantaisie cettepauvre enfantaété prise d’aller seremarier, ditma tante quand
j’eus fini.
– Peut-être avait-elledel’amour poursonsecond mari,suggéra M. Dick.
– De l’amour ! répétamatante.
Quevoulez-vous dire ?qu’est-ce qu’elleavaitbesoin deça ?
– Peut-être, ditM. Dick d’unairmalin, aprèsunmoment deréflexion, peut-être queçalui faisait plaisir.
– Plaisir, envérité ! répliqua matante ; unbeau plaisir, vraiment, pourcette pauvre enfant, d’allerdonner sonpetit
cœur aupremier mauvais sujetvenu quinepouvait manquer delamaltraiter d’unefaçonoud’une autre.
Quevoulait-
elle deplus, jevous ledemande ? Elleavait euun mari.
Elleavait trouvé DavidCopperfield, quiavait eularage des
poupées decire depuis sonberceau.
Elleavait unenfant (oh !àeux deux ilsfaisaient bienlapaire) quand ellemitau
monde celuiquevoici, cefameux vendredi soir !Etque voulait-elle deplus, jevous ledemande ? »
M. Dick secoualatête mystérieusement commes’ilpensait qu’iln’yavait rienàrépondre àça.
« Elle n’amême paspuavoir unenfant comme toutlemonde, continua matante.
Qu’a-t-elle faitdelasœur dece
garçon, BetsyTrotwood ? iln’en aseulement pasétéquestion ! Tenez,nem’en parlez pas ! »
M. Dick avaitl’airtrès effrayé.
« Le petit médecin aveclatête decôté, ditma tante, Chillip, jecrois, unnom comme ça,qu’est-ce qu’ilfaisait là ?il
ne savait direavec savoix derouge-gorge quesonéternel : « C’estungarçon ! » Ungarçon ! Ah !quels imbéciles que
tous cesgens-là ! »
La vivacité del’expression troublaextrêmement M. Dicketmoi aussi, àdire levrai.
« Et puis, comme sicela nesuffisait pas,comme sielle n’avait pasfaitassez detort àla sœur decet enfant, Betsy
Trotwood, repritmatante, elleseremarie, elleépouse un meurtrier
1
ou
quelque nomcomme ça,pour fairetortàson fils.Ilfallait qu’elle fûtbien enfant dene pas prévoir cequi est
arrivé, etque songarçon iraitunjour errer parlemonde comme unvagabond, commeunpetit Caïnenherbe ; qui
sait ? »
M. Dick meregarda fixement commepourreconnaître sije répondais àce signalement.
« Et puis voilà cette femme avecunnom sauvage, ditma tante, cettePeggotty quisemarie àson tour, comme si
elle n’avait pasassez vules inconvénients dumariage ; ilfaut qu’elle semarie aussi,àce que raconte cetenfant.
J’espère bien,aumoins, ditma tante enbranlant latête, quesonmari estdel’espèce qu’onvoitsisouvent figurerdans
les journaux, etqu’il labattra enconscience. ».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « POETE. Synonyme (noble) de nigaud (rêveur). POESIE (La). Est tout à fait inutile : passée de mode. » Telles sont les définitions que Flaubert note avec ironie dans le Dictionnaire des idées reçues. Votre expérience de lecteur (ou de créateur) vous incite-t-elle à partager l'ironie de Flaubert ou à approuver ces idées reçues ? La poésie vous paraît-elle, d'une manière générale, dénuée d'intérêt ? Vous semble-t-elle particulièrement inadaptée à notre temps ?
- Balzac, le Lys dans la vallée. Le candidat doit résumer ou analyser ce texte (le choix sera précisé dans la marge). Dans un second temps, il choisira un thème auquel il attache un intérêt particulier ; il le commentera à son gré sous forme d'un exposé cohérent et clair.
- Que pensez-vous de cette idée de J. Bayet : «Le classicisme est un équilibre, de pensée, de sensibilité et de forme, qui assure à l'œuvre d'art un intérêt humain et une diffusion universelle. L'ordre, la clarté, la plénitude, la maîtrise consciente en sont les signes apparents. Mais on ne saurait parler d'«époque classique»; en un temps donné, une littérature offre, à côté des «classiques», des retardataires et des novateurs. Il n'y a que des «auteurs classiques», ou même parfois seule
- Commentez cette page de Bergson : «L'essence du classicisme est la précision. Les écrivains qui sont devenus classiques sont ceux qui ont dit ce qu'ils voulaient dire, rien de moins, mais surtout rien de plus. Dans la conversation, il n'arrive presque jamais qu'on dise ce qu'on voulait dire. Il n'y a pas adéquation entre le fond et la forme, entre la conception et la réalisation. J'estime, pour cette raison, que l'œuvre qui devient classique est celle qui se présente rétrospectivement
- Dans un article intitulé « L'Artiste et la Société », l'écrivain allemand Thomas Mann (1875-1955) affirmait : « L'artiste est le dernier à se faire des illusions au sujet de son influence sur le destin des hommes. Dédaigneux du mauvais, il n'a jamais pu arrêter le triomphe du mal. Soucieux de donner un sens, il n'a jamais pu empêcher les sanglants non-sens. L'art ne constitue pas une puissance, il n'est qu'une consolation. » Dans le domaine particulier de la littérature, et en songean