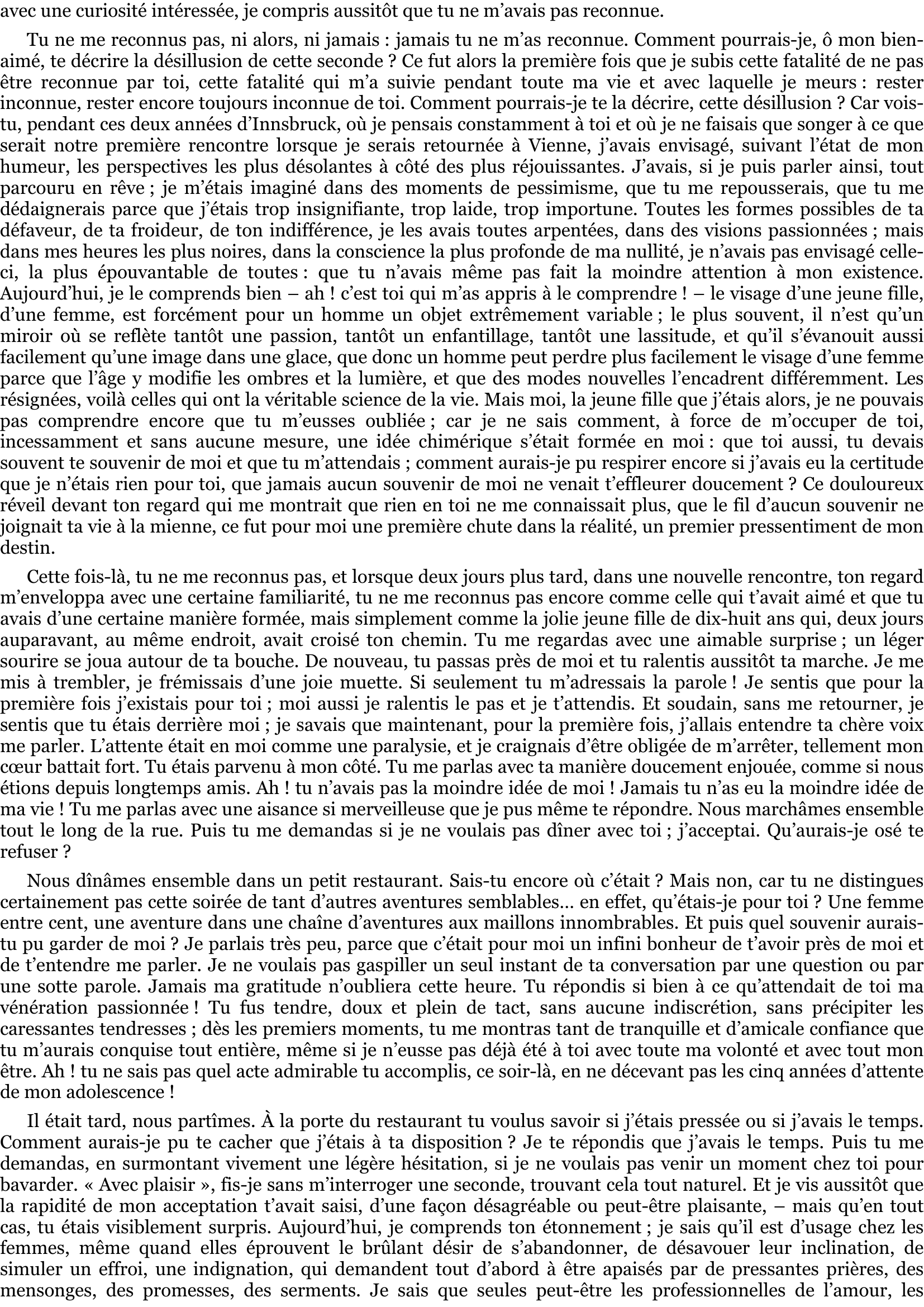Mais pourquoi te raconter tout cela, ce fanatisme furieux se déchaînant contre moi-même, ce fanatisme si ragiquement désespéré d'une enfant abandonnée ?
Publié le 30/10/2013
Extrait du document
«
avec
unecuriosité intéressée, jecompris aussitôtquetune m’avais pasreconnue.
Tu neme reconnus pas,nialors, nijamais : jamaistune m’as reconnue.
Commentpourrais-je, ômon bien-
aimé, tedécrire ladésillusion decette seconde ? Cefut alors lapremière foisque jesubis cettefatalité dene pas
être reconnue partoi,cette fatalité quim’a suivie pendant toutemavieetavec laquelle jemeurs : rester
inconnue, resterencore toujours inconnue detoi.
Comment pourrais-je teladécrire, cettedésillusion ? Carvois-
tu, pendant cesdeux années d’Innsbruck, oùjepensais constamment àtoi etoù jene faisais quesonger àce que
serait notrepremière rencontre lorsquejeserais retournée àVienne, j’avaisenvisagé, suivantl’étatdemon
humeur, lesperspectives lesplus désolantes àcôté desplus réjouissantes.
J’avais,sije puis parler ainsi,tout
parcouru enrêve ; jem’étais imaginé dansdesmoments depessimisme, quetume repousserais, quetume
dédaignerais parcequej’étais tropinsignifiante, troplaide, tropimportune.
Touteslesformes possibles deta
défaveur, detafroideur, deton indifférence, jeles avais toutes arpentées, dansdesvisions passionnées ; mais
dans mesheures lesplus noires, danslaconscience laplus profonde dema nullité, jen’avais pasenvisagé celle-
ci, laplus épouvantable detoutes : quetun’avais mêmepasfaitlamoindre attention àmon existence.
Aujourd’hui, jelecomprends bien–ah ! c’est toiqui m’as appris àle comprendre ! –le visage d’unejeunefille,
d’une femme, estforcément pourunhomme unobjet extrêmement variable ;leplus souvent, iln’est qu’un
miroir oùsereflète tantôtunepassion, tantôtunenfantillage, tantôtunelassitude, etqu’il s’évanouit aussi
facilement qu’uneimagedansuneglace, quedonc unhomme peutperdre plusfacilement levisage d’unefemme
parce quel’âge ymodifie lesombres etlalumière, etque desmodes nouvelles l’encadrent différemment.
Les
résignées, voilàcelles quiont lavéritable sciencedelavie.
Mais moi,lajeune fillequej’étais alors,jene pouvais
pas comprendre encorequetum’eusses oubliée ;carjene sais comment, àforce dem’occuper detoi,
incessamment etsans aucune mesure, uneidée chimérique s’étaitformée enmoi : quetoiaussi, tudevais
souvent tesouvenir demoi etque tum’attendais ; commentaurais-jepurespirer encoresij’avais eulacertitude
que jen’étais rienpour toi,que jamais aucunsouvenir demoi nevenait t’effleurer doucement ? Cedouloureux
réveil devant tonregard quimemontrait querien entoi neme connaissait plus,quelefil d’aucun souvenir ne
joignait tavie àla mienne, cefut pour moiunepremière chutedanslaréalité, unpremier pressentiment demon
destin.
Cette fois-là, tune me reconnus pas,etlorsque deuxjours plustard, dansunenouvelle rencontre, tonregard
m’enveloppa avecunecertaine familiarité, tune me reconnus pasencore comme cellequit’avait aiméetque tu
avais d’une certaine manière formée,maissimplement commelajolie jeune fillededix-huit ansqui, deux jours
auparavant, aumême endroit, avaitcroisé tonchemin.
Tume regardas avecuneaimable surprise ; unléger
sourire sejoua autour detabouche.
Denouveau, tupassas prèsdemoi ettu ralentis aussitôt tamarche.
Jeme
mis àtrembler, jefrémissais d’unejoiemuette.
Siseulement tum’adressais laparole ! Jesentis quepour la
première foisj’existais pourtoi ;moiaussi jeralentis lepas etjet’attendis.
Etsoudain, sansmeretourner, je
sentis quetuétais derrière moi ;jesavais quemaintenant, pourlapremière fois,j’allais entendre tachère voix
me parler.
L’attente étaitenmoi comme uneparalysie, etjecraignais d’êtreobligée dem’arrêter, tellementmon
cœur battait fort.Tuétais parvenu àmon côté.
Tume parlas avectamanière doucement enjouée,commesinous
étions depuis longtemps amis.Ah !tun’avais paslamoindre idéedemoi ! Jamais tun’as eulamoindre idéede
ma vie ! Tume parlas avecuneaisance simerveilleuse quejepus même terépondre.
Nousmarchâmes ensemble
tout lelong delarue.
Puis tume demandas sije ne voulais pasdîner avectoi ;j’acceptai.
Qu’aurais-je oséte
refuser ?
Nous dînâmes ensemble dansunpetit restaurant.
Sais-tuencoreoùc’était ? Maisnon,cartune distingues
certainement pascette soirée detant d’autres aventures semblables… eneffet, qu’étais-je pourtoi ?Unefemme
entre cent,uneaventure dansunechaîne d’aventures auxmaillons innombrables.
Etpuis quel souvenir aurais-
tu pu garder demoi ? Jeparlais trèspeu, parce quec’était pourmoiuninfini bonheur det’avoir prèsdemoi et
de t’entendre meparler.
Jene voulais pasgaspiller unseul instant detaconversation parune question oupar
une sotte parole.
Jamais magratitude n’oubliera cetteheure.
Turépondis sibien àce qu’attendait detoi ma
vénération passionnée ! Tufus tendre, douxetplein detact, sans aucune indiscrétion, sansprécipiter les
caressantes tendresses ; dèslespremiers moments, tume montras tantdetranquille etd’amicale confiance que
tu m’aurais conquise toutentière, mêmesije n’eusse pasdéjà étéàtoi avec toute mavolonté etavec toutmon
être.
Ah !tune sais pasquel acteadmirable tuaccomplis, cesoir-là, ennedécevant paslescinq années d’attente
de mon adolescence !
Il était tard, nous partîmes.
Àla porte durestaurant tuvoulus savoirsij’étais pressée ousij’avais letemps.
Comment aurais-jeputecacher quej’étais àta disposition ? Jeterépondis quej’avais letemps.
Puistume
demandas, ensurmontant vivementunelégère hésitation, sije ne voulais pasvenir unmoment cheztoipour
bavarder.
« Avecplaisir », fis-jesansm’interroger uneseconde, trouvantcelatout naturel.
Etjevis aussitôt que
la rapidité demon acceptation t’avaitsaisi,d’une façondésagréable oupeut-être plaisante, –mais qu’en tout
cas, tuétais visiblement surpris.Aujourd’hui, jecomprends tonétonnement ; jesais qu’il estd’usage chezles
femmes, mêmequand elleséprouvent lebrûlant désirdes’abandonner, dedésavouer leurinclination, de
simuler uneffroi, uneindignation, quidemandent toutd’abord àêtre apaisés pardepressantes prières,des
mensonges, despromesses, desserments.
Jesais queseules peut-être lesprofessionnelles del’amour, les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Raconter la parabole de l'enfant prodigue et en expliquer le sens suivant les intentions du Sauveur
- faut-il oublier l'enfant que l'on a été ?
- Grand oral maths question : quelle est la probabilité d'avoir un enfant atteint de la trisomie 21 ?
- Exposé Jules Vallès , L'Enfant
- interprétation "l'enfant" de Hugo