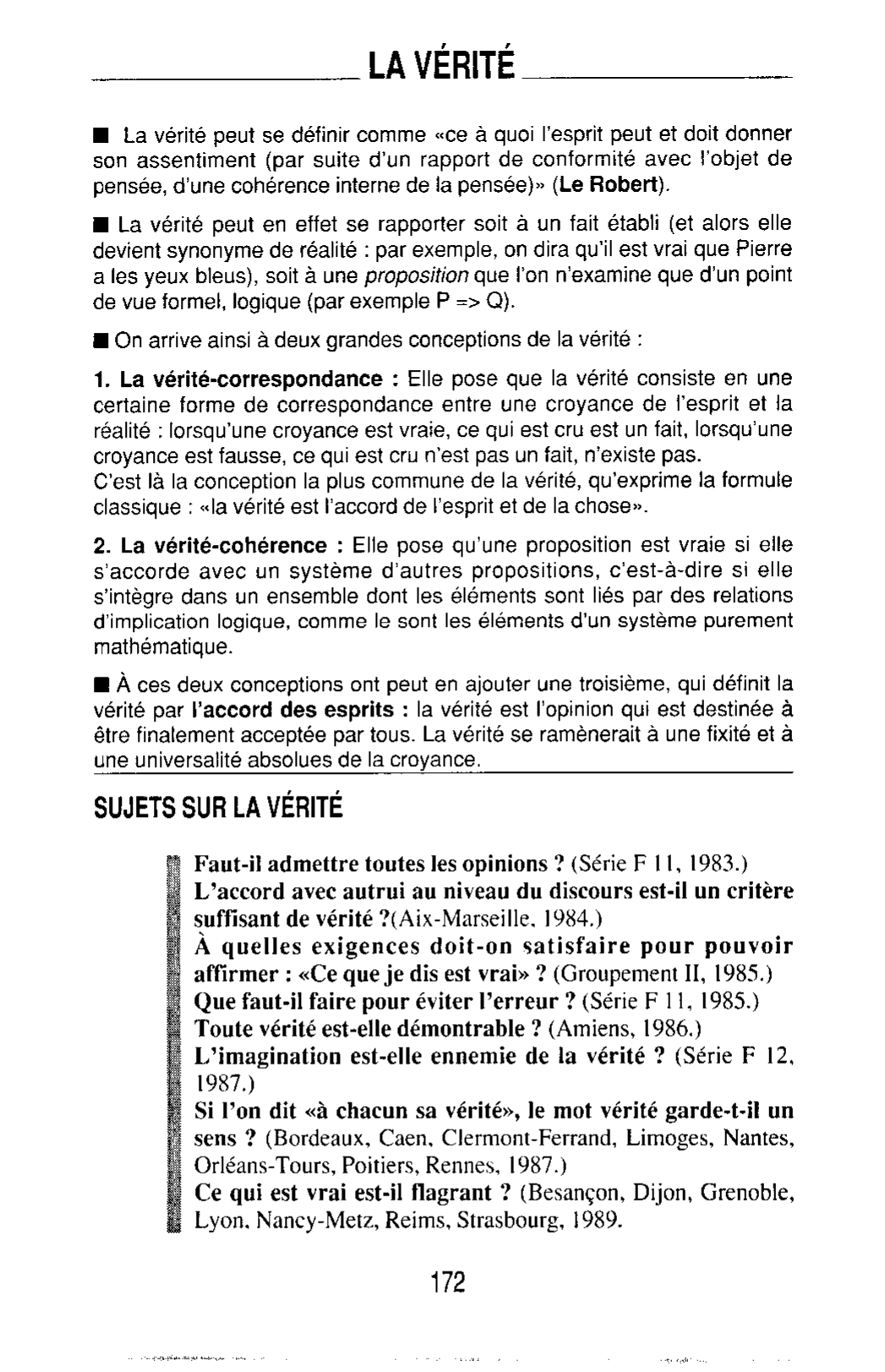LA RAISON
Publié le 24/12/2014
Extrait du document
«
_____ LA VÉRITÉ ____ _
• La vérité peut se définir comme «Ce à quoi l'esprit peut et doit donner
son assentiment (par suite d'un rapport de conformité avec
l'objet de
pensée, d'une cohérence interne
de la pensée)" (Le Robert).
• La vérité peut en effet se rapporter soit à un fait établi (et alors elle
devient synonyme de réalité : par exemple, on dira qu'il est vrai que Pierre
a
les yeux bleus), soit à une proposition que l'on n'examine que d'un point
de vue formel, logique (par exemple P => Q).
• On arrive ainsi à deux grandes conceptions de la vérité :
1.
La vérité-correspondance : Elle pose que la vérité consiste en une
certaine forme de correspondance entre une croyance de
l'esprit et la
réalité
: lorsqu'une croyance est vraie, ce qui est cru est un fait, lorsqu'une
croyance est fausse, ce qui est cru n'est pas un fait, n'existe pas.
C'est
là la conception la plus commune de la vérité, qu'exprime la formule
classique
: «la vérité est l'accord de l'esprit et de la chose".
2.
La vérité-cohérence : Elle pose qu'une proposition est vraie si elle
s'accorde avec un système d'autres propositions, c'est-à-dire si elle
s'intègre dans un ensemble dont les éléments sont liés par des relations
d'implication logique, comme le sont les éléments d'un système purement
mathématique.
•À ces deux conceptions ont peut en ajouter une troisième, qui définit la
vérité par l'accord des esprits : la vérité est l'opinion qui est destinée à
être finalement acceptée par tous.
La vérité se ramènerait à une fixité et à
une universalité absolues de la croyance.
SUJETS SUR LA VÉRITÉ
Faut-il admettre toutes les opinions? (Série F 11, 1983.)
L'accord avec autrui au niveau du discours est-il un critère
suffisant de vérité ?(Aix-Marseille.
1984.)
À quelles exigences doit-on satisfaire pour pouvoir
affirmer: «Ce que je dis est vrai»? (Groupement Il, 1985.)
Que faut-il faire pour éviter l'erreur? (Série F 11, 1985.)
Toute vérité est-elle démontrable? (Amiens, 1986.)
L'imagination est-elle ennemie de la vérité? (Série F 12,
1987.)
Si l'on dit «à chacun sa vérité», le mot vérité garde-t-il un
sens ? (Bordeaux, Caen.
Clermont-Ferrand, Limoges, Nantes,
Orléans-Tours,
Poitiers, Rennes, 1987.)
Ce qui est vrai est-il flagrant ? (Besançon, Dijon, Grenoble,
Lyon.
Nancy-Metz, Reims, Strasbourg,
1989.
172.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre » JEAN-PAUL SARTRE
- Puis-je être certain d'avoir raison ?
- On loue plus que de raison la marchandise dont on veut se défaire
- La tradition est-elle un obstacle à la raison ?
- Comment savoir que l'on a raison ?