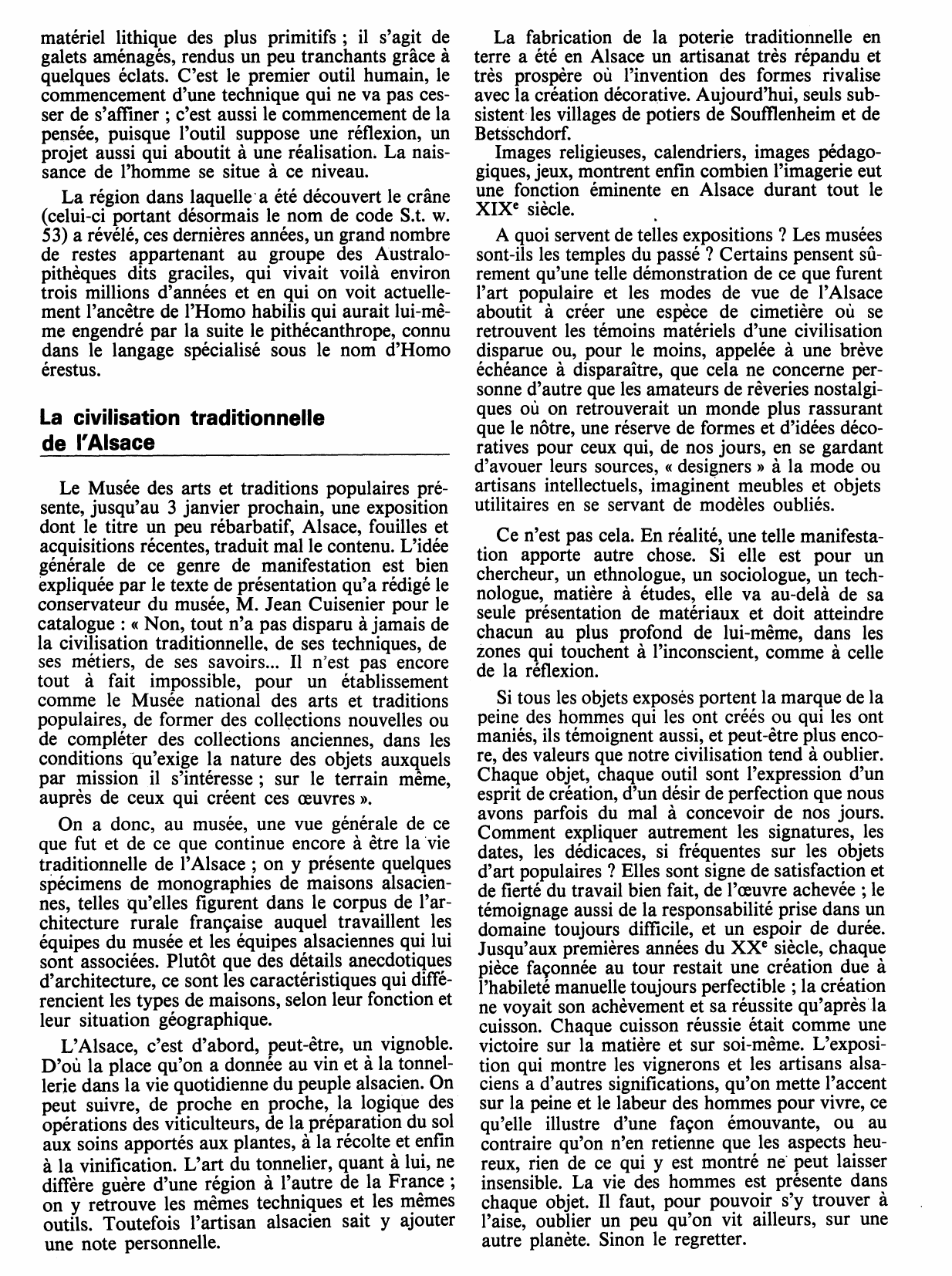La préhistoire à Nice
Publié le 07/12/2011
Extrait du document
On fait commencer la période de la préhistoire avec l’apparition des premiers ancêtres de l’homme, il y a quelque 8 millions d’années (découverte de fragment de squelette au Tchad). Les tout premiers représentants de la lignée humaine sont les Australopithèques, les premiers à être bipèdes, ce qui les différencie des autres grands singes, selon les anthropologues. Ensuite, soit parallèlement, soit en évolution mutante, apparaît la lignée directe de l’homme qu’on nomme Homo (habilis, ergaster erectus, neanderthalensis, sapiens). Le célèbre squelette d’homme moderne qu’on a trouvé dans la grotte de Cro-Magnon (Dordogne, France) est, par facilité, appelé le premier homme (squelette de moins de 35 000 ans).
Pendant une semaine, du 13 au 19 septembre, Nice a été la capitale mondiale de la préhistoire. Trois mille spécialistes venus du monde entier s'y sont rencontrés à l'occasion du IXe congrès des sciences préhistoriques et protohistoriques, qui se tenait au Parc Valrose de l'Université de Nice.
Sans oublier l'intérèt de la fouille, qui apporte naturellement aux chercheurs les documents dont ils ont besoin, les communications ont surtout porté sur les travaux actuellement en cours à l'intérieur des laboratoires, puisque c'est dans les laboratoires que se constitue de plus en plus, à travers un grand nombre de techniques chimiques ou physiques, la connaissance de ce que furent nos plus lointains ancètres....
«
matériel lithique des plus primitifs ; il s'agit de galets aménagés, rendus un peu tranchants grâce à quelques éclats.
C'est le premier outil humain, le commencement d'une technique qui ne va pas ces ser de s'affiner ; c'est aussi le commencement de la
pensée, puisque l'outil suppose une réflexion, un projet aussi qui aboutit à une réalisation.
La nais
sance de l'homme se situe à ce niveau.
La région dans
laquelle· a été découvert le crâne
(celui-ci portant désormais le nom de code S.t.
w.
53) a révélé, ces dernières années, un grand nombre de restes appartenant au groupe des Australo
pithèques dits graciles, qui vivait voilà environ
trois millions d'années et en qui on voit actuelle
ment l'ancètre
de l'Homo habilis qui aurait lui-mè me engendré par la suite le pithécanthrope, connu
dans le langage spécialisé sous le nom d'Homo
érestus.
La civilisation traditionnelle
de l'Alsace
Le Musée des arts et traditions populaires pré
sente, jusqu'au 3 janvier prochain, une exposition
dont
le titre un peu rébarbatif, Alsace, fouilles et
acquisitions récentes, traduit malle contenu.
L'idée
générale de ce genre de manifestation est bien
expliquée par le texte de présentation qu'a rédigé le conservateur du musée, M.
Jean Cuisenier pour le catalogue : « Non, tout n'a pas disparu à jamais de la civilisation traditionnelle, de ses techniques, de ses métiers, de ses savoirs ...
II n'est pas encore
tout à fait impossible, pour un établissement
comme le Musée national des arts et traditions
populaires, de former des coll~ctions nouvelles ou de compléter des collections anciennes, dans les conditions qu'exige la nature des objets auxquels
par mission il s'intéresse ; sur le terrain mème,
auprès de ceux qui créent ces œuvres ».
On a donc, au musée, une vue générale de ce que fut et de ce que continue encore à ètre la vie traditionnelle de l'Alsace ; on y présente quelques
spécimens de monographies de maisons alsacien
nes, telles qu'elles figurent dans le corpus de l'ar
chitecture rurale française auquel travaillent les équipes du musée et les équipes alsaciennes qui lui
sont associées.
Plutôt que des détails anecdotiques
d'architecture, ce sont les caractéristiques qui diffé rencient les types de maisons, selon leur fonction et
leur situation géographique.
L'Alsace, c'est d'abord, peut -ètre, un vignoble.
D'où la place qu'on a donnée au vin et à la tonnel
lerie dans la
vie quotidienne du peuple alsacien.
On peut suivre, de proche en proche, la logique des opérations des viticulteurs, de la préparation du sol aux soins apportés aux plantes, à la récolte et enfin
à la vinification.
L'art du tonnelier, quant à lui,
ne diffère guère d'une région à l'autre de la France ;
on y retrouve l.es mè~es techni9ues e! les ~èmes outils.
Toutefms l'artisan alsacien salt y aJouter
une note personnelle.
La
fabrication
de la poterie traditionnelle en terre a été en Alsace un artisanat très répandu et
très prospère où l'invention des formes rivalise avec la création décorative.
Aujourd'hui, seuls sub
sistent les villages de potiers de Soufflenheim et de Betsschdorf.
Images religieuses, calendriers, images pédago
giques, jeux, montrent enfin combien l'imagerie eut
une fonction éminente en Alsace durant tout le XIX• siècle.
A quoi servent de telles expositions ? Les musées
sont-ils
les temples du passé ? Certains pensent sû rement qu'une telle démonstration de ce que furent
l'art populaire et les modes de vue de l'Alsace
aboutit à créer une espèce de cimetière où se retrouvent les témoins matériels d'une civilisation
disparue ou, pour le moins, appelée à une brève
échéance à disparaître, que cela ne concerne per
sonne d'autre que les amateurs de rèveries nostalgi
ques où on retrouverait un monde plus rassurant
que le nôtre, une réserve de formes et d'idées déco
ratives pour ceux qui, de nos jours, en se gardant
d'avouer leurs sources, « designers » à la mode ou
artisans intellectuels, imaginent meubles et objets
utilitaires
en se servant de modèles oubliés.
Ce n'est pas cela.
En réalité, une telle manifesta
tion apporte autre chose.
Si elle est pour un
chercheur, un ethnologue, un sociologue, un tech
nologue, matière à études, elle va au-delà de sa
seule présentation de matériaux et doit atteindre
chacun au plus profond de lui-mème, dans les zones qui touchent à l'inconscient, comme à celle de la réflexion.
Si tous les objets exposés portent la marque de la
peine des hommes qui les ont créés ou qui les ont
maniés, ils témoignent aussi, et peut-ètre plus enco re, des valeurs que notre civilisation tend à oublier.
Chaque objet, chaque outil sont l'expression d'un
esprit
de création, d'un désir de perfection que nous
avons parfois du mal à concevoir de nos jours.
Comment expliquer autrement les signatures, les dates, les dédicaces, si fréquentes sur les objets
d'art populaires? Elles sont signe de satisfaction et
de fierté du travail bien fait, de l'œuvre achevée ; le témoignage aussi de la responsabilité prise dans un domaine toujours difficile, et un espoir de durée.
Jusqu'aux premières années du xx· siècle, chaque
pièce façonnée au tour restait une création due à
l'habileté manuelle toujours perfectible ; la création
ne voyait son achèvement et sa réussite qu'après la
cuisson.
Chaque cuisson réussie était comme une victoire sur la matière et sur soi-mème.
L'exposi
tion qui montre les vignerons et les artisans alsa
ciens a d'autres significations, qu'on mette l'accent
sur la peine et
le labeur des hommes pour vivre, ce qu'elle illustre d'une façon émouvante, ou au
contraire qu'on n'en retienne que les aspects heu reux, rien de ce qui y est montré ne peut laisser
insensible.
La vie des hommes est présente dans
chaque objet.
II faut, pour pouvoir s'y trouver à
l'aise, oublier un peu qu'on vit ailleurs, sur une
autre planète.
Sinon
le regretter..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les grandes périodes conventionnelles La préhistoire L'Antiquité Le Moyen Age De l'origine de l'homme (de 7 à 5 De 800 avant JC (apparition de la millions d'années) à l'invention de Grèce antique) à 476 après JC l'écriture (3200 av.
- ECOLE MIXTE SAINT JOSEPH 14 RUE BARLA 06300 NICE SUPPA-LEZY MARIE-CARMEN CLASSE CE2 ANNEE 2003/2004 Heures DUREE LUNDI MARDI 8.
- ECOLE MIXTE SAINT JOSEPH 14 RUE BARLA 06300 NICE Heures Durée 8.
- ÉLÉMENTS DE PRÉHISTOIRE. Denis Peyrony (résumé)
- Veil Simone, née en 1927 à Nice (Alpes-Maritimes), personnalité politique française.