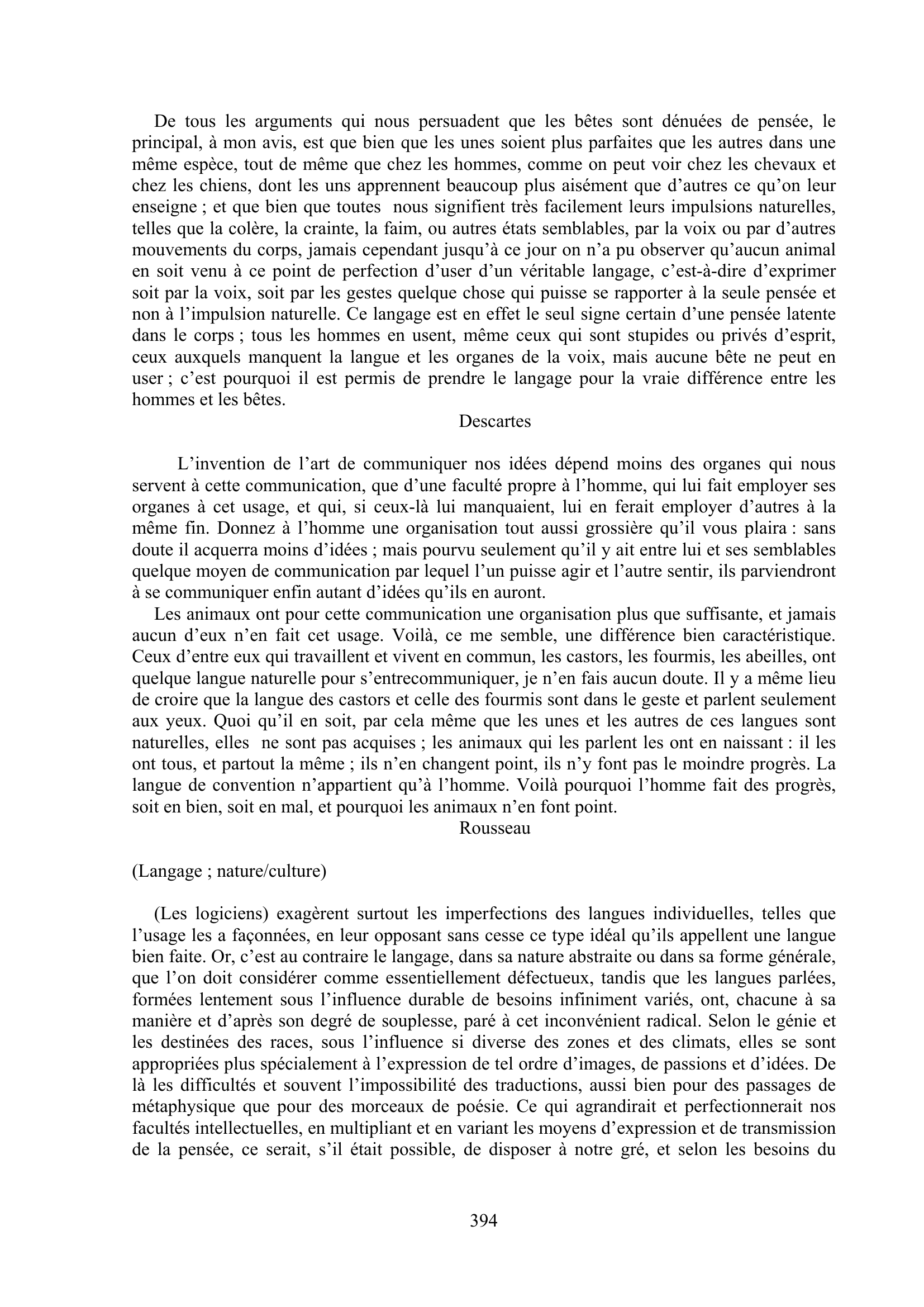La libération de l’homme face à son environnement : la pensée symbolique et la technique
Publié le 10/04/2014
Extrait du document

Faut-il faire confiance au langage ? (Langage ; art ; savoir objectif ; la vérité)
En quoi le langage est-il spécifiquement humain ? (Langage ; nature/culture)
Recourir au langage, est-ce renoncer à la violence ? (Langage ; politique ; violence)
Peut-on légitimement instituer une langue universelle ? (Langage ; art ; savoir objectif ;
culture)
Le langage n’est-il que transmission d’informations ? (Langage ; art ; savoir objectif)
Notre pensée est-elle prisonnière de la langue que nous parlons ? (Langage ; culture ;
savoir objectif)
Les hommes doivent-il travailler pour être humains ? (Travail ; nature/culture ; morale)
Le travail est-il un droit ou une fatalité ?
Le don peut-il être gratuit ou n’est-il qu’une forme de l’échange ? (Echanges ; morale)
L’homme se reconnaît-il mieux dans le travail ou le loisir ?
Faut-il redouter les machines ? (Travail ; technique ; politique ; morale)
La notion d’échange n’a-t-elle de sens qu’économique ? (Echange ; morale ; travail ;
politique)
Le progrès technique est-il la condition du bonheur ? (travail ; technique ; bonheur ;
morale ; politique)
Tout peut-il s’acheter ? (Echange ; travail ; morale ; politique)
Tout ce qui est possible techniquement est-il, pour autant, légitime ? (Technique ;
morale ; politique ; bonheur)
La technique nous éloigne-t-elle de la nature ? (Technique ; travail ; morale ;
nature/culture)
394
De tous les arguments qui nous persuadent que les bêtes sont dénuées de pensée, le
principal, à mon avis, est que bien que les unes soient plus parfaites que les autres dans une
même espèce, tout de même que chez les hommes, comme on peut voir chez les chevaux et
chez les chiens, dont les uns apprennent beaucoup plus aisément que d’autres ce qu’on leur
enseigne ; et que bien que toutes nous signifient très facilement leurs impulsions naturelles,
telles que la colère, la crainte, la faim, ou autres états semblables, par la voix ou par d’autres
mouvements du corps, jamais cependant jusqu’à ce jour on n’a pu observer qu’aucun animal
en soit venu à ce point de perfection d’user d’un véritable langage, c’est-à-dire d’exprimer
soit par la voix, soit par les gestes quelque chose qui puisse se rapporter à la seule pensée et
non à l’impulsion naturelle. Ce langage est en effet le seul signe certain d’une pensée latente
dans le corps ; tous les hommes en usent, même ceux qui sont stupides ou privés d’esprit,
ceux auxquels manquent la langue et les organes de la voix, mais aucune bête ne peut en
user ; c’est pourquoi il est permis de prendre le langage pour la vraie différence entre les
hommes et les bêtes.
Descartes
L’invention de l’art de communiquer nos idées dépend moins des organes qui nous
servent à cette communication, que d’une faculté propre à l’homme, qui lui fait employer ses
organes à cet usage, et qui, si ceux-là lui manquaient, lui en ferait employer d’autres à la
même fin. Donnez à l’homme une organisation tout aussi grossière qu’il vous plaira : sans
doute il acquerra moins d’idées ; mais pourvu seulement qu’il y ait entre lui et ses semblables
quelque moyen de communication par lequel l’un puisse agir et l’autre sentir, ils parviendront
à se communiquer enfin autant d’idées qu’ils en auront.
Les animaux ont pour cette communication une organisation plus que suffisante, et jamais
aucun d’eux n’en fait cet usage. Voilà, ce me semble, une différence bien caractéristique.
Ceux d’entre eux qui travaillent et vivent en commun, les castors, les fourmis, les abeilles, ont
quelque langue naturelle pour s’entrecommuniquer, je n’en fais aucun doute. Il y a même lieu
de croire que la langue des castors et celle des fourmis sont dans le geste et parlent seulement
aux yeux. Quoi qu’il en soit, par cela même que les unes et les autres de ces langues sont
naturelles, elles ne sont pas acquises ; les animaux qui les parlent les ont en naissant : il les
ont tous, et partout la même ; ils n’en changent point, ils n’y font pas le moindre progrès. La
langue de convention n’appartient qu’à l’homme. Voilà pourquoi l’homme fait des progrès,
soit en bien, soit en mal, et pourquoi les animaux n’en font point.
Rousseau
(Langage ; nature/culture)
(Les logiciens) exagèrent surtout les imperfections des langues individuelles, telles que
l’usage les a façonnées, en leur opposant sans cesse ce type idéal qu’ils appellent une langue
bien faite. Or, c’est au contraire le langage, dans sa nature abstraite ou dans sa forme générale,
que l’on doit considérer comme essentiellement défectueux, tandis que les langues parlées,
formées lentement sous l’influence durable de besoins infiniment variés, ont, chacune à sa
manière et d’après son degré de souplesse, paré à cet inconvénient radical. Selon le génie et
les destinées des races, sous l’influence si diverse des zones et des climats, elles se sont
appropriées plus spécialement à l’expression de tel ordre d’images, de passions et d’idées. De
là les difficultés et souvent l’impossibilité des traductions, aussi bien pour des passages de
métaphysique que pour des morceaux de poésie. Ce qui agrandirait et perfectionnerait nos
facultés intellectuelles, en multipliant et en variant les moyens d’expression et de transmission
de la pensée, ce serait, s’il était possible, de disposer à notre gré, et selon les besoins du
395
moment, de toutes les langues parlées, et non de trouver construite cette langue systématique
qui, dans la plupart des cas, serait le plus imparfait des instruments.
Cournot
(Langage ; nature/culture ; le savoir objectif)
Il m’est arrivé maintes fois d’accompagner mon frère ou d’autres médecins chez quelque
malade qui refusait une drogue ou ne voulait pas se laisser opérer par le fer et le feu, et là où
les exhortations du médecin restaient vaines, moi je persuadais le malade, par le seul art de la
rhétorique. Qu’un orateur et un médecin aillent ensemble dans la ville que tu voudras : si une
discussion doit s’engager à l’assemblée du peuple ou dans une réunion quelconque pour
décider lequel des deux sera élu comme médecin, j’affirme que le médecin n’existera pas et
que l’orateur sera préféré si cela lui plaît.
Il en serait de même en face de tout autre artisan : c’est l’orateur qui se ferait choisir plutôt
que n’importe quel compétiteur ; car il n’est point de sujet sur lequel un homme qui sait la
rhétorique ne puisse parler devant la foule d’une manière plus persuasive que l’homme de
métier, quel qu’il soit. Voilà ce qu’est la rhétorique et ce qu’elle peut.
Platon
(Langage ; politique ; savoir objectif)
C’est dans les mots que nous pensons. Nous n’avons conscience de nos pensées, nous
n’avons de pensées déterminées et réelles que lorsque nous leur donnons la forme objective,
que nous les différencions de notre intériorité (…). C’est le son articulé, le mot, qui seul nous
offre une existence où l’externe et l’interne sont intimement unis. Par conséquent, vouloir
penser sans les mots est une tentative insensée. On croit ordinairement, il est vrai, que ce qu’il
y a de plus haut, c’est l’ineffable. Mais c’est là une opinion superficielle et sans fondement ;
car en réalité, l’ineffable, c’est la pensée obscure, la pensée à l’état de fermentation, et qui ne
devient claire que lorsqu’elle trouve le mot. Ainsi le mot donne à la pensée son existence la
plus haute et plus vraie.
Hegel
Nous ne voyons pas les choses mêmes ; nous nous bornons le plus souvent à lire les
étiquettes collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s’est encore accentuée sous
l’influence du langage. Car les mots (à l’exception des noms propres) désignent des genres.
Le mot, qui ne note de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal,
s’insinue entre elle et nous, et en masquerait la forme à nos yeux si cette forme ne dissimulait
déjà derrière les besoins qui ont créé le mot lui-même. Et ce ne sont pas seulement les objets
extérieurs, ce sont aussi nos propres états d’âme qui se dérobent à nous dans ce qu’ils ont
d’intime, de personnel, d’originalement vécu. Quand nous éprouvons de l’amour ou de la
haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui
arrive à notre conscience avec les mille nuances fugitives et les mille résonances profondes
qui en font quelque chose d’absolument nôtre ? Nous serions alors tous poètes, tous
romanciers, tous musiciens.
Bergson
(Langage ; art)
396
L’effet naturel du commerce est de porter la paix. Deux nations qui négocient ensemble se
rendent réciproquement dépendantes : si l’une a intérêt d’acheter, l’autre à intérêt à vendre ; et
toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels.
Mais, si l’esprit de commerce unit les nations, il n’unit pas de même les particuliers. Nous
voyons que dans les pays où l’on n’est affecté que de l’esprit de commerce, on trafique de
toutes les actions humaines, et de toutes les vertus morales : les plus petites choses, celles que
l’humanité demande, s’y font ou s’y donnent pour de l’argent.
L’esprit de commerce produit dans les hommes un certain sentiment de justice exacte,
opposé d’un côté au brigandage, et de l’autre à ces vertus morales qui font qu’on ne discute
pas toujours ses intérêts avec rigidité, et qu’on peut les négliger pour ceux des autres.
Montesquieu
(Echanges ; morale ; politique)
Questions
1 Dégagez les articulations du texte ainsi que son idée principale.
2 Expliquez : « Si l’esprit de commerce unit les nations, il n’unit pas de même les
particuliers «.
3 Peut-on concevoir des échanges gratuits ?
Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l’homme et la nature. L’homme y
joue lui-même vis-à-vis de la nature le rôle d’une puissance naturelle. Les forces dont son
corps est doué, bras et jambes, tête et mains, il les met en mouvement afin de s’assimiler des
matières en leur donnant une forme utile à sa vie. En même temps qu’il agit par ce
mouvement sur la nature extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature, et développe les
facultés qui y sommeillent. Nous ne nous arrêterons pas à cet état primordial du travail où il
n’a pas encore dépouillé son mode purement instinctif. Notre point de départ c’est le travail
sous une forme qui appartient exclusivement à l’homme. Une araignée fait des opérations qui
ressemblent à celles du tisserand, et l’abeille confond par la structure de ses cellules de cire
l’habileté de plus d’un architecte. Mais ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte
de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire
dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l’imagination du
travailleur. Ce n’est pas qu’il opère seulement un changement de forme dans les matières
naturelles ; il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience, qui détermine
comme loi son mode d’action, et auquel il doit subordonner sa volonté.
Marx
(Travail ; nature/culture ; la conscience ; la technique)
En quoi consiste la dépossession du travail ? D’abord, dans le fait que le travail est
extérieur à l’ouvrier, c’est-à-dire qu’il n’appartient pas à son être ; que, dans son travail,
l’ouvrier ne s’affirme pas, mais se nie ; qu’il ne s’y sent pas satisfait, mais malheureux ; qu’il
n’y déploie pas une libre énergie physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine
son esprit. C’est pourquoi l’ouvrier n’a le sentiment d’être à soi qu’en dehors du travail ; dans
le travail, il se sent extérieur à soi-même. Il est lui quand il ne travaille pas et, quand il
travaille, il n’est pas lui. Son travail n’est pas volontaire, mais contraint. Travail forcé, il n’est
pas la satisfaction d’un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors
du travail. La nature aliénée du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu’il n’existe
pas de contrainte physique ou autre, on fuit le travail comme la peste. Le travail aliéné, le
travail dans lequel l’homme se dépossède, est sacrifice de soi, mortification. Enfin, l’ouvrier
ressent la nature extérieure du travail par le fait qu’il n’est pas son bien propre, mais celui
397
d’un autre, qu’il ne lui appartient pas, que dans le travail l’ouvrier ne s’appartient pas à luimême,
mais à un autre (…)
On en vient donc à ce résultat que l’homme (l’ouvrier) n’a de spontanéité que dans ses
fonctions animales : le manger, le boire et la procréation, peut-être encore dans l’habitat, la
parure, etc. ; et que, dans ses fonctions humaines, il ne se sent plus qu’animalité : ce qui est
animal devient humain, et ce qui est humain devient animal.
Marx
(Travail ; morale ; politique ; nature/culture)
Chercher un travail pour le gain, c’est maintenant un souci commun à presque tous les
habitants des pays de civilisation ; le travail leur est un moyen, il a cessé d’être un but en luimême
; aussi sont-ils peu difficiles dans leur choix pourvu qu’ils aient gros bénéfice. Mais il
est des natures plus rares qui aiment mieux périr que travailler sans joie ; des difficiles, des
gens qui ne se contentent pas de peu et qu’un gain abondant ne satisfera pas s’ils ne voient pas
le gain des gains dans le travail même. Les artistes et les contemplatifs de toute espèce font
partie de cette rare catégorie humaine, mais aussi ces oisifs qui passent leur existence à
chasser ou à voyager, à s’occuper de galants commerces ou à courir les aventures. Ils
cherchent tous le travail et la peine dans la mesure où travail et peine peuvent être liés au
plaisir, et, s’il le faut, le plus dur travail, la pire peine. Mais sortis de là, ils sont d’une paresse
décidée, même si cette paresse doit entraîner la ruine, le déshonneur, les dangers de mort ou
de maladie. Ils craignent moins l’ennui qu’un travail sans plaisir…
Nietzsche
Si, en effet, travail et loisir sont l’un et l’autre indispensables, le loisir est cependant
préférable à la vie active et plus réellement une fin, de sorte que nous avons à rechercher à
quel genre d’occupation nous devons nous livrer pendant nos loisirs. Ce n’est sûrement pas au
jeu, car alors le jeu serait nécessairement pour nous la fin de la vie. Or si cela est inadmissible,
et si les amusements doivent plutôt être pratiqués au sein des occupations sérieuses (car
l’homme qui travaille a besoin de délassement, et le jeu est en vue du délassement, alors que
la vie active s’accompagne toujours de fatigue et de tension), pour cette raison nous ne
laisserons les amusements s’introduire qu’en saisissant le moment opportun d’en faire usage,
dans l’idée de les appliquer à titre de remède, car l’agitation que le jeu produit dans l’âme est
une détente et, en raison du plaisir qui l’accompagne, un délassement. Le loisir, en revanche,
semble contenir en lui-même le plaisir, le bonheur et la félicité de vivre.
Aristote
(Travail ; bonheur)
Dans la glorification du « travail «, dans les infatigables discours sur la « bénédiction du
travail «, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges adressées aux actes
impersonnels et utiles à tous : à savoir la peur de tout ce qui est individuel. Au fond, on sent
aujourd’hui, à la vue du travail, - on vise toujours sous ce nom le dur labeur du matin au soir,-
qu’un tel travail constitue la meilleure des polices, qu’il tient chacun en bride et s’entend à
entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l’indépendance.
Car il consume une extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustrait à la réflexion, à la
méditation, à la rêverie, aux soucis, à l’amour et à la haine, il présente constamment à la vue
un but mesquin, et assure des satisfactions faciles et régulières. Ainsi une société où l’on
travaille dur en permanence aura davantage de sécurité : et l’on adore aujourd’hui la sécurité
comme la divinité suprême…
Nietzsche
398
Dans la machine l’homme supprime même cette activité…qui est sienne et fait
complètement travailler cette machine pour lui. Mais cette tricherie, dont l’homme use face à
la nature…se venge contre lui. Ce que l’homme gagne sur la nature en la soumettant toujours
davantage contribue à le rendre d’autant plus faible. En faisant exploiter la nature par toutes
sortes de machines, l’homme ne supprime pas la nécessité de son travail, mais il le repousse
seulement et l’éloigne de la nature, et ainsi l’homme ne se tourne pas d’une manière vivante
vers la nature en tant qu’elle est une nature vivante. Au contraire, le travail perd cette
vitalité…et le travail qui reste encore à l’homme devient lui-même plus mécanique. L’homme
ne diminue le travail que pour le tout, mais non pas pour l’ouvrier singulier pour lequel, au
contraire, il l’accroît plutôt, car plus le travail devient mécanique, moins il a de valeur et plus
l’homme doit travailler de cette façon.
Hegel
Questions
1 Dégagez les articulations du texte ainsi que son idée principale.
2 Expliquez : « l’homme ne supprime pas la nécessité de son travail, mais…il l’éloigne de
la nature «.
3 La mécanisation du travail est-elle une aliénation ?
J’appelle technique ce genre de pensée qui s’exerce sur l’action même, et s’instruit par de
continuels essais et tâtonnements. Comme on voit qu’un homme même ignorant à force
d’user d’un mécanisme, de le toucher et pratiquer de toutes les manières et dans toutes les
conditions, finit par le connaître d’une certaine manière, et tout à fait autrement que celui qui
s’est d’abord instruit par la science ; et la grande différence entre ces deux hommes, c’est que
le technicien ne distingue point l’essentiel de l’accidentel ; tout est égal pour lui, et il n’y a
que le succès qui compte. Ainsi un paysan peut se moquer d’un agronome1 ; non que le
paysan sache ou seulement soupçonne pourquoi l’engrais chimique, ou le nouvel assolement2,
ou un labourage plus profond n’ont point donné ce qu’on attendait ; seulement, par une
longue pratique, il a réglé toutes les actions de culture sur de petites différences qu’il ne
connaît point, mais dont pourtant il tient compte, et que l’agronome ne peut pas même
soupçonner. Quel est donc le propre de cette pensée technicienne ? C’est qu’elle essaie avec
les mains au lieu de chercher par la réflexion.
Alain
1-Agronome : spécialiste des techniques agricoles d’un point de vue scientifique.
2-Assolement : répartition des cultures entre les parcelles d’une terre cultivée.
Questions
1 Dégagez les articulations du texte ainsi que son idée principale.
2 Expliquez : « elle essaie avec les mains au lieu de chercher par la réflexion «
3 La technique n’est-elle nécessairement qu’un savoir-faire ?
Un impératif adapté au nouveau type de l’agir humain et qui s’adresse au nouveau type de
sujets de l’agir s’énoncerait à peu près ainsi : « Agis de façon que les effets de ton action
soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine «…On voit sans
peine que l’atteinte portée à ce type d’impératif n’inclut aucune contradiction d’ordre
rationnel. Je peux vouloir le bien actuel en sacrifiant le bien futur. De même que je peux
vouloir ma propre disparition, je peux aussi vouloir la disparition de l’humanité. Sans me
contredire moi-même, je peux, dans mon cas personnel comme dans celui de l’humanité,
préférer un bref feu d’artifice d’extrême accomplissement de soi-même à l’ennui d’une
continuation indéfinie dans la médiocrité.
Or le nouvel impératif affirme précisément que nous avons bien le droit de risquer notre
propre vie, mais non celle de l’humanité…Nous n’avons pas le droit de choisir le non- être
des générations futures à cause de l’être de la génération actuelle et que nous n’avons même
pas le droit de le risquer. Ce n’est pas du tout facile, et peut-être impossible sans recours à la
religion, de légitimer en théorie pourquoi nous n’avons pas ce droit…
Hans Jonas
(Technique ; morale ; politique ; nature/culture)
Questions
1 Dégagez les articulations du texte ainsi que son idée principale.
2 Expliquez : « Je peux vouloir le bien actuel en sacrifiant le bien futur «.
3 L’usage que nous faisons des techniques peut-il être illégitime ?

«
394 De tous les arguments qui nous persuadent que les bêtes sont dénuées de pensée, le
principal, à mon avis, est que bien que les unes soient plus parfaites que les autres dans une
même espèce, tout de même que chez les hommes, comme on peut voir chez les chevaux et
chez les chiens, dont les uns apprennent beaucoup plus aisément que d’autres ce qu’on leur
enseigne ; et que bien que toutes nous signifient très facilement leurs impulsions naturelles,
telles que la colère, la crainte, la faim, ou autres états semblables, par la voix ou par d’autres
mouvements du corps, jamais cependant jusqu’à ce jour on n’a pu observer qu’aucun animal
en soit venu à ce point de perfection d’user d’un véritable langage, c’est-à-dire d’exprimer
soit par la voix, soit par les gestes quelque chose qui puisse se rapporter à la seule pensée et
non à l’impulsion naturelle.
Ce langage est en effet le seul signe certain d’une pensée latente
dans le corps ; tous les hommes en usent, même ceux qui sont stupides ou privés d’esprit,
ceux auxquels manquent la langue et les organes de la voix, mais aucune bête ne peut en
user ; c’est pourquoi il est permis de prendre le langage pour la vraie différence entre les
hommes et les bêtes.
Descartes
L’invention de l’art de communiquer nos idées dépend moins des organes qui nous
servent à cette communication, que d’une faculté propre à l’homme, qui lui fait employer ses
organes à cet usage, et qui, si ceux-là lui manquaient, lui en ferait employer d’autres à la
même fin.
Donnez à l’homme une organisation tout aussi grossière qu’il vous plaira : sans
doute il acquerra moins d’idées ; mais pourvu seulement qu’il y ait entre lui et ses semblables
quelque moyen de communication par lequel l’un puisse agir et l’autre sentir, ils parviendront
à se communiquer enfin autant d’idées qu’ils en auront.
Les animaux ont pour cette communication une organisation plus que suffisante, et jamais
aucun d’eux n’en fait cet usage.
Voilà, ce me semble, une différence bien caractéristique.
Ceux d’entre eux qui travaillent et vivent en commun, les castors, les fourmis, les abeilles, ont
quelque langue naturelle pour s’entrecommuniquer, je n’en fais aucun doute.
Il y a même lieu
de croire que la langue des castors et celle des fourmis sont dans le geste et parlent seulement
aux yeux.
Quoi qu’il en soit, par cela même que les unes et les autres de ces langues sont
naturelles, elles ne sont pas acquises ; les animaux qui les parlent les ont en naissant : il les
ont tous, et partout la même ; ils n’en changent point, ils n’y font pas le moindre progrès.
La
langue de convention n’appartient qu’à l’homme.
Voilà pourquoi l’homme fait des progrès,
soit en bien, soit en mal, et pourquoi les animaux n’en font point.
Rousseau
(Langage ; nature/culture)
(Les logiciens) exagèrent surtout les imperfections des langues individuelles, telles que
l’usage les a façonnées, en leur opposant sans cesse ce type idéal qu’ils appellent une langue
bien faite.
Or, c’est au contraire le langage, dans sa nature abstraite ou dans sa forme générale,
que l’on doit considérer comme essentiellement défectueux, tandis que les langues parlées,
formées lentement sous l’influence durable de besoins infiniment variés, ont, chacune à sa
manière et d’après son degré de souplesse, paré à cet inconvénient radical.
Selon le génie et
les destinées des races, sous l’influence si diverse des zones et des climats, elles se sont
appropriées plus spécialement à l’expression de tel ordre d’images, de passions et d’idées.
De
là les difficultés et souvent l’impossibilité des traductions, aussi bien pour des passages de
métaphysique que pour des morceaux de poésie.
Ce qui agrandirait et perfectionnerait nos
facultés intellectuelles, en multipliant et en variant les moyens d’expression et de transmission
de la pensée, ce serait, s’il était possible, de disposer à notre gré, et selon les besoins du.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Technique: L'informatique est-elle une chance pour la pensée de l'homme ?
- La libération de l'homme à l'égard de la nature passe-t-elle nécessairement par sa domination technique ?
- «Un long avenir se préparait pour (la culture française) du XVIIe (siècle). Même encore au temps du romantisme, les œuvres classiques continuent à bénéficier d'une audience considérable ; l'époque qui les a vu naître bénéficie au premier chef du progrès des études historiques ; l'esprit qui anime ses écrivains, curiosité pour l'homme, goût d'une beauté harmonieuse et rationnelle, continue à inspirer les créatures. Avec cette esthétique une autre ne pourra véritablement entrer en concur
- L'homme a-t-il démissionné face à la technique ?
- LA TECHNIQUE ET L'HOMME "Quand nous considérons la technique comme quelque chose de neutre, c'est alors que nous lui sommes livrés de la pire façon : car cette conception, qui jouit aujourd'hui d'une faveur toute particulière, nous rend complètement aveugles en face de l'essence de la technique." Heidegger, La Question de la technique, 1953. Commentez cette citation.