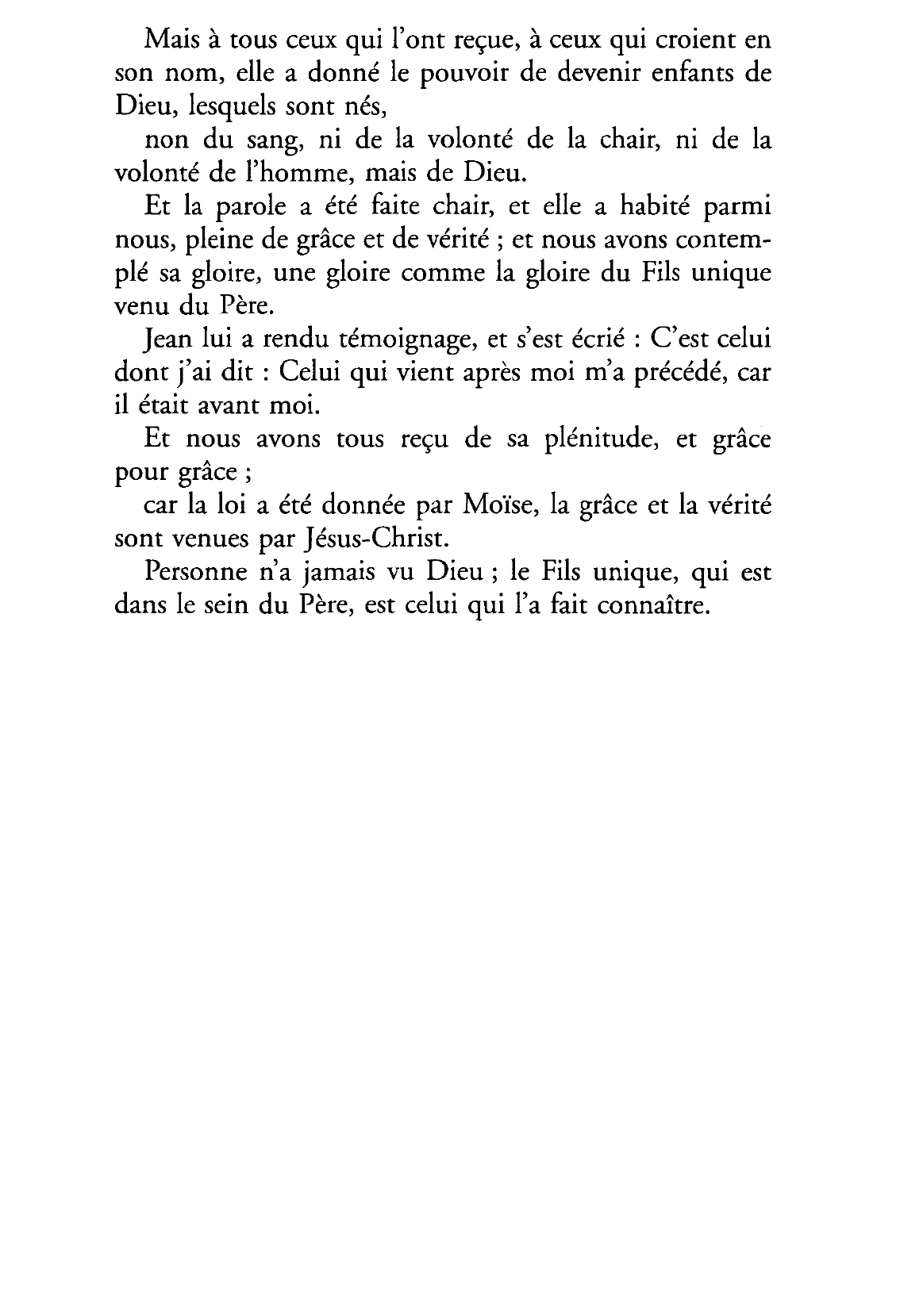EXTRAITS DE THÉOLOGIE CHRETIENNE
Publié le 01/04/2015
Extrait du document
EXTRAITS
1. L'incarnation du logos divin
Jean, I, 1-18, trad. Louis Segond.
Au commencement était la Parole, et la Parole était
avec Dieu, et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui
a été fait n'a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des
hommes.
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne
l'ont point reçue.
Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était
Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage
à la lumière, afin que tous crussent par lui.
Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre
témoignage à la lumière.
Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant
dans le monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par
elle, et le monde ne l'a point connue.
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont
point reçue.
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contem¬plé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit : Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi.
Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ;
car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.
2. Défense des chrétiens
Justin, Apologies, «Première apologie «, I-XI,
trad. abbé Louis Pautigny,
A. Picard et fils, 1904, p. 3-19.
I. À l'empereur Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius, Auguste César, et à Verissimus, son fils, Philosophe, et à Lucius, Philosophe, fils de César par la nature et de Pius par adoption, ami de la science, et au sacré Sénat et à tout le Peuple romain, en faveur des hommes de toute race qui sont injustement haïs et persécutés, moi, l'un d'eux, Justin, fils de Priscos, fils de Baccheios, de Flavia Neapolis, en Syrie de Palestine, j'adresse ce discours et cette requête.
II. La raison veut que ceux qui sont vraiment pieux et sages estiment et aiment exclusivement la vérité et refusent de suivre les opinions des anciens, quand elles sont mauvaises. Car non seulement la saine raison ordonne de ne pas suivre ceux qui font ou enseignent l'injustice, mais l'ami de la vérité doit de toute manière, même au péril de sa vie, même en danger de mort, obser¬ver la justice dans ses paroles et dans ses actions. Vous donc, qui partout vous entendez appeler pieux et sages et gardiens de la justice et amis de la science, on verra si vous l'êtes vraiment. Ce n'est pas pour vous flatter ni pour gagner vos bonnes grâces que nous avons écrit ce discours : nous venons vous demander de nous juger selon l'équité et après mûr examen. N'allez pas, obéissant à des préjugés, au désir de plaire à la superstition, à un mouvement irraisonné, à de perfides rumeurs que le temps a fortifiées, vous condamner vous-mêmes. Car pour nous, nous savons que personne ne peut nous faire de mal, si nous ne sommes convaincus de crime, si nous ne sommes reconnus coupables. Vous pouvez nous tuer ; nous nuire, non.
III. Pour que vous ne croyiez pas que ce sont des paroles en l'air et une bravade, nous demandons qu'on examine les accusations portées contre nous. Si elles sont reconnues fondées, qu'on nous punisse, comme il est juste. Si l'on n'a rien à nous reprocher, est-il équitable, sur des bruits calomnieux, de condamner des innocents, ou plutôt de vous condamner vous-mêmes en vous lais¬sant guider dans la décision des affaires non par la justice, mais par la passion. Une exigence légitime et la seule juste, aux yeux de tout homme sensé, c'est que les sujets puissent prouver l'innocence de leur conduite et de leurs paroles, et que, d'autre part, les gouvernants rendent leurs sentences en s'inspirant de la piété et de la sagesse, et non de la violence et de la tyrannie. Ainsi les gouver-nants et les sujets seront heureux. Car un ancien l'a dit : « Si les princes et les peuples ne sont pas philosophes, il n'y a pas de bonheur pour les États. « À nous d'exposer aux yeux de tous notre vie et nos enseignements, de peur que, pour ne nous être pas fait connaître de vous, nous ne soyons responsables devant notre conscience, des fautes que vous commettriez par ignorance : à vous, comme le demande la raison, de nous entendre et de juger avec impartialité. Si, une fois éclairés, vous n'obser¬vez pas la justice, vous serez désormais sans excuse devant Dieu.
L...1
VIII. Remarquez que c'est dans votre intérêt que nous parlons ainsi : car nous pourrions nier quand nous sommes interrogés. Mais nous ne voulons pas acheter la vie au prix d'un mensonge. Nous désirons la vie éternelle et incorruptible : nous préférons vivre avec Dieu, le père et le créateur de l'univers. Nous avons hâte de confesser notre foi, persuadés que ceux-là pourront obtenir ce bon¬heur, qui auront témoigné à Dieu par leurs oeuvres qu'ils l'ont suivi et qu'ils ont aspiré à cette vie qui s'écoulera auprès de lui, inaccessible au mal. Voilà en peu de mots
notre espérance, la doctrine que nous avons apprise du Christ et que nous enseignons. Platon dit que Rhada-mante et Minos puniront les coupables traduits à leur tribunal : nous disons nous aussi que ce jugement sera rendu, mais par le Christ. Les méchants comparaîtront avec leurs corps et leurs âmes, et leur supplice durera éternellement, et non pas seulement pendant une période de mille ans, comme le prétendait Platon. Cela vous paraîtra peut-être incroyable ou impossible : mais, s'il y a erreur, c'est notre affaire et non celle d'un autre, tant que nous ne serons pas convaincus de crime.
IX. Si nous n'offrons pas de nombreux sacrifices ni de couronnes de fleurs aux idoles que les hommes ont façonnées et dressées dans les temples sous le nom de dieux, c'est que dans cette matière brute et sans vie nous ne reconnaissons pas l'aspect de la divinité. Nous ne croyons pas en effet que Dieu soit semblable à ces images que l'on dit faites en son honneur. Elles portent le nom et sont faites à la ressemblance de ces génies du mal qui apparurent autrefois. Ne savez-vous pas, sans qu'il soit besoin de vous le dire, comment les artistes travaillent la matière, comment ils la polissent, la taillent, la fondent et la battent ? Souvent, grâce à leur art, des vases d'igno-minie, en changeant seulement de forme et de figure, ont reçu le nom de dieux. Aussi, est-ce à nos yeux une absur-dité, que dis-je, un outrage à la divinité, dont la grandeur et la nature sont ineffables, de donner son nom à des oeuvres corruptibles et qui ont besoin d'être entretenues par la main de l'homme. Et vous savez bien que ces artistes eux-mêmes sont des débauchés et qu'ils sont livrés à tous les vices ; il n'est pas besoin de les énumérer ; ils violent les jeunes filles qui les aident dans leurs travaux. Ô aveuglement ! Ce sont des débauchés, à vous en croire, qui créent et façonnent les dieux que vous adorez ! Vous faites de tels hommes les gardiens des temps où ils rési¬dent, et vous ne comprenez pas que c'est une impiété
que de penser ou de dire que des hommes soient les gardiens des dieux !
X. Nous savons que Dieu n'a pas besoin des dons matériels des hommes, puisque nous voyons qu'il donne tout ; mais nous avons appris, nous croyons et nous tenons pour vrai qu'il agrée ceux qui tâchent d'imiter ses perfections, sa sagesse, sa justice, son amour des hommes, enfin tous les attributs de ce Dieu, qu'aucun nom créé ne peut nommer. Nous avons appris qu'à l'origine, ce dieu, étant bon, fit sortir l'univers de la matière informe à cause des hommes. S'ils se montrent par leurs oeuvres dignes de ses desseins, nous savons qu'ils seront admis à vivre et à régner avec lui, devenus incorruptibles et impassibles. Car nous croyons que, de même qu'à l'ori¬gine il les a faits alors qu'ils n'étaient pas, de même, ceux qui l'auront mérité en choisissant les moyens de lui plaire, jouiront de l'immortalité et de sa société. Il ne dépendait pas de nous de commencer d'exister : mais nous attacher à ce qui lui plaît, par le libre choix des facultés rationnelles qu'il nous a données, il nous le per-suade et il nous en donne la foi. Et nous croyons qu'il importe à tous les hommes de ne pas être détournés de ces enseignements, mais au contraire d'y être vivement encouragés. Car, ce que n'ont pas pu faire les lois humaines, le Verbe, étant divin, l'eût fait, si les démons n'eussent répandu contre nous des accusations menson¬gères et impies, appelant à leur aide les passions qui sont en chacun tout à fait mauvaises et de nature variée. Ces accusations ne nous atteignent pas.
XI. Quant à vous, quand vous entendez dire que nous attendons un royaume, vous supposez à la légère qu'il s'agit d'un royaume humain. Mais c'est du royaume de Dieu que nous parlons. Ce qui le prouve, c'est qu'à vos interrogations, nous répondons que nous sommes chré¬tiens, quand nous savons bien que cet aveu nous vaudra la mort. Si nous attendions un royaume humain, nous
nierions, pour sauver notre vie ; nous nous cacherions, pour ne pas être frustrés dans notre espérance. Mais notre espérance n'est pas de ce temps présent : aussi nous ne craignons pas nos bourreaux, et d'ailleurs, de toute façon, ne faut-il pas mourir ?
3. Querelle sur la nature du divin
Justin, ibid., XX-XXI, p. 43-45.
>OC La Sibylle et Hystaspe ont dit que la nature cor¬ruptible serait consumée par le feu. Les philosophes qu'on appelle stoïciens enseignent que Dieu même se résoudra en feu et qu'après ces changements le monde renaîtra. Quant à nous, nous pensons que le Dieu qui a tout créé est supérieur à cette nature changeante. Si donc, sur certains points, nous sommes d'accord avec les plus estimés de vos philosophes et de vos poètes, si, sur d'autres, nous parlons mieux qu'eux et d'une façon plus digne de Dieu, si seuls enfin nous prouvons ce que nous affirmons, pourquoi cette haine injuste et exceptionnelle contre nous ? En affirmant l'ordonnance et la création de toutes choses par Dieu, nous paraîtrons enseigner la doctrine de Platon ; l'embrasement universel, celle des stoïciens. En disant que les âmes des méchants conservent le sentiment après la mort, et subissent la peine de leurs crimes, que celles des justes, exemptes de peines, ont un sort heureux, nous paraîtrons d'accord avec les poètes et les philosophes. En défendant d'adorer l'ouvrage des mains des hommes, nous parlons comme le comique Ménandre et tous ceux qui ont écrit dans le même sens. Ils ont proclamé que le Créateur est plus grand que la créature.
XXI. Quand nous disons que le Verbe, le premier né de Dieu, Jésus-Christ notre maître, a été engendré sans opération charnelle, qu'il a été crucifié, qu'il est mort et qu'après être ressuscité, il est monté au ciel, nous n'admettons rien de plus étrange que l'histoire de ces êtres que vous appelez fils de Zeus. [...] Et combien d'histoires on raconte de tous ces prétendus fils de Zeus, vous le savez et je n'ai pas besoin de vous le dire. D'ailleurs elles n'ont été écrites que pour corrompre et
pervertir la jeunesse ; car chacun pense qu'il est beau d'imiter les dieux. Loin de nous, si nous sommes purs, une telle conception de la divinité. Quoi ! représenter Zeus, le maître et le créateur du monde comme parricide et fils de parricide, livré à l'amour et vaincu par de bas et honteux plaisirs, abusant de Ganymède et de quantité de femmes ! nous montrer des enfants commettant les mêmes crimes ! Comme je l'ai dit, c'est là l'oeuvre des mauvais démons. Pour nous, notre doctrine nous apprend que ceux-là seuls peuvent espérer l'immortalité, qui ressemblent à Dieu par la piété et la sainteté de leur vie. Quant aux méchants qui ne s'amendent pas, nous croyons qu'ils seront châtiés dans le feu éternel.
4. « Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage «
Jean, Première Épître, I-V, trad. Louis Segond.
I. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, —
car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, —
ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annon-çons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en com-munion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.
Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite.
La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous men¬tons, et nous ne pratiquons pas la vérité.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous.
II. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu.
Celui qui dit : Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui.
Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui : par là nous savons que nous sommes en lui.
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même.
Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement ; ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue.
Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà.
Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore dans les ténèbres.
Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui.
Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom.
Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens,
parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père.
Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin.
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui ;
car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plu-sieurs antéchrists : par là nous connaissons que c'est la dernière heure.
Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres.
Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance.
Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité.
Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils.
Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père ; qui-conque confesse le Fils a aussi le Père.
Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père.
Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle.
Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent.
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui.
Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que qui-conque pratique la justice est né de lui.
III. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.
Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.
Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché.
Quiconque demeure en lui ne pèche point ; quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu.
Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste.
Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.
C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère.
Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres,
et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes.
Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait.
Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort.
Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.
Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.
Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?
Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité.
Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos coeurs devant lui ;
car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand que notre coeur, et il connaît toutes choses.
Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu.
Quoi que ce soit que nous demandions, nous le rece¬vons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.
Et c'est ici son commandement : que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné.
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné.
IV. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu ;
et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde.
Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute.
Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas : c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.
Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
Personne n'a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous.
Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit.
Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde.
Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement.
La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour.
Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.
Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur ; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?
Et nous avons de lui ce commandement : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
V. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui.
Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements.
Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commande-ments. Et ses commandements ne sont pas pénibles,
parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?
C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang ; non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang ; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité.
Car il y en a trois qui rendent témoignage :
l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord.
Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoi-gnage de Dieu est plus grand ; car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils.
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puis-qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.
Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils.
Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée.
Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un
péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort ; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier.
Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort.
Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point ; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas.
Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ.
C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles.
5. « Ce que pensent les chrétiens
sur le souverain bien, contre les philosophes
qui ont cru le trouver en eux-mêmes. «
Augustin, La Cité de Dieu, XIX, Iv,
trad. Émile Saisset, Charpentier, t. IV, 1855, p. 12-15.
Si l'on nous demande quel est le sentiment de la Cité de Dieu sur tous ces points, et d'abord touchant la fin des biens et des maux, elle-même répondra que la vie éternelle est le souverain bien et la mort éternelle le sou¬verain mal, et qu'ainsi nous devons tâcher de bien vivre, afin d'acquérir l'une et d'éviter l'autre. Il est écrit : « Le juste vit de la foi. « En effet, en cette vie, nous ne voyons point encore notre bien, de sorte que nous le devons chercher par la foi, n'ayant pas en nous-mêmes le pouvoir de bien vivre, si celui qui nous a donné la foi dans son assistance ne nous aide à croire et à prier. Pour ceux qui ont cru que le souverain bien est en cette vie, qu'ils l'aient placé dans le corps ou dans l'âme, ou dans tous les deux ensemble, ou, pour résumer tous les systèmes, qu'ils l'aient fait consister dans la volupté, ou dans la vertu, ou dans l'une et l'autre ; dans le repos, ou dans la vertu, ou dans l'un et l'autre ; dans la volupté et le repos, ou dans la vertu, ou dans tout cela pris ensemble ; enfin dans les premiers biens de la nature, ou dans la vertu, ou dans ces objets réunis, c'est en tout cas une étrange vanité d'avoir placé leur béatitude ici-bas, et surtout de l'avoir fait dépendre d'eux-mêmes. La Vérité se rit de cet orgueil, quand elle dit par un prophète : « Le Seigneur sait que les pensées des hommes sont vaines «, ou comme parle l'apôtre saint Paul : « Le Seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu'elles sont vaines. «
Quel fleuve d'éloquence suffirait à dérouler toutes les misères de cette vie ? Cicéron l'a essayé comme il a pu
dans la Consolation sur la mort de sa fille ; mais que ce qu'il a pu est peu de chose ! En effet, ces premiers biens de la nature, les peut-on posséder en cette vie qu'ils ne soient sujets à une infinité de révolutions ? Y a-t-il quelque douleur et quelque inquiétude (deux affections diamétralement opposées à la volupté et au repos) aux-quelles le corps du sage ne soit exposé ? Le retranchement ou la débilité des membres est contraire à l'intégrité des parties du corps, la laideur à sa beauté, la maladie à sa santé, la lassitude à ses forces, la langueur ou la pesanteur à son agilité ; et cependant, quel est celui de ces maux dont le sage soit exempt ? L'équilibre du corps et ses mouvements, quand ils sont dans la juste mesure, comptent aussi parmi les premiers biens de la nature. Mais que sera-ce, si quelque indisposition fait trembler les membres ? que sera-ce, si l'épine du dos se courbe, de sorte qu'un homme soit obligé de marcher à quatre pattes comme une bête ? Cela ne détruira-t-il pas l'assiette ferme et droite du corps, la beauté et la mesure de ses mouvements ? Que dirai-je des premiers biens naturels de l'âme, le sens et l'entendement, dont l'un lui est donné pour apercevoir la vérité et l'autre pour la com¬prendre ? Où en sera le premier, si un homme devient sourd et aveugle ; et le second, s'il devient fou ? Combien les frénétiques font-ils d'extravagances qui nous tirent les larmes des yeux, quand nous les considérons sérieuse¬ment ? Parlerai-je de ceux qui sont possédés du démon ? Où leur raison est-elle ensevelie, quand le malin esprit abuse de leur âme et de leur corps à son gré ? Et qui peut s'assurer que cet accident n'arrivera point au sage pendant sa vie ? Il y a plus : combien défectueuse est la connais¬sance de la vérité ici-bas, où, selon les paroles de la sagesse, « ce corps mortel et corruptible appesantit l'âme, et cette demeure de terre et de boue émousse l'esprit qui pense beaucoup «.
6. L'humilité de Dieu
Matthieu, XI, 25-30, trad. Louis Segond.
En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants.
Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
Toutes choses m'ont été données par mon Père, et per-sonne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes.
Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.
7. Fides et ratio
Encyclique de Jean-Paul II, Introduction :
« Connais-toi toi-même «, 1998, © Libreria Editrice
Vaticana, 2012.
La foi et la raison sont comme les deux ailes qui per-mettent à l'esprit humain de s'élever vers la contempla¬tion de la vérité. C'est Dieu qui a mis au coeur de l'homme le désir de connaître la vérité et, au terme, de Le connaître lui-même afin que, Le connaissant et L'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même (cf. Ex 33, 18 ; Ps 27 [26], 8-9 ; 63 [62], 2-3 ; Jn 14, 8 ; 1 Jn 3, 2).
1. En Orient comme en Occident, on peut discerner un parcours qui, au long des siècles, a amené l'humanité à s'approcher progressivement de la vérité et à s'y confronter. C'est un parcours qui s'est déroulé — il ne pouvait en être autrement — dans le champ de la conscience personnelle de soi : plus l'homme connaît la réalité et le monde, plus il se connaît lui-même dans son unicité, tandis que devient toujours plus pressante pour lui la question du sens des choses et de son existence même. Ce qui se présente comme objet de notre connais¬sance fait par là même partie de notre vie. Le conseil « Connais-toi toi-même « était sculpté sur l'architrave du temple de Delphes, pour témoigner d'une vérité fonda¬mentale qui doit être prise comme règle minimum par tout homme désireux de se distinguer, au sein de la créa¬tion, en se qualifiant comme « homme « précisément parce qu'il « se connaît lui-même «.
Un simple regard sur l'histoire ancienne montre d'ailleurs clairement qu'en diverses parties de la terre, marquées par des cultures différentes, naissent en même temps les questions de fond qui caractérisent le parcours de l'existence humaine : Qui suis-je ? D'où viens-je et où
vais-je ? Pourquoi la présence du mal ? Qu'y aura-t-il après cette vie ? Ces interrogations sont présentes dans les écrits sacrés d'Israël, mais elles apparaissent également dans les Védas ainsi que dans l'Avesta ; nous les trouvons dans les écrits de Confucius et de Lao Tseu, comme aussi dans la prédication des Tirthankaras et de Bouddha ; ce sont encore elles que l'on peut reconnaître dans les poèmes d'Homère et dans les tragédies d'Euripide et de Sophocle, de même que dans les traités philosophiques de Platon et d'Aristote. Ces questions ont une source commune : la quête de sens qui depuis toujours est pres¬sante dans le coeur de l'homme, car de la réponse à ces questions dépend l'orientation à donner à l'existence.
2. L'Église n'est pas étrangère à ce parcours de recherche, et elle ne peut l'être. Depuis que, dans le Mys¬tère pascal, elle a reçu le don de la vérité ultime sur la vie de l'homme, elle est partie en pèlerinage sur les routes du monde pour annoncer que Jésus-Christ est « le Chemin, la Vérité et la Vie « On 14, 6). Parmi les divers services qu'elle doit offrir à l'humanité, il y en a un qui engage sa responsabilité d'une manière tout à fait particu¬lière : c'est la diaconie de la vérité. D'une part, cette mission fait participer la communauté des croyants à l'effort commun que l'humanité accomplit pour atteindre la vérité et, d'autre part, elle l'oblige à prendre en charge l'annonce des certitudes acquises, tout en sachant que toute vérité atteinte n'est jamais qu'une étape vers la pleine vérité qui se manifestera dans la révélation ultime de Dieu : « Nous voyons, à présent, dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À pré¬sent, je connais d'une manière partielle ; mais alors je connaîtrai comme je suis connu « (1 Co 13, 12).
3. L'homme possède de multiples ressources pour sti¬muler le progrès dans la connaissance de la vérité, de façon à rendre son existence toujours plus humaine. Parmi elles ressort la philosophie, qui contribue directe
ment à poser la question du sens de la vie et à en ébau¬cher la réponse ; elle apparaît donc comme l'une des tâches les plus nobles de l'humanité. Le mot philosophie, selon l'étymologie grecque, signifie « amour de la sagesse «. En effet, la philosophie est née et s'est dévelop¬pée au moment où l'homme a commencé à s'interroger sur le pourquoi des choses et sur leur fin. Sous des modes et des formes différentes, elle montre que le désir de vérité fait partie de la nature même de l'homme. C'est une propriété innée de sa raison que de s'interroger sur le pourquoi des choses, même si les réponses données peu à peu s'inscrivent dans une perspective qui met en évidence la complémentarité des différentes cultures dans lesquelles vit l'homme.
La forte incidence qu'a eue la philosophie dans la for-mation et dans le développement des cultures en Occi¬dent ne doit pas nous faire oublier l'influence qu'elle a exercée aussi dans les manières de concevoir l'existence dont vit l'Orient. Tout peuple possède en effet sa propre sagesse autochtone et originelle, qui, en tant que richesse culturelle authentique, tend à s'exprimer et à mûrir égale¬ment sous des formes typiquement philosophiques. Que cela soit vrai, on en a pour preuve le fait qu'une forme fondamentale de savoir philosophique, présente jusqu'à nos jours, peut être identifiée jusque dans les postulats dont s'inspirent les diverses législations nationales et internationales pour établir les règles de la vie sociale.
4. Il faut en tout cas observer que derrière un mot unique se cachent des sens différents. Une explicitation préliminaire est donc nécessaire. Poussé par le désir de découvrir la vérité dernière de l'existence, l'homme cherche à acquérir les connaissances universelles qui lui permettent de mieux se comprendre et de progresser dans la réalisation de lui-même. Les connaissances fondamen-tales découlent de l'émerveillement suscité en lui par la contemplation de la création : l'être humain est frappé
d'admiration en découvrant qu'il est inséré dans le monde, en relation avec d'autres êtres semblables à lui dont il partage la destinée. Là commence le parcours qui le conduira ensuite à la découverte d'horizons toujours nouveaux de connaissance. Sans émerveillement, l'homme tomberait dans la répétitivité et, peu à peu, il deviendrait incapable d'une existence vraiment per¬sonnelle.
La capacité spéculative, qui est propre à l'intelligence humaine, conduit à élaborer, par l'activité philosophique, une forme de pensée rigoureuse et à construire ainsi, avec la cohérence logique des affirmations et le caractère orga¬nique du contenu, un savoir systématique. Grâce à ce processus, on a atteint, dans des contextes culturels diffé¬rents et à des époques diverses, des résultats qui ont conduit à l'élaboration de vrais systèmes de pensée. His-toriquement, cela a souvent exposé à la tentation de considérer un seul courant comme la totalité de la pensée philosophique. Il est cependant évident qu'entre en jeu, dans ces cas, une certaine « superbe philosophique « qui prétend ériger sa propre perspective imparfaite en lecture universelle. En réalité, tout système philosophique, même toujours respecté dans son intégralité sans aucune sorte d'instrumentalisation, doit reconnaître la priorité de la pensée philosophique d'où il tire son origine et qu'il doit servir d'une manière cohérente.
En ce sens, il est possible de reconnaître, malgré les changements au cours des temps et les progrès du savoir, un noyau de notions philosophiques dont la présence est constante dans l'histoire de la pensée. Que l'on songe, à seul titre d'exemple, aux principes de non-contradiction, de finalité, de causalité, et de même à la conception de la personne comme sujet libre et intelligent, et à sa capa¬cité de connaître Dieu, la vérité, le bien ; que l'on songe également à certaines normes morales fondamentales qui s'avèrent communément partagées. Ces thèmes et
d'autres encore montrent que, indépendamment des cou-rants de pensée, il existe un ensemble de notions où l'on peut reconnaître une sorte de patrimoine spirituel de l'humanité. C'est comme si nous nous trouvions devant une philosophie implicite qui fait que chacun se sent pos-sesseur de ces principes, fût-ce de façon générale et non réfléchie. Ces notions, précisément parce qu'elles sont partagées dans une certaine mesure par tous, devraient constituer des références pour les diverses écoles philoso-phiques. Quand la raison réussit à saisir et à formuler les principes premiers et universels de l'être et à faire correctement découler d'eux des conclusions cohérentes d'ordre logique et moral, on peut alors parler d'une raison droite ou, comme l'appelaient les anciens, de orthàs logos, recta ratio.
5. L'Eglise, pour sa part, ne peut qu'apprécier les efforts de la raison pour atteindre des objectifs qui rendent l'existence personnelle toujours plus digne. Elle voit en effet dans la philosophie le moyen de connaître des vérités fondamentales concernant l'existence de l'homme. En même temps, elle considère la philosophie comme une aide indispensable pour approfondir l'intelli¬gence de la foi et pour communiquer la vérité de l'Évan¬gile à ceux qui ne la connaissent pas encore.
Faisant donc suite à des initiatives analogues de mes prédécesseurs, je désire moi aussi porter mon regard vers cette activité particulière de la raison. J'y suis incité par le fait que, de nos jours surtout, la recherche de la vérité ultime apparaît souvent occultée. Sans aucun doute, la philosophie moderne a le grand mérite d'avoir concentré son attention sur l'homme. À partir de là, une raison chargée d'interrogations a développé davantage son désir d'avoir une connaissance toujours plus étendue et tou¬jours plus profonde. Ainsi ont été bâtis des systèmes de pensée complexes, qui ont donné des fruits dans les divers ordres du savoir, favorisant le développement de la
culture et de l'histoire. L'anthropologie, la logique, les sciences de la nature, l'histoire, le langage... d'une cer¬taine manière, c'est l'univers entier du savoir qui a été embrassé. Les résultats positifs qui ont été atteints ne doivent toutefois pas amener à négliger le fait que cette même raison, occupée à enquêter d'une façon unilatérale sur l'homme comme sujet, semble avoir oublié que celui-ci est également toujours appelé à se tourner vers une vérité qui le transcende. Sans référence à cette dernière, chacun reste à la merci de l'arbitraire, et sa condition de personne finit par être évaluée selon des critères pragma¬tiques fondés essentiellement sur le donné expérimental, dans la conviction erronée que tout doit être dominé par la technique. Il est ainsi arrivé que, au lieu d'exprimer au mieux la tension vers la vérité, la raison, sous le poids de tant de savoir, s'est repliée sur elle-même, devenant, jour après jour, incapable d'élever son regard vers le haut pour oser atteindre la vérité de l'être. La philosophie moderne, oubliant d'orienter son enquête vers l'être, a concentré sa recherche sur la connaissance humaine. Au lieu de s'appuyer sur la capacité de l'homme de connaître la vérité, elle a préféré souligner ses limites et ses condi¬tionnements.
Il en est résulté diverses formes d'agnosticisme et de relativisme qui ont conduit la recherche philosophique à s'égarer dans les sables mouvants d'un scepticisme géné¬ral. Puis, récemment, ont pris de l'importance certaines doctrines qui tendent à dévaloriser même les vérités que l'homme était certain d'avoir atteintes. La pluralité légi¬time des positions a cédé le pas à un pluralisme indiffé¬rencié, fondé sur l'affirmation que toutes les positions se valent : c'est là un des symptômes les plus répandus de la défiance à l'égard de la vérité que l'on peut observer dans le contexte actuel. Certaines conceptions de la vie qui viennent de l'Orient n'échappent pas, elles non plus, à cette réserve ; selon elles, en effet, on refuse à la vérité
son caractère exclusif, en partant du présupposé qu'elle se manifeste d'une manière égale dans des doctrines diffé¬rentes, voire contradictoires entre elles. Dans cette pers¬pective, tout devient simple opinion. On a l'impression d'être devant un mouvement ondulatoire : tandis que, d'une part, la réflexion philosophique a réussi à s'engager sur la voie qui la rapproche toujours plus de l'existence humaine et de ses diverses expressions, elle tend d'autre part à développer des considérations existentielles, her¬méneutiques ou linguistiques qui passent sous silence la question radicale concernant la vérité de la vie per¬sonnelle, de l'être et de Dieu. En conséquence, on a vu apparaître chez l'homme contemporain, et pas seulement chez quelques philosophes, des attitudes de défiance assez répandues à l'égard des grandes ressources cognitives de l'être humain. Par fausse modestie, on se contente de vérités partielles et provisoires, sans plus chercher à poser des questions radicales sur le sens et sur le fondement ultime de la vie humaine, personnelle et sociale. En somme, on a perdu l'espérance de pouvoir recevoir de la philosophie des réponses définitives à ces questions.
6. Forte de la compétence qui lui vient du fait qu'elle est dépositaire de la Révélation de Jésus-Christ, l'Église entend réaffirmer la nécessité de la réflexion sur la vérité. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'adresser à vous, vénérés Frères dans l'épiscopat avec lesquels je par¬tage la mission de « manifester la vérité « (2 Co 4, 2), ainsi qu'aux théologiens et aux philosophes, auxquels revient le devoir de s'enquérir des différents aspects de la vérité, et aussi aux personnes qui sont en recherche, pour faire part de quelques réflexions sur la voie qui conduit à la vraie sagesse, afin que tous ceux qui ont au coeur l'amour de la sagesse puissent s'engager sur la bonne route qui permet de l'atteindre et trouver en elle la récompense de sa peine et la joie spirituelle.
Ce qui me porte à cette initiative, c'est tout d'abord la conscience de ce qu'exprime le Concile Vatican II, quand il affirme que les évêques sont des « témoins de la vérité divine et catholique «. Témoigner de la vérité est donc une tâche qui nous a été confiée, à nous évêques ; nous ne pouvons y renoncer sans manquer au ministère que nous avons reçu. En réaffirmant la vérité de la foi, nous pouvons redonner à l'homme de notre époque une authentique confiance en ses capacités cognitives et lancer à la philosophie le défi de retrouver et de dévelop¬per sa pleine dignité.
Un autre motif m'incite à écrire ces réflexions. Dans l'encyclique Veritatis splendor, j'ai attiré l'attention sur « quelques vérités fondamentales de la doctrine catho¬lique, qui risquent d'être déformées ou rejetées dans le contexte actuel «. Par la présente encyclique, je voudrais continuer cette réflexion et concentrer l'attention sur le thème même de la vérité et sur son fondement par rapport à la foi. On ne peut nier en effet que cette période de changements rapides et complexes expose surtout les jeunes générations, auxquelles appartient l'avenir et dont il dépend, à éprouver le sentiment d'être privées d'authentiques points de repère. L'exigence d'un fonde¬ment pour y édifier l'existence personnelle et sociale se fait sentir de manière pressante, surtout quand on est contraint de constater le caractère fragmentaire de propo¬sitions qui élèvent l'éphémère au rang de valeur, dans l'illusion qu'il sera possible d'atteindre le vrai sens de l'existence. Il arrive ainsi que beaucoup traînent leur vie presque jusqu'au bord de l'abîme sans savoir vers quoi ils se dirigent. Cela dépend aussi du fait que ceux qui étaient appelés par vocation à exprimer dans des formes cultu¬relles le fruit de leur spéculation ont parfois détourné leur regard de la vérité, préférant le succès immédiat à la peine d'une recherche patiente de ce qui mérite d'être vécu. La philosophie, qui a la grande responsabilité de
former la pensée et la culture par l'appel permanent à la recherche du vrai, doit retrouver vigoureusement sa vocation originelle. C'est pourquoi j'ai ressenti non seule¬ment l'exigence, mais aussi le devoir, d'intervenir sur ce thème, pour que l'humanité, au seuil du troisième millé¬naire de l'ère chrétienne, prenne plus clairement conscience des grandes ressources qui lui ont été accor¬dées et s'engage avec un courage renouvelé dans la réalisa¬tion du plan de salut dans lequel s'inscrit son histoire.
8. La parabole des talents
Matthieu, XXV, 14-30, trad. Louis Segond.
Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens.
Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit.
Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents.
De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres.
Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte.
Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apportant cinq autres talents, et il dit : Seigneur, tu m'as remis cinq talents ; voici, j'en ai gagné cinq autres.
Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.
Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit : Seigneur, tu m'as remis deux talents ; voici, j'en ai gagné deux autres.
Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné ;
j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi.
Son maître lui répondit : Serviteur méchant et pares-seux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné ;
il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents.
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abon-dance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
9. Éloge de la bonne volonté
Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs, I,
trad. Main Renaut, GF-Flammarion, 1994, p. 59-64.
Il n'y a nulle part quoi que ce soit dans le monde, ni même en général hors de celui-ci, qu'il soit possible de penser et qui pourrait sans restriction être tenu pour bon, à l'exception d'une volonté bonne. L'intelligence, la viva¬cité, la faculté de juger, tout comme les autres talents de l'esprit, de quelque façon qu'on les désigne, ou bien le courage, la résolution, la constance dans les desseins, en tant que propriétés du tempérament, sont sans doute, sous bien des rapports, des qualités bonnes et souhaitables ; mais elles peuvent aussi devenir extrêmement mauvaises et dommageables si la volonté qui doit se servir de ces dons de la nature, et dont les dispositions spécifiques s'appellent pour cette raison caractère, n'est pas bonne. Il en va exactement de la même manière avec les dons de la fortune. Le pouvoir, la richesse, la considération, même la santé et le bien-être, le contentement complet de son état (ce qu'on entend par le terme de bonheur), donnent du coeur à celui qui les possède et ainsi, bien souvent, engendrent aussi de l'outrecuidance, quand il n'y a pas une volonté bonne qui redresse l'influence exercée sur l'âme par ces bienfaits, ainsi que, de ce fait, tout le prin¬cipe de l'action, pour orienter vers des fins universelles ; sans compter qu'un spectateur raisonnable en même temps qu'impartial ne peut même jamais éprouver du plaisir à voir la réussite ininterrompue d'un être que ne distingue aucun trait indicatif d'une volonté pure et bonne, et qu'ainsi la volonté bonne apparaît constituer la condition indispensable même de ce qui nous rend dignes d'être heureux.
Bien plus : il existe certaines qualités qui sont favo¬rables à cette volonté bonne elle-même et qui peuvent
fortement faciliter son oeuvre, mais qui, néanmoins, ne possèdent intrinsèquement aucune valeur absolue et pré¬supposent au contraire toujours encore une volonté bonne, ce qui limite la haute estime qu'on leur porte par ailleurs à juste titre et ne permet pas de les tenir pour absolument bonnes. La modération dans les affects et les passions, la maîtrise de soi, la sobriété de réflexion ne sont pas seulement bonnes à bien des égards, mais elles semblent même constituer une dimension de la valeur intrinsèque de la personne ; reste qu'il s'en faut de beau¬coup qu'on puisse les déclarer bonnes sans restriction (quand bien même elles ont été valorisées de manière inconditionnée par les Anciens). Car, sans les principes d'une volonté bonne, elles peuvent devenir extrêmement mauvaises, et le sang-froid d'un vaurien le rend, non seu¬lement bien plus dangereux, mais aussi immédiatement, à nos yeux, plus abominable encore que nous ne l'eus¬sions estimé sans cela.
Ce n'est pas ce que la volonté bonne effectue ou accomplit qui la rend bonne, ni son aptitude à atteindre quelque but qu'elle s'est proposé, mais c'est uniquement le vouloir ; autrement dit, c'est en soi qu'elle est bonne et, considérée pour elle-même, elle doit être estimée sans comparaison comme de loin supérieure à tout ce qui pourrait être mené à bien par elle en faveur d'une quel¬conque inclination, ou même, si l'on veut, en faveur de toutes les inclinations. Quand bien même, par une défa¬veur particulière du destin ou par l'avare dotation d'une nature marâtre, la capacité de réaliser ce qu'elle vise ferait totalement défaut à cette volonté ; quand bien même, en dépit de l'extrême application qu'elle y met, elle n'abouti¬rait à rien et il ne resterait que la volonté bonne (certes, non comme un simple voeu pieux, mais comme la mobi-lisation de tous les moyens qui sont en notre pouvoir), néanmoins brillerait-elle par elle-même comme un joyau, comme quelque chose qui a en soi-même sa pleine valeur.
L'utilité ou la stérilité ne peut rien ajouter, ni rien retirer à cette valeur. Cette utilité constituerait simplement, en quelque sorte, l'enchâssure nécessaire pour pouvoir mieux manipuler le joyau dans son utilisation quoti¬dienne, ou pour pouvoir attirer sur lui l'attention de ceux qui ne sont pas encore assez connaisseurs, mais non point pour le recommander à ceux qui s'y connaissent et pour déterminer sa valeur.
Il y a pourtant dans cette idée de la valeur absolue du simple vouloir, consistant à en fixer le prix sans prendre en compte dans son évaluation aucune utilité, quelque chose de si étrange qu'en dépit même de la concordance totale qui règne ici entre la raison commune et une telle idée, un soupçon doit inévitablement se faire jour : peut-être n'y aurait-il là, au fond, qu'une vaste chimère et peut-être ne s'agirait-il que d'une mauvaise compréhen¬sion de ce qu'était le dessein de la nature quand elle a installé la raison au gouvernement de notre volonté. Ce pourquoi nous entendons, en nous plaçant de ce point de vue, mettre cette idée à l'épreuve.
Dans les dispositions naturelles d'un être organisé, c'est-à-dire dont la constitution est finalisée en vue de la vie, nous posons comme principe qu'il ne se rencontre nul organe à destination d'une fin quelconque qui ne soit en outre le plus adapté et le plus approprié à cette fin. Dès lors, si, dans un être qui a une raison et une volonté, sa conservation, son bien-être et, en un mot, son bonheur correspondaient au but véritable de la nature, celle-ci aurait à cet égard fort mal arrangé les choses en choisis¬sant la raison de la créature pour réaliser son intention. Car toutes les actions que cette créature doit mener à bien conformément à cette intention, de même que toute la règle de son comportement, lui auraient été prescrites avec beaucoup plus de précision par un instinct, et cette fin aurait pu être atteinte ainsi de manière bien plus sûre que cela ne peut jamais arriver par la raison — et si cette
dernière devait par surcroît lui échoir comme une faveur, elle n'aurait dû lui servir que pour développer des consi¬dérations sur les heureuses dispositions de sa nature, pour les admirer, pour s'en réjouir et exprimer sa gratitude à l'égard de la Cause bienfaisante, mais nullement pour soumettre sa faculté de désirer à cette direction faible et trompeuse et pour intervenir dans le dessein de la nature : en un mot, la nature aurait pris garde que la raison n'allât dévier dans un usage pratique et n'eût l'audace de concevoir pour elle-même, avec les faibles clartés qui sont les siennes, le plan du bonheur et des moyens d'y arriver ; elle se serait chargée elle-même du choix, non seulement des fins, mais aussi des moyens, et elle aurait eu la sage prévoyance de les confier globale¬ment, de manière exclusive, à l'instinct.
En fait, nous observons même que plus une raison cultivée se consacre au projet de jouir de la vie et du bonheur, plus l'être humain s'écarte du vrai contente-ment. Ce pourquoi chez beaucoup, et à vrai dire chez ceux qui ont tenté de mener le plus loin l'usage de la raison, survient, dès lors qu'ils sont assez sincères pour le reconnaître, un certain degré de misologie, c'est-à-dire de haine de la raison, dans la mesure où, après évaluation de tous les avantages qu'ils retirent, je ne dirai pas de la découverte de tous les arts constitutifs du luxe ordinaire, mais même des sciences (qui, en définitive, leur appa¬raissent aussi comme un luxe de l'entendement), ils trouvent pourtant qu'en réalité ils se sont simplement attiré plus de peine qu'ils n'ont obtenu de bonheur ; et dans ces conditions ils finissent par plutôt envier que mépriser l'espèce plus commune des hommes qui se laissent conduire de plus près par le simple instinct natu¬rel et qui n'accordent pas une bien grande influence à leur raison sur leurs faits et gestes. Et dans cette mesure il faut reconnaître que le jugement de ceux qui modèrent fortement et même réduisent à néant les exaltations glori
ficatrices des avantages que la raison devrait nous procu¬rer du point de vue du bonheur et du contentement de la vie n'est nullement le produit d'une humeur morose, ou ne témoigne en rien d'un manque de reconnaissance envers la bonté du gouvernement du monde : bien au contraire, à la racine de ces jugements se trouve secrète¬ment l'idée selon laquelle la fin de leur existence est tout autre et d'une dignité beaucoup plus élevée, que c'est à cette fin, et non pas au bonheur, que la raison est tout spécialement destinée, et que c'est par conséquent à une telle fin que le dessein privé de l'homme se doit, dans la plupart des cas, subordonner comme à sa condition suprême.
Étant donné, en effet, que la raison n'est pas suffi¬samment capable de gouverner avec sûreté la volonté en ce qui concerne ses objets et la satisfaction de tous nos besoins (que, pour une part, elle-même multiplie), alors qu'un instinct naturel inné l'aurait conduite de manière beaucoup plus certaine vers la réalisation d'une telle fin, mais que c'est la raison qui nous a cependant été donnée en partage comme faculté pratique, c'est-à-dire comme faculté qui doit influencer la volonté : il faut que la vraie destination de cette raison soit de produire une volonté qui soit bonne non pas comme moyen en vue de quelque autre fin, mais bonne en soi-même, ce pourquoi une raison était absolument nécessaire dès lors que pour le reste, partout, la nature a accompli son oeuvre, dans la réparti¬tion de ses dispositions, conformément à des fins. Cette volonté ne peut donc assurément être l'unique bien et constituer le bien tout entier, mais elle doit pourtant cor¬respondre au bien suprême et être la condition à laquelle est suspendu tout le reste du bien, y compris toute aspira¬tion au bonheur — auquel cas on peut sans la moindre peine concilier avec la sagesse de la nature la manière dont on constate que la culture de la raison, requise pour la fin qui est première et inconditionnée, limite à beau
coup d'égards, du moins dans cette vie, la réalisation de la seconde fin, qui est toujours conditionnée, à savoir l'atteinte du bonheur, et peut même la réduire à néant : pour autant, la nature ne procède pas ici à l'encontre de toute finalité ; car la raison, qui reconnaît dans la fonda¬tion d'une volonté bonne sa destination pratique suprême, ne saurait accéder, à travers la réalisation de cette fin, qu'à une satisfaction conforme à sa propre nature, c'est-à-dire une satisfaction procédant de l'accom¬plissement d'une fin qui, elle aussi, ne se trouve détermi¬née que par la raison, quand bien même cela devrait être associé à quelque préjudice porté aux fins relevant de l'inclination.
Lobjectif est donc de développer le concept d'une volonté hautement estimable en elle-même, et qui soit bonne sans considération d'aucune autre fin — un concept déjà inscrit dans l'intelligence naturelle saine, requérant moins d'être inculqué que simplement éclairci, et qui, tenant toujours la place la plus haute dans l'appré¬ciation de la valeur complète de nos actions, constitue la condition de tout le reste. À cette fin, nous entendons prendre en vue le concept du devoir, qui contient celui d'une volonté bonne, cependant avec certaines restric¬tions et entraves subjectives, lesquelles pourtant, bien loin de ne pouvoir que le dissimuler et le rendre mécon¬naissable, le font plutôt ressortir par contraste et transpa¬raître d'autant plus clairement.
10. Jésus et la femme adultère
Jean, VIII, 1-11, trad. Louis Segond.
Jésus se rendit à la montagne des oliviers.
Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait.
Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère ;
et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère.
Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes : toi donc, que dis-tu ?
Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accu-ser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre.
Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.
Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre.
Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu.
Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamnée ?
Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus : va, et ne pèche plus.
11. La promesse du salut
Justin, « Dialogue de saint Justin avec le juif
Tryphon «, CXXXVIII, trad. par M. de Genoude,
in Les Pères de l'Église, Sapia, t. II, 1838, p. 179-180.
Vous savez, mes amis, que Dieu parle en ces termes à Jérusalem, par la bouche d'Isaïe : « C'est moi qui t'ai sauvé du déluge de Noé. « Que signifient ces paroles, sinon que dans le déluge se trouvait une figure du salut des hommes. Le juste Noé et sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses trois enfants et leurs épouses, formaient une réunion de huit personnes, qui étaient le symbole de ce huitième jour où s'accomplit la résurrection du Christ ; c'était le huitième par le nombre, mais le premier par la grandeur du prodige qui le signala. Le Christ, premier-né de la création, était aussi le premier auteur ou le prin¬cipe de cette race nouvelle qu'il a régénérée par l'eau du baptême, par le mérite de la foi et par la vertu du bois, c'est-à-dire par le mystère de la croix ; comme Noé, porté sur l'eau, fut sauvé par le bois avec les siens.
Ces paroles du prophète : « Je t'ai sauvé au temps de Noé «, désignent le peuple fidèle à Dieu comme le fut Noé, et sauvé par le même signe ; car c'est avec le bois, c'est-à-dire avec la baguette qu'il tenait à la main, que Moïse fit passer la mer à votre peuple. Vous croyez que ces paroles s'entendent seulement de la terre ou de votre nation. Mais puisque la terre, comme le dit l'Écriture, fut inondée et que l'eau s'éleva de quinze coudées au-dessus des plus hautes montagnes, il est évident que Dieu ne s'adressait pas à la terre, mais au peuple qui lui fut fidèle, et auquel il avait préparé un lieu de repos dans Jérusalem, comme l'attestent les signes qui parlaient aux yeux à l'époque du déluge ; je veux dire que ceux dont le coeur est bien préparé par l'eau, la foi, le bois, et qui font pénitence, échapperont au jugement à venir.
12. Le non-attachement
Pascal, Pensées, 471-396, GF-Flammarion, 1976,
p. 182-183.
Il est injuste qu'on s'attache, quoiqu'on le fasse avec plaisir et volontairement. Je tromperais ceux à qui je ferais naître ce désir, car je ne suis la fin de personne et n'ai de quoi les satisfaire. Ne suis-je pas prêt à mourir ? Et ainsi l'objet de leur attachement mourra. Donc comme je serais coupable de faire croire une fausseté, quoique je la persuadasse doucement, qu'on la crût avec plaisir, et qu'en cela on me fit plaisir, de même, je suis coupable si je me fais aimer, et si j'attire les gens à s'attacher à moi. Je dois avertir ceux qui seraient prêts à consentir au men¬songe, qu'ils ne le doivent pas croire, quelque avantage qui m'en revienne ; et, de même, qu'ils ne doivent pas s'attacher à moi ; car il faut qu'ils passent leur vie et leurs soins à plaire à Dieu ou à le chercher.
13. La résurrection de Lazare
Jean, XI, 1-57, trad. Louis Segond.
Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, vil-lage de Marie et de Marthe, sa soeur.
C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade.
Les soeurs envoyèrent dire à Jésus : Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.
Après avoir entendu cela, Jésus dit : Cette maladie n'est point à la mort ; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.
Or, Jésus aimait Marthe, et sa soeur, et Lazare.
Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était,
et il dit ensuite aux disciples : Retournons en Judée.
Les disciples lui dirent : Rabbi, les Juifs tout récem¬ment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée !
Jésus répondit : N'y a-t-il pas douze heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde ;
mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui.
Après ces paroles, il leur dit : Lazare, notre ami, dort ; mais je vais le réveiller.
Les disciples lui dirent : Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il par¬lait de l'assoupissement du sommeil.
Alors Jésus leur dit ouvertement : Lazare est mort.
Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui.
Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres dis-ciples : Allons aussi, afin de mourir avec lui.
Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre.
Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ,
beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leur frère.
Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.
Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera.
Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.
Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ;
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?
Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.
Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrète-ment Marie, sa soeur, et lui dit : Le maître est ici, et il te demande.
Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui.
Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré.
Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant : Elle va au sépulcre, pour y pleurer.
Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému.
Et il dit : Où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois.
Jésus pleura.
Sur quoi les Juifs dirent : Voyez comme il l'aimait.
Et quelques-uns d'entre eux dirent : Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?
Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant.
Jésus dit : Ôtez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là.
Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?
Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé.
Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours ; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.
Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare, sors !
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller.
Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.
Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pha-risiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait.
Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent : Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles.
Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation.
L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : Vous n'y entendez rien ;
vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas.
Or, il ne dit pas cela de lui-même ; mais étant souve¬rain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.
Et ce n'était pas pour la nation seulement ; c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés.
Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir.
C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs ; mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm ; et là il demeurait avec ses disciples.
La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier.
Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple : Que vous en semble ? Ne viendra-t-il pas à la fête ?
Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on se saisît de lui.
14. Le serpent de la Genèse,
figure diabolique du doute
Genèse, III, 1-24, trad. Louis Segond.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?
La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ;
mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea.
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui par-courait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit : Où es-tu ?
Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché.
Et l'Éternel Dieu dit : Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?
L'homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé.
Et l'Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé.
L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les ani-maux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta pos¬térité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se por¬teront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n'en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.
Adam donna à sa femme le nom d'Ève : car elle a été la mère de tous les vivants.
L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit.
L'Éternel Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal.
Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris.
C'est ainsi qu'il chassa Adam ; et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flam-boyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie.
BIBLIOGRAPHIE
Des centaines de milliers de livres ont été écrits sur le Christ et sur son message de sorte qu'une bibliographie n'a ici guère de sens. Pour ceux qui voudraient approfon¬dir la problématique que j'ai esquissée touchant la séduc¬tion qu'exerça la pensée chrétienne au détriment des sagesses laïques, je renvoie au livre que nous avons écrit, Lucien Jerphagnon et moi, La Tentation du christianisme (Grasset, 2009).
D'une manière générale, pour situer la pensée chré¬tienne dans l'histoire de la philosophie, je renvoie aux nombreux ouvrages d'Étienne Gilson, par exemple à son admirable Philosophie au Moyen Âge (Payot, 1930) : fina¬lement, ce sont eux qui m'ont le plus appris sur l'impact de la pensée chrétienne dans l'histoire de la philosophie. Je conseille aussi, parmi tant d'autres, mais il a le mérite d'aller à l'essentiel de façon à la fois savante et simple, le très intéressant livre de Daniel Marguerat, Qui a fondé le christianisme ? (avec Éric Junod, Labor et Fides, 2010), qui repose de façon éclairée la question des rapports entre Jésus et son Église.
«
42 1 JÉSUS ET LA RÉVOLUTION JUDÉO-CHRÉTIENNE
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en
son nom, elle a donné
le pouvoir de devenir enfants de
Dieu, lesquels sont nés,
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la
volonté de l'homme, mais de Dieu.
Et
la parole a été faite chair, et elle a habité parmi
nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contem
plé
sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique
venu
du Père.
Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié : C'est celui
dont j'ai dit : Celui qui vient après moi m'a précédé, car
il était avant moi.
Et nous avons tous reçu de
sa plénitude, et grâce
pour grâce;
car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et
la vérité
sont venues par Jésus-Christ.
Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est
dans
le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'Église et la politique dans la théologie médiévale (philo)
- Question de corpus : Vous montrerez comment la description de la nature intervient dans les trois extraits.
- THÉOLOGIE PLATONICIENNE, Marsile Ficin (résumé)
- THÉOLOGIE MYSTIQUE (La) (résumé et analyse)
- THÉOLOGIE PLATONICIENNE Marsile Ficin