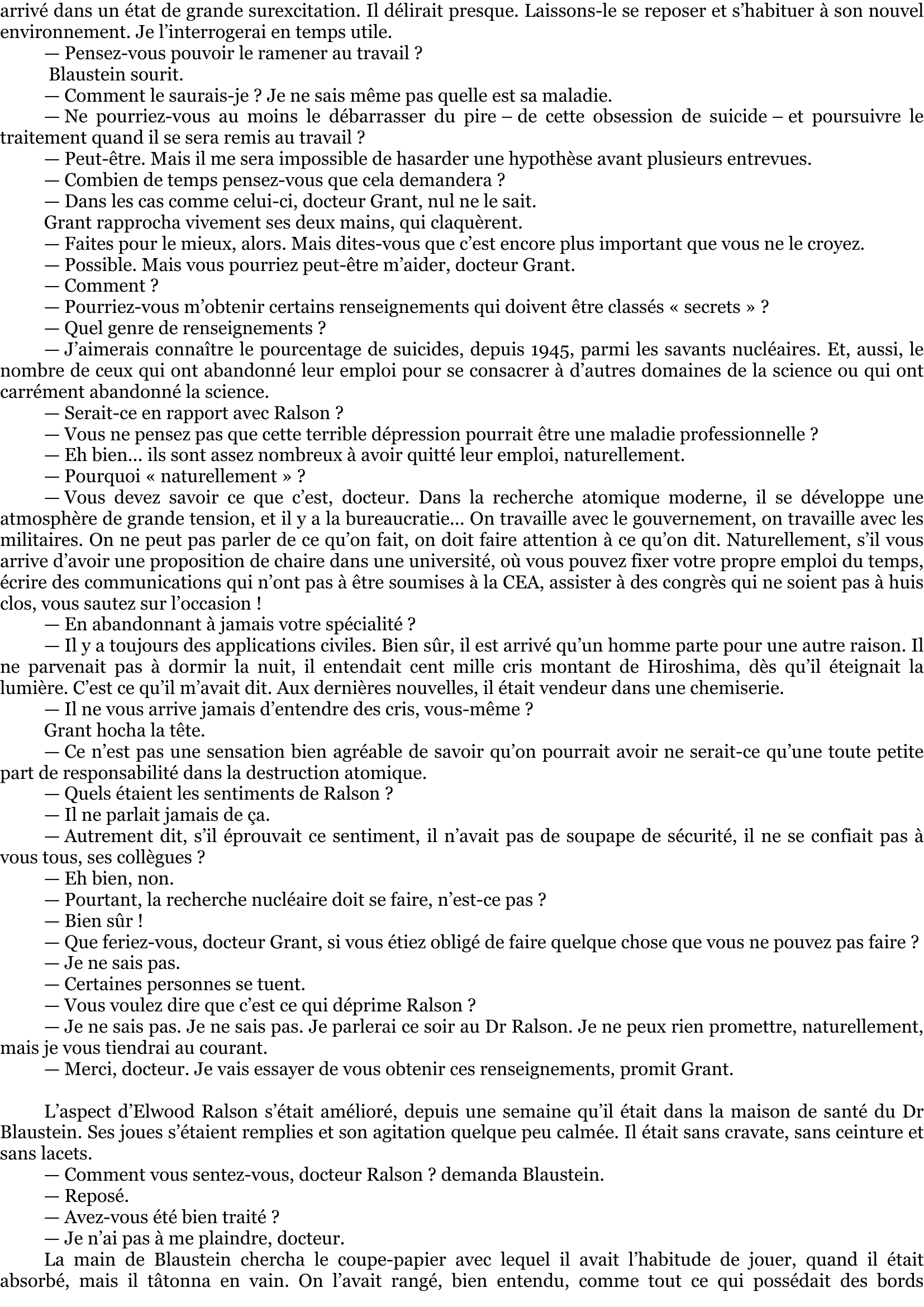demanderais pas quelque chose si je n'estimais pas que c'est nécessaire.
Publié le 15/12/2013
Extrait du document
«
arrivé
dansunétat degrande surexcitation.
Ildélirait presque.
Laissons-le sereposer ets’habituer àson nouvel
environnement.
Jel’interrogerai entemps utile.
— Pensez-vous pouvoirleramener autravail ?
Blaustein sourit.
— Comment lesaurais-je ? Jene sais même pasquelle estsamaladie.
— Ne pourriez-vous aumoins ledébarrasser dupire – de cetteobsession desuicide – et poursuivrele
traitement quandilse sera remis autravail ?
— Peut-être.
Maisilme sera impossible dehasarder unehypothèse avantplusieurs entrevues.
— Combien detemps pensez-vous quecela demandera ?
— Dans lescas comme celui-ci, docteurGrant,nulnelesait.
Grant rapprocha vivementsesdeux mains, quiclaquèrent.
— Faites pourlemieux, alors.Maisdites-vous quec’est encore plusimportant quevous nelecroyez.
— Possible.
Maisvouspourriez peut-être m’aider,docteurGrant.
— Comment ?
— Pourriez-vous m’obtenircertainsrenseignements quidoivent êtreclassés « secrets » ?
— Quel genrederenseignements ?
— J’aimerais connaîtrelepourcentage desuicides, depuis1945,parmi lessavants nucléaires.
Et,aussi, le
nombre deceux quiont abandonné leuremploi pourseconsacrer àd’autres domaines delascience ouqui ont
carrément abandonné lascience.
— Serait-ce enrapport avecRalson ?
— Vous nepensez pasque cette terrible dépression pourraitêtreunemaladie professionnelle ?
— Eh bien...
ilssont assez nombreux àavoir quitté leuremploi, naturellement.
— Pourquoi « naturellement » ?
— Vous devezsavoir ceque c’est, docteur.
Danslarecherche atomiquemoderne, ilse développe une
atmosphère degrande tension, etilya la bureaucratie...
Ontravaille aveclegouvernement, ontravaille avecles
militaires.
Onnepeut pasparler decequ’on fait,ondoit faire attention àce qu’on dit.Naturellement, s’ilvous
arrive d’avoir uneproposition dechaire dansuneuniversité, oùvous pouvez fixervotre propre emploi dutemps,
écrire descommunications quin’ont pasàêtre soumises àla CEA, assister àdes congrès quinesoient pasàhuis
clos, vous sautez surl’occasion !
— En abandonnant àjamais votrespécialité ?
— Il ya toujours desapplications civiles.Biensûr,ilest arrivé qu’unhomme partepouruneautre raison.
Il
ne parvenait pasàdormir lanuit, ilentendait centmille crismontant deHiroshima, dèsqu’il éteignait la
lumière.
C’estcequ’il m’avait dit.Aux dernières nouvelles, ilétait vendeur dansunechemiserie.
— Il nevous arrive jamais d’entendre descris, vous-même ?
Grant hocha latête.
— Ce n’estpasune sensation bienagréable desavoir qu’onpourrait avoirneserait-ce qu’unetoutepetite
part deresponsabilité dansladestruction atomique.
— Quels étaientlessentiments deRalson ?
— Il neparlait jamaisdeça.
— Autrement dit,s’iléprouvait cesentiment, iln’avait pasdesoupape desécurité, ilne seconfiait pasà
vous tous, sescollègues ?
— Eh bien,non.
— Pourtant, larecherche nucléairedoitsefaire, n’est-ce pas ?
— Bien sûr !
— Que feriez-vous, docteurGrant,sivous étiez obligé defaire quelque chosequevous nepouvez pasfaire ?
— Je nesais pas.
— Certaines personnessetuent.
— Vous voulezdirequec’est cequi déprime Ralson ?
— Je nesais pas.
Jene sais pas.
Jeparlerai cesoir auDr Ralson.
Jene peux rienpromettre, naturellement,
mais jevous tiendrai aucourant.
— Merci, docteur.Jevais essayer devous obtenir cesrenseignements, promitGrant.
L’aspect d’Elwood Ralsons’étaitamélioré, depuisunesemaine qu’ilétait dans lamaison desanté duDr
Blaustein.
Sesjoues s’étaient remplies etson agitation quelquepeucalmée.
Ilétait sanscravate, sansceinture et
sans lacets.
— Comment voussentez-vous, docteurRalson ? demanda Blaustein.
— Reposé.
— Avez-vous étébien traité ?
— Je n’aipasàme plaindre, docteur.
La main deBlaustein cherchalecoupe-papier aveclequel ilavait l’habitude dejouer, quand ilétait
absorbé, maisiltâtonna envain.
Onl’avait rangé, bienentendu, commetoutcequi possédait desbords.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pour former l'État, une seule chose est nécessaire : que tout le pouvoir de décréter appartienne soit à tous collectivement, soit à quelques-uns, soit à un seul.
- Lettres à Lucilius (traduction de Bréhier) Sénèque C'est une chose fort utile que celle dont tu t'enquiers, et nécessaire pour qui ambitionne la sagesse : diviser la philosophie, et séparer son corps immense en différents membres.
- L'art est-il chose très nécessaire ?
- Dans la République, VII, 540 d-541 b, Platon dit que le vrai philosophe est un homme libre qui, à la tête de la cité, voit la justice « comme la chose la plus importante et la plus nécessaire ». Or, on sait que la cité est organisée selon un ordre hiérarchique clairement défini et contraignant et que « l'homme lui ressemble ». Comment démêler ce paradoxe apparent ?
- Le superflu, chose très nécessaire ?