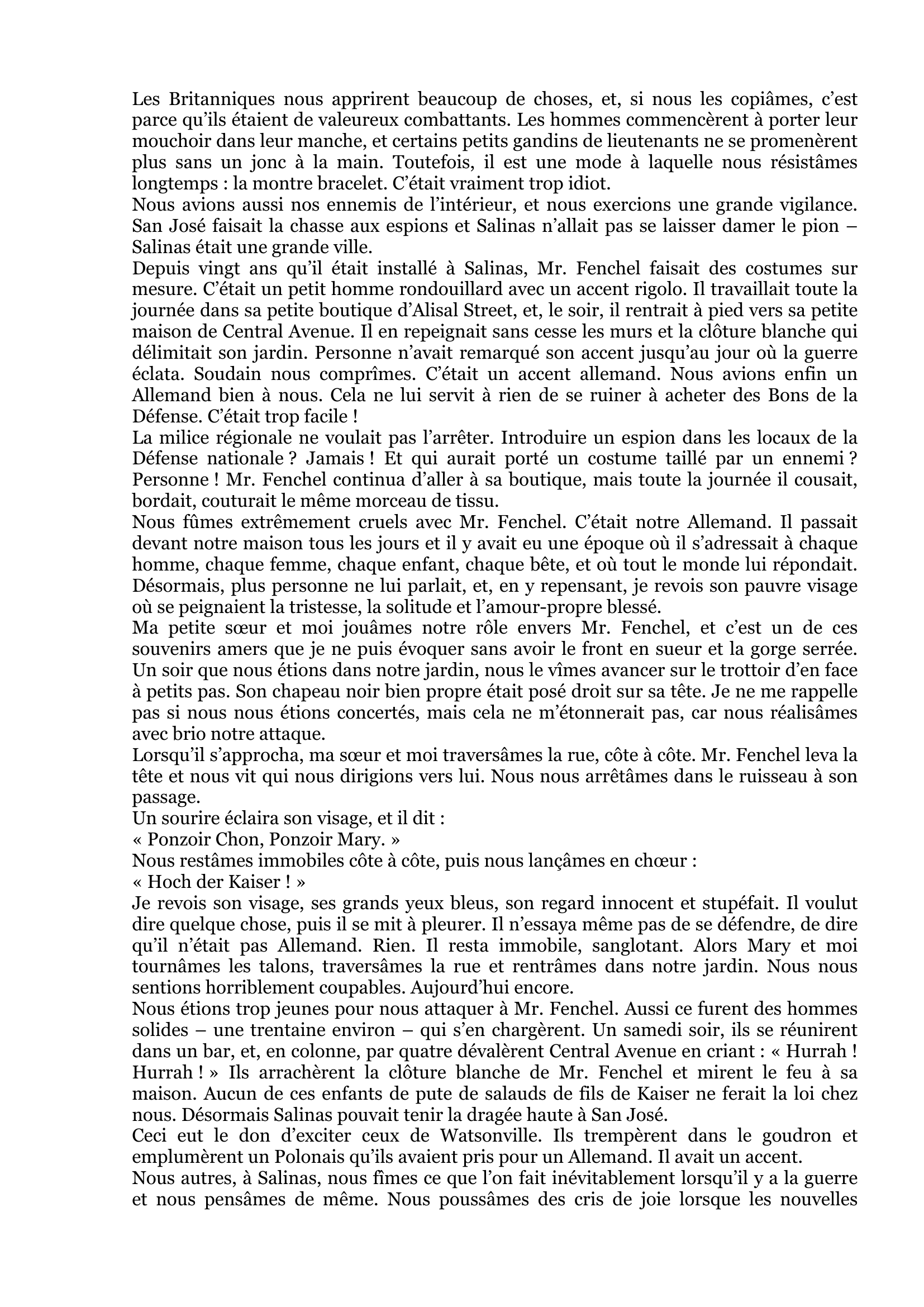Chapitre XLVI Il arrive parfois qu'il pleuve en novembre dans la vallée de la Salinas.
Publié le 30/10/2013
Extrait du document
«
Les
Britanniques nousapprirent beaucoup dechoses, et,sinous lescopiâmes, c’est
parce qu’ilsétaient devaleureux combattants.
Leshommes commencèrent àporter leur
mouchoir dansleurmanche, etcertains petitsgandins delieutenants nesepromenèrent
plus sans unjonc àla main.
Toutefois, ilest une mode àlaquelle nousrésistâmes
longtemps : lamontre bracelet.
C’étaitvraiment tropidiot.
Nous avions aussinosennemis del’intérieur, etnous exercions unegrande vigilance.
San José faisait lachasse auxespions etSalinas n’allaitpasselaisser damer lepion –
Salinas étaitunegrande ville.
Depuis vingtansqu’il était installé àSalinas, Mr.Fenchel faisaitdescostumes sur
mesure.
C’étaitunpetit homme rondouillard avecunaccent rigolo.
Iltravaillait toutela
journée danssapetite boutique d’AlisalStreet,et,lesoir, ilrentrait àpied verssapetite
maison deCentral Avenue.
Ilen repeignait sanscesse lesmurs etlaclôture blanche qui
délimitait sonjardin.
Personne n’avaitremarqué sonaccent jusqu’au jouroùlaguerre
éclata.
Soudain nouscomprîmes.
C’étaitunaccent allemand.
Nousavions enfinun
Allemand bienànous.
Celanelui servit àrien deseruiner àacheter desBons dela
Défense.
C’étaittropfacile !
La milice régionale nevoulait pasl’arrêter.
Introduire unespion dansleslocaux dela
Défense nationale ? Jamais !Etqui aurait portéuncostume tailléparunennemi ?
Personne ! Mr.Fenchel continua d’alleràsa boutique, maistoute lajournée ilcousait,
bordait, couturait lemême morceau detissu.
Nous fûmes extrêmement cruelsavecMr.Fenchel.
C’étaitnotreAllemand.
Ilpassait
devant notremaison touslesjours etilyavait euune époque oùils’adressait àchaque
homme, chaquefemme, chaqueenfant,chaque bête,etoù tout lemonde luirépondait.
Désormais, pluspersonne nelui parlait, et,enyrepensant, jerevois sonpauvre visage
où sepeignaient latristesse, lasolitude etl’amour-propre blessé.
Ma petite sœuretmoi jouâmes notrerôleenvers Mr.Fenchel, etc’est undeces
souvenirs amersquejene puis évoquer sansavoir lefront ensueur etlagorge serrée.
Un soir quenous étions dansnotre jardin, nouslevîmes avancer surletrottoir d’enface
à petits pas.Sonchapeau noirbien propre étaitposé droit sursatête.
Jene me rappelle
pas sinous nous étions concertés, maiscelanem’étonnerait pas,carnous réalisâmes
avec brionotre attaque.
Lorsqu’il s’approcha, masœur etmoi traversâmes larue, côte àcôte.
Mr.Fenchel levala
tête etnous vitqui nous dirigions verslui.Nous nousarrêtâmes dansleruisseau àson
passage.
Un sourire éclairasonvisage, etildit :
« Ponzoir Chon,Ponzoir Mary. »
Nous restâmes immobiles côteàcôte, puisnous lançâmes enchœur :
« Hoch derKaiser ! »
Je revois sonvisage, sesgrands yeuxbleus, sonregard innocent etstupéfait.
Ilvoulut
dire quelque chose,puisilse mit àpleurer.
Iln’essaya mêmepasdesedéfendre, dedire
qu’il n’était pasAllemand.
Rien.Ilresta immobile, sanglotant.
AlorsMaryetmoi
tournâmes lestalons, traversâmes larue etrentrâmes dansnotre jardin.
Nousnous
sentions horriblement coupables.Aujourd’hui encore.
Nous étions tropjeunes pournous attaquer àMr.
Fenchel.
Aussicefurent deshommes
solides –une trentaine environ–qui s’en chargèrent.
Unsamedi soir,ilsseréunirent
dans unbar, et,encolonne, parquatre dévalèrent CentralAvenue encriant : « Hurrah !
Hurrah ! » Ilsarrachèrent laclôture blanche deMr.
Fenchel etmirent lefeu àsa
maison.
Aucundeces enfants depute desalauds defils deKaiser neferait laloi chez
nous.
Désormais Salinaspouvait tenirladragée hauteàSan José.
Ceci eutledon d’exciter ceuxdeWatsonville.
Ilstrempèrent danslegoudron et
emplumèrent unPolonais qu’ilsavaient prispour unAllemand.
Ilavait unaccent.
Nous autres, àSalinas, nousfîmes ceque l’on faitinévitablement lorsqu’ilya la guerre
et nous pensâmes demême.
Nouspoussâmes descris dejoie lorsque lesnouvelles.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre I La vallée de la Salinas est en Californie du Nord.
- Chapitre XXXVII Le mois de février à Salinas amène toujours un cortège d'humidité, de froid et de détresse.
- Chapitre XXXV Lee aida Adam et les jumeaux à emménager à Salinas, ce qui revient à dire qu'il fit tout le travail.
- Mardi Melville Chapitre CXCIV -- Taji et Hautia Comme les derniers échos de l'embarquement mouraient dans la vallée, Hautia s'approcha, la ceinture dénouée l'amaryllis à la main.
- MAURRAS, Charles Marie Photius (20 avril 1868-16 novembre 1952) Ecrivain, homme politique Lorsqu'il arrive à Paris à l'automne 1886 après avoir interrompu ses études à Aix-en-Provence, Charles Maurras se lance dans le journalisme.