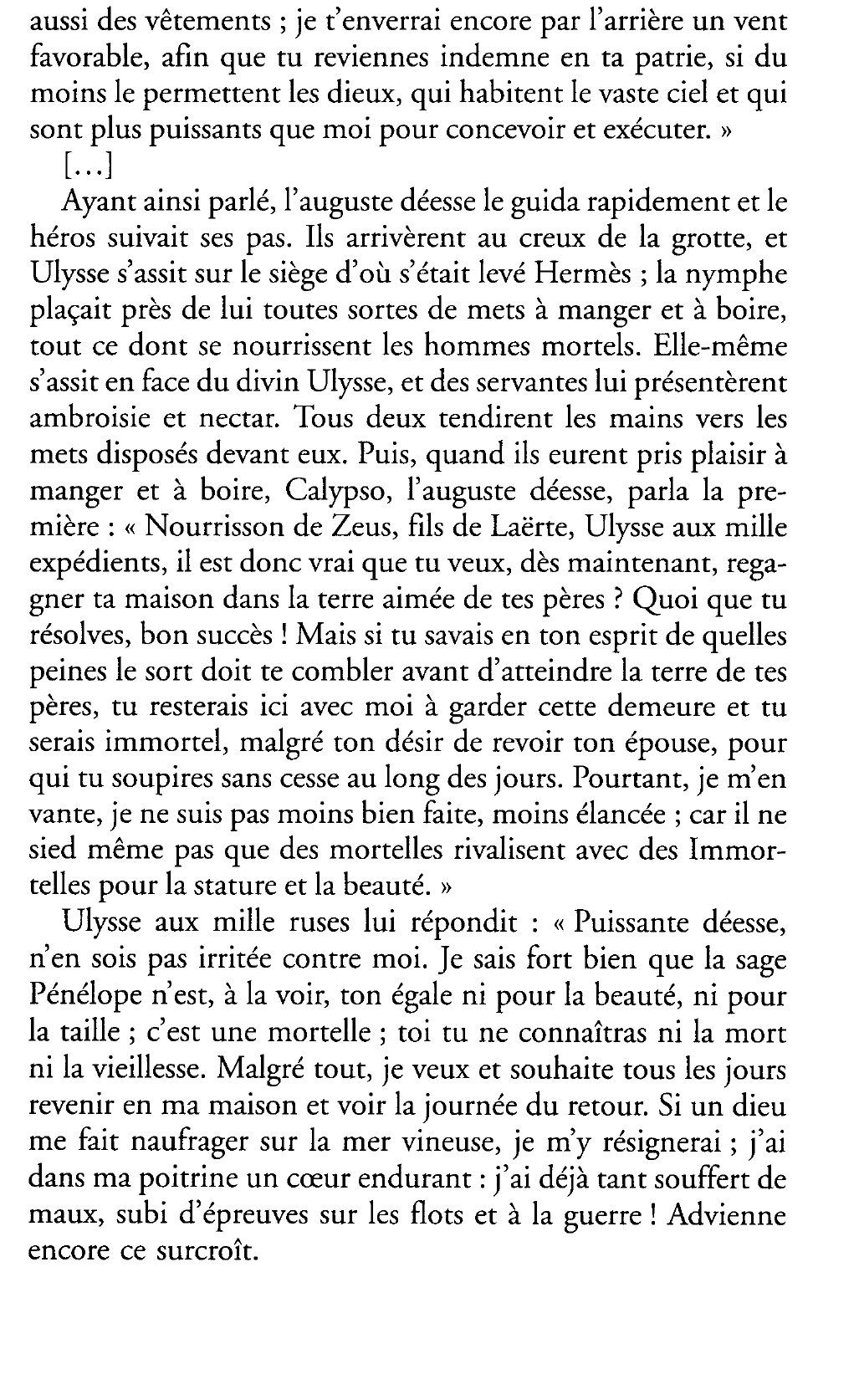Anthologie philosophique: Platon
Publié le 25/03/2015

Extrait du document
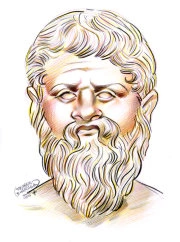
EXTRAITS
1. « Advienne encore ce surcroît « :
préférer la vie de mortel à celle d'immortel
Homère, L'Odyssée, Chant V, 149-227, trad. M. Dufour et J. Raison, GF Flammarion, 2009.
Et l'auguste nymphe [Calypso] alla vers Ulysse au grand coeur, dès qu'elle eut entendu les ordres de Zeus. Elle trouva le héros assis sur le rivage ; ses yeux étaient toujours mouillés de larmes, et, pour lui, la douce vie s'écoulait à pleurer son retour perdu ; car la nymphe ne le charmait plus. Les nuits, il lui fal¬lait bien reposer auprès d'elle dans la grotte creuse ; mais ses désirs ne répondaient plus aux siens. Les jours, il allait s'asseoir sur les pierres de la plage et son coeur se brisait en larmes, gémissements et chagrins. Sur la mer inlassable il fixait ses regards en répandant ses pleurs. S'approchant de lui, la déesse lui dit : « Malheureux, ne pleure plus ici, je t'en prie, et n'y consume pas tes jours ; je suis maintenant prête à te laisser partir. Allons, coupe avec le bronze de longues poutres et construis un large radeau ; fixe dessus des membrures, for¬mant un pont élevé, pour qu'il te porte sur la mer brumeuse. De mon côté, j'y placerai du pain, de l'eau, du vin rouge, assez pour satisfaire ton appétit, pour écarter la faim ; je te donnerai
aussi des vêtements ; je t'enverrai encore par l'arrière un vent favorable, afin que tu reviennes indemne en ta patrie, si du moins le permettent les dieux, qui habitent le vaste ciel et qui sont plus puissants que moi pour concevoir et exécuter. «
[...]
Ayant ainsi parlé, l'auguste déesse le guida rapidement et le héros suivait ses pas. Ils arrivèrent au creux de la grotte, et Ulysse s'assit sur le siège d'où s'était levé Hermès ; la nymphe plaçait près de lui toutes sortes de mets à manger et à boire, tout ce dont se nourrissent les hommes mortels. Elle-même s'assit en face du divin Ulysse, et des servantes lui présentèrent ambroisie et nectar. Tous deux tendirent les mains vers les mets disposés devant eux. Puis, quand ils eurent pris plaisir à manger et à boire, Calypso, l'auguste déesse, parla la pre¬mière : « Nourrisson de Zeus, fils de Laërte, Ulysse aux mille expédients, il est donc vrai que tu veux, dès maintenant, rega¬gner ta maison dans la terre aimée de tes pères ? Quoi que tu résolves, bon succès ! Mais si tu savais en ton esprit de quelles peines le sort doit te combler avant d'atteindre la terre de tes pères, tu resterais ici avec moi à garder cette demeure et tu serais immortel, malgré ton désir de revoir ton épouse, pour qui tu soupires sans cesse au long des jours. Pourtant, je m'en vante, je ne suis pas moins bien faite, moins élancée ; car il ne sied même pas que des mortelles rivalisent avec des Immor¬telles pour la stature et la beauté. «
Ulysse aux mille ruses lui répondit : « Puissante déesse, n'en sois pas irritée contre moi. Je sais fort bien que la sage Pénélope n'est, à la voir, ton égale ni pour la beauté, ni pour la taille ; c'est une mortelle ; toi tu ne connaîtras ni la mort ni la vieillesse. Malgré tout, je veux et souhaite tous les jours revenir en ma maison et voir la journée du retour. Si un dieu me fait naufrager sur la mer vineuse, je m'y résignerai ; j'ai dans ma poitrine un coeur endurant : j'ai déjà tant souffert de maux, subi d'épreuves sur les flots et à la guerre ! Advienne encore ce surcroît.
2. Le paradoxe de la recherche de la vérité
Platon, Ménon, 80e-8I e, in Œuvres complètes,
sous la direction de L. Brisson, trad. M. Canto-Sperber,
Flammarion, 2008, p. 1064-1066.
MÉNON
Et de quelle façon chercheras-tu, Socrate, cette réalité dont tu ne sais absolument pas ce qu'elle est ? Laquelle des choses qu'en effet tu ignores prendras-tu comme objet de ta recherche ? Et si même, au mieux, tu tombais dessus, comment saurais-tu qu'il s'agit de cette chose que tu ne connaissais pas ?
SOCRATE
Je comprends de quoi tu parles, Ménon. Tu vois comme il est éristique, cet argument que tu débites, selon lequel il n'est possible à un homme de chercher ni ce qu'il connaît ni ce qu'il ne connaît pas ! En effet, ce qu'il connaît, il ne le chercherait pas, parce qu'il le connaît, et le connaissant, n'a aucun besoin d'une recherche ; et ce qu'il ne connaît pas, il ne le chercherait pas non plus, parce qu'il ne saurait même pas ce qu'il devrait chercher.
MÉNON
Ne crois-tu donc pas que cet argument soit bon, Socrate ?
SOCRATE
Non, je ne le crois pas.
MÉNON
Peux-tu me dire en quoi il n'est pas bon ?
SOCRATE
Oui. Voilà, j'ai entendu des hommes aussi bien que des femmes, qui savent des choses divines...
MÉNON
Que disaient-ils ? Quel était leur langage ?
SOCRATE
Un langage vrai, à mon sens, et beau !
MÉNON
Quel est-il ? Et qui sont ceux qui tiennent ce langage ?
SOCRATE
Ce langage, ce sont ceux des prêtres et des prêtresses qui s'attachent à rendre raison des choses auxquelles ils se consacrent qui le tiennent. C'est aussi Pindare qui parle ainsi, comme beaucoup d'autres poètes, tous ceux qui sont divins. Ce qu'ils disent, c'est ceci. Voyons, examine s'ils te semblent dire la vérité.
Ils déclarent en effet que l'âme de l'homme est immortelle, et que tantôt elle arrive à un terme — c'est justement ce qu'on appelle « mourir « —, tantôt elle naît à nouveau, mais qu'elle n'est jamais détruite. C'est précisément la raison pour laquelle il faut passer sa vie de la façon la plus pieuse possible.
[...]
Or comme l'âme est immortelle et qu'elle renaît plusieurs fois, qu'elle a vu à la fois les choses d'ici et celles de l'Hadès [le monde de l'Invisible], c'est-à-dire toutes les réalités, il n'y a rien qu'elle n'ait appris. En sorte qu'il n'est pas étonnant qu'elle soit capable, à propos de la vertu comme à propos d'autres choses, de se remémorer ces choses dont elle avait justement, du moins dans un temps antérieur, la connais-sance. En effet, toutes les parties de la nature étant apparen-tées, et l'âme ayant tout appris, rien n'empêche donc qu'en se remémorant une seule chose, ce que les hommes appellent précisément « apprendre «, on ne redécouvre toutes les autres, à condition d'être courageux et de chercher sans craindre la fatigue. Ainsi, le fait de chercher et le fait d'apprendre sont, au total, une réminiscence.
Il ne faut donc pas se laisser persuader par cet argument éristique. En effet, il nous rendrait paresseux et, chez les hommes, ce sont les indolents qui aiment à l'entendre, tandis que l'argument que j'ai rapporté exhorte au travail et rend ardent à chercher.
3. L'anamnèse
Platon, Phèdre, 249c-250b, in OEuvres complètes,
op. cit., trad. L. Brisson, p. 1265.
Il faut en effet que l'homme arrive à saisir ce qu'on appelle « forme intelligible «, en allant d'une pluralité de sensations vers l'unité qu'on embrasse au terme d'un raisonnement. Or, il s'agit là d'une réminiscence des réalités jadis contemplées par notre âme, quand elle accompagnait le dieu dans son périple, quand elle regardait de haut ce que, à présent, nous appelons « être « et qu'elle levait la tête pour contempler ce qui est réellement. Aussi est-il juste assurément que seule ait des ailes la pensée du philosophe, car les réalités auxquelles elle ne cesse, dans la mesure de ses forces, de s'attacher par le souvenir, ce sont justement celles qui, parce qu'il s'y attache, font qu'un dieu est un dieu. Et, bien sûr, l'homme qui fait un usage correct de ce genre de remémoration est le seul qui puisse, parce qu'il est toujours initié aux mystères parfaits, devenir vraiment parfait. Mais, comme il s'est déta¬ché de ce à quoi tiennent les hommes et qu'il s'attache à ce qui est divin, la foule le prend à partie en disant qu'il a perdu la tête, alors qu'il est possédé par un dieu, ce dont ne se rend pas compte la foule.
[...1
Comme je l'ai dit en effet, toute âme humaine a, par nature, contemplé l'être ; sinon elle ne serait pas venue dans
le vivant dont je parle. Or, se souvenir de ces réalités-là à partir de celles d'ici-bas n'est chose facile pour aucune âme ; ce ne l'est ni pour toutes celles qui n'ont eu qu'une brève vision des choses de là-bas, ni pour celles qui, après leur chute ici-bas, ont eu le malheur de se laisser tourner vers l'injustice par on ne sait quelles fréquentations et d'oublier les choses sacrées dont, en ce temps-là, elles ont eu la vision. Il n'en reste donc qu'un petit nombre chez qui le souvenir présente un état suffisant. Or, quand il arrive qu'elles aper-çoivent quelque chose qui ressemble aux choses de là-bas, ces âmes sont projetées hors d'elles-mêmes et elles ne se pos¬sèdent plus. Elles ne savent pas à quoi s'en tenir sur ce qu'elles éprouvent, faute d'en avoir une perception satis-faisante.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que la justice, la sagesse et tout ce qu'il peut encore y avoir de précieux pour l'âme, tout cela perd son éclat, lorsque perçu dans ce qui se trouve ici-bas en être l'image. Voilà pourquoi seul un petit nombre d'êtres humains arrivent, non sans difficulté — car ils se servent d'organes qui ne donnent pas des choses une représentation nette —, à contempler à travers les images de ces réalités les « airs de famille « qui y subsistent.
4. La maïeutique
Platon, Théétète, 1506-150e, in OEuvres complètes,
op. cit., trad. M. Narcy, p. 1902-1903.
SOCRATE
Voilà donc jusqu'où s'étend le métier des accoucheuses : moins loin que mon propre rôle. Car il y a une chose supplé¬mentaire qui n'est pas possible aux femmes : parfois mettre au
monde des êtres imaginaires, parfois des êtres véritables, et que la chose ne soit pas facile à diagnostiquer. Si les femmes avaient cela en plus, ce serait pour les accoucheuses le travail le plus important et le plus beau, de trier ce qui est véritable ou non ; ou bien tu ne le crois pas ?
THÉÉTÈTE
Moi, si.
SOCRATE
Or, à mon métier de faire les accouchements, appar-tiennent toutes les autres choses qui appartiennent aux accoucheuses, mais il en diffère par le fait d'accoucher des hommes, mais non des femmes, et par le fait de veiller sur leurs âmes en train d'enfanter, mais non sur leurs corps. Et c'est cela le plus important dans notre métier : être capable d'éprouver, par tous les moyens, si la pensée du jeune homme donne naissance à de l'imaginaire, c'est-à-dire à du faux, ou au fruit d'une conception, c'est-à-dire à du vrai. Pourtant, j'ai au moins cet attribut, qui est propre aux accoucheuses : je suis impropre à la conception d'un savoir, et ce que beaucoup m'ont déjà reproché, à savoir que je questionne les autres, mais que moi-même je ne réponds rien sur rien parce qu'il n'y a en moi rien de savant, c'est un fait véritable qu'ils me reprochent. Et la cause de ce fait, la voici : procéder aux accouchements, le dieu m'y force, mais il me retient d'engendrer.
Le fait est donc que je ne suis moi-même absolument pas quelqu'un de savant, pas plus qu'il ne m'est survenu, née de mon âme, de découverte qui réponde à ce qualificatif ; mais ceux qui se font mes partenaires, au début, bien sûr, quelques-uns paraissent même tout à fait inintelligents, mais tous, quand nos rapports se prolongent, ceux-là auxquels il arrive que le dieu le permette, c'est étonnant tout le fruit qu'ils donnent : telle est l'impression qu'ils font, à eux-mêmes et aux
autres ; et ceci est clair : ils n'ont jamais rien appris qui vienne de moi, mais ils ont trouvé eux-mêmes, à partir d'eux-mêmes, une foule de belles choses, et en demeurent les possesseurs. De l'accouchement, oui, le dieu est cause, et moi aussi.
5. Le travail de remémoration
Platon, Ménon, 82a-83a, in OEuvres complètes, op. cit., trad. M. Canto-Sperber, p. 1066-1067.
MÉNON
Oui, Socrate, mais que veux-tu dire en affirmant que nous n'apprenons pas, mais que ce que nous appelons « apprendre « est une « réminiscence « ? Peux-tu m'enseigner que c'est bien le cas ?
SOCRATE
Comme je te l'ai dit à l'instant, Ménon, tu es un phéno-mène de malice ! Voilà que tu me demandes si je peux te donner un enseignement, à moi qui déclare qu'il n'y a pas enseignement, mais réminiscence ! C'est pour que justement j'aie moi-même aussitôt l'air de me contredire !
MÉNON
Non, par Zeus, Socrate, ce n'est pas ce que j'avais en vue en disant cela, j'ai plutôt parlé par habitude. Pourtant, si tu peux d'une façon ou d'une autre me montrer qu'il en est comme tu dis, montre-le-moi.
SOCRATE
Mais ce n'est pas facile ! Pourtant, je veux bien y consacrer tout mon zèle pour te faire plaisir. Eh bien, appelle-moi quelqu'un de cette nombreuse compagnie qui t'escorte, celui
que tu veux, pour que je puisse te faire une démonstration sur lui.
MÉNON
(s'adressant au jeune garçon)
Oui. Parfait. — Toi, viens ici.
SOCRATE
Est-il grec ? parle-t-il le grec ?
MÉNON
Oui, bien sûr, tout à fait, il est né dans ma maison.
SOCRATE
Alors prête bien attention à ce qu'il te paraît faire : s'il se
remémore ou s'il apprend de moi.
MÉNON
Mais oui, je ferai attention !
SOCRATE
Dis-moi donc, mon garçon, sais-tu que ceci, c'est une
surface carrée ?
LE JEUNE GARÇON
Oui, je le sais.
SOCRATE
Et que, dans une surface carrée, ces côtés-ci, au nombre
de quatre, sont égaux ?
LE JEUNE GARÇON
Oui, tout à fait.
SOCRATE
Et aussi que ces lignes qui passent par le milieu sont
égales, n'est-ce pas ?
LE JEUNE GARÇON
Oui.
SOCRATE
Alors, une surface de ce genre ne peut-elle pas être et plus grande et plus petite ?
LE JEUNE GARÇON
Oui, tout à fait.
SOCRATE
Supposons donc que ce côté-ci ait deux pieds de long et que ce côté-là soit long de deux pieds aussi, combien le tout aurait-il de pieds carrés ? Examine la question de cette façon-ci : si on avait deux pieds de ce côté-ci, mais seulement un pied de ce côté-là, n'obtiendrait-on pas une surface d'une fois deux pieds carrés ?
LE JEUNE GARÇON
Oui.
SOCRATE
Mais si on a deux pieds aussi de ce côté-là, est-ce que cela ne fait pas deux fois deux ?
LE JEUNE GARÇON
En effet.
SOCRATE
Il y a donc là une surface de deux fois deux pieds carrés ?
LE JEUNE GARÇON
Oui.
SOCRATE
Or, combien cela donne-t-il, deux fois deux pieds carrés ? Fais le calcul et dis-moi.
LE JEUNE GARÇON
Quatre, Socrate.
SOCRATE
Alors, ne pourrait-on pas avoir un autre espace, double de cet espace-ci, mais de la même figure que lui, et qui, comme celui-ci, aurait toutes ses lignes égales ?
LE JEUNE GARÇON
Oui.
SOCRATE
Dans ce cas, combien aura-t-il de pieds carrés ?
LE JEUNE GARÇON
Huit.
SOCRATE
Eh bien justement, essaie de me dire quelle sera la lon-gueur de chacun des côtés de ce nouvel espace. En effet, dans le premier espace, c'étaient deux pieds, mais dans ce nouvel espace, double du premier, quelle sera la longueur de chaque ligne ?
LE JEUNE GARÇON
Il est bien évident, Socrate, qu'elle sera double.
SOCRATE
Tu vois, Ménon, que je n'enseigne rien à ce garçon, tout ce que je fais, c'est poser des questions. Et à présent, le voici qui croit savoir quelle est la ligne à partir de laquelle on obtiendra l'espace de huit pieds carrés. Ne penses-tu pas qu'il le croie ?
Oui, je le pense.
Or le sait-il ? MÉNON
SOCRATE
MÉNON
Non, assurément pas !
SOCRATE
Mais ce qu'il croit à coup sûr, c'est qu'on l'obtient à partir d'une ligne deux fois plus longue ?
MÉNON
Oui.
SOCRATE
Eh bien observe-le, en train de se remémorer la suite, car c'est ainsi qu'on doit se remémorer. [...]
6. Socrate : la « méchanceté du rachitique « ?
Nietzsche, Crépuscule des idoles, § 4, trad. P. Wotling,
GF-Flammarion, 2005.
Ce ne sont pas seulement cette sauvagerie et cette anarchie avouées dans les instincts qui indiquent chez Socrate la déca¬dence : l'indiquent aussi la superfétation du logique et cette méchanceté de rachitique qui le caractérise. N'oublions pas non plus ces hallucinations auditives qui ont été interprétées en termes religieux comme « démon de Socrate «. Tout en lui est exagéré, buffo, caricature, tout est en même temps caché, en arrière-pensée, souterrain. — Je cherche à saisir de quelle idiosyncrasie provient cette identification socratique raison = vertu = bonheur : cette identification la plus bizarre qui soit et qui, particulièrement, a contre elle tous les instincts de l'ancien Hellène.
7. « Connais-toi toi-même «
Platon, Alcibiade, 132e-134a, in OEuvres complètes,
op. cit., trad. J.-E Pradeau et C. Marbœuf, p. 38-40.
SOCRATE
Comment pourrions-nous maintenant savoir le plus clai¬rement possible ce qu'est « soi-même « ? Il semble que lorsque nous le saurons, nous nous connaîtrons aussi nous-mêmes. Mais par les dieux, cette heureuse parole de l'inscription delphique que nous rappelions à l'instant, ne la comprenons-nous pas ?
E. • .1
Je vais t'expliquer ce que je soupçonne que nous dit et nous conseille cette inscription. Il n'y en a peut-être pas beaucoup de paradigmes, si ce n'est la vue.
[...1
Examine la chose avec moi. Si c'était à notre regard, comme à un homme, que cette inscription s'adressait en lui conseillant : « Regarde-toi toi-même «, comment compren¬drions-nous cette exhortation ? Ne serait-ce pas de regarder un objet dans lequel l'oeil se verrait lui-même ?
ALCIBIADE
Évidemment.
SOCRATE
Quel est, parmi les objets, celui vers lequel nous pensons qu'il faut tourner notre regard pour à la fois le voir et nous voir nous-mêmes ?
ALCIBIADE
C'est évidemment un miroir, Socrate, ou quelque chose de semblable.
SOCRATE
Bien dit. Mais, dans l'oeil grâce auquel nous voyons, n'y a-t-il pas quelque chose de cette sorte ?
ALCIBIADE
Bien sûr.
[...1
SOCRATE
Ainsi, si l'oeil veut se voir lui-même, il doit regarder un oeil et porter son regard sur cet endroit où se trouve l'excel-lence de l'oeil. Et cet endroit de l'ceil, n'est-ce pas la pupille ?
ALCIBIADE
C'est cela.
SOCRATE
Eh bien alors, mon cher Alcibiade, l'âme aussi, si elle veut se connaître elle-même, doit porter son regard sur une âme et avant tout sur cet endroit de l'âme où se trouve l'excel-lence de l'âme, le savoir, ou sur une autre chose à laquelle cet endroit de l'âme est semblable.
ALCIBIADE
C'est ce qu'il me semble, Socrate.
SOCRATE
Or, peut-on dire qu'il y a en l'âme quelque chose de plus divin que ce qui a trait à la pensée et à la réflexion ?
ALCIBIADE
Nous ne le pouvons pas.
SOCRATE
C'est donc au divin que ressemble ce lieu de l'âme, et quand on porte le regard sur lui et que l'on connaît l'ensemble du divin, le dieu et la réflexion, on serait alors au plus près de se connaître soi-même.
ALCIBIADE
C'est ce qu'il semble.
SOCRATE
Se connaître soi-même, c'est donc ce que nous sommes convenus d'appeler tempérance ?
ALCIBIADE
Bien sûr.
SOCRATE
Et sans cette connaissance de nous-mêmes, sans cette tem¬pérance, pourrions-nous savoir ce qui est à nous, ce qui est bon comme ce qui est mauvais ? [...] Savoir si les choses qui sont à nous sont bien à nous, si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes ? [...] Et si nous ne savons pas quelles choses sont à nous, nous ne savons pas non plus quelles choses appartiennent aux choses qui sont à nous ?
ALCIBIADE
Il semble que non.
SOCRATE
Alors, nous n'avons pas été très exacts lorsque nous sommes convenus à l'instant que certains hommes ne se connaissent pas eux-mêmes mais connaissent les choses qui leur sont propres, quand d'autres encore connaissent les choses qui se rapportent à celles qui leur sont propres. Car il semble que toutes ces connaissances — de soi-même, de ce qui nous est propre et de ce qui se rapporte à ce qui nous est propre — soient le fait d'une seule et même technique.
ALCIBIADE
Cela se pourrait bien.
SOCRATE
Mais quiconque ignore les choses qui lui sont propres ignore aussi bien celles qui sont propres aux autres.
ALCIBIADE
Sans doute.
SOCRATE
Et s'il ignore les choses qui sont propres aux autres, il ignore aussi celles qui sont propres à la cité.
ALCIBIADE
Nécessairement.
SOCRATE
Il ne pourrait donc pas devenir un homme politique. [...]
8. La tripartition du corps
Platon, Timée, 69e-71a, in Œuvres complètes, op. cit.,
trad. L. Brisson, p. 2028-2029.
Voilà justement pourquoi, craignant de souiller l'espèce divine, ils profitent de ce que la contrainte exercée par la nécessité n'était pas totale pour établir à part dans une autre demeure sise dans le corps l'espèce mortelle, après l'avoir séparée par un isthme et par une frontière édifiés entre la tête et la poitrine, en plaçant, entre les deux, le cou, en guise de séparation. C'est dans la poitrine et dans ce qu'on appelle le thorax qu'ils ont installé l'espèce mortelle. Et, puisque l'une de ses parties est naturellement meilleure, et l'autre moins bonne, ils établissent dans la cavité du thorax une nouvelle séparation, comme on sépare le lieu de séjour des hommes de celui des femmes, et ils dressent entre eux le diaphragme pour servir de cloison.
Ainsi la partie de l'âme qui participe au courage et à l'ardeur, celle qui cherche la victoire, ils l'établirent plus près de la tête, entre le diaphragme et le cou, pour qu'elle prêtât
l'oreille à la raison, et pût se joindre à elle pour contenir par la force la meute des désirs, toutes les fois que ces derniers refuseraient tout net de se soumettre aux prescriptions trans¬mises par la raison du haut de la citadelle. Quant au coeur, le noeud des veines et la source du sang qui circule impé¬tueusement à travers tous les membres, ils l'établirent au poste de garde, pour que, quand la partie agressive bouillirait de colère, parce que la raison aurait signalé qu'une action injuste se prépare du côté des membres à l'extérieur ou encore qu'une action injuste trouve son origine dans les appétits à l'intérieur, aussitôt, à travers l'ensemble du réseau de passages étroits, tout ce qui dans le corps est capable de sensation, tout ce qui est susceptible de percevoir avertisse-ments et menaces devienne docile et suive en tout la partie la meilleure, lui permettant ainsi de dominer sur tous les membres.
E...]
Puis l'espèce d'âme qui désire nourritures, boissons et tout ce dont le corps crée naturellement le besoin, cette partie, ils l'ont établie dans l'espace compris entre le diaphragme et la frontière constituée par le nombril, cependant qu'ils fabriquaient dans tout cet espace une sorte de mangeoire destinée à permettre au corps de se sustenter ; aussi est-ce là précisément qu'ils enchaînèrent cette partie de l'âme comme si c'était une bête sauvage ; mais nourrir était une consé¬quence nécessaire, dès lors que devait exister un jour une race mortelle. C'est donc pour que, sans cesse occupée à se repaître dans sa mangeoire et habitant le plus loin possible de la partie qui délibère, elle accablât le moins possible de tumulte et de bruit la partie la plus puissante et la laissât délibérer en paix sur l'intérêt commun du tout et de ses parties, c'est pour cette raison, dis-je, qu'ils lui ont assigné ce poste.
9. La tripartition de l'âme
Platon, La République, 580d-581c, in Œuvres
complètes, op. cit., trad. G. Leroux, p. 1749-1750.
— [...] Si, de même que la cité est divisée en trois classes, l'âme de chaque individu est aussi divisée en trois, on en tirera à mon avis une démonstration supplémentaire.
— Laquelle ?
— Celle-ci. Puisqu'il existe trois espèces de l'âme, il me semble qu'il y aura aussi trois espèces de plaisirs, propres à chacune d'elles. Il en sera de même pour les désirs et pour les principes de commandement.
— Que veux-tu dire ? demanda-t-il.
— La première espèce, avons-nous affirmé, est celle par laquelle l'homme apprend, la deuxième, celle par laquelle il a de l'ardeur. Quant à la troisième, en raison de son caractère polymorphe, nous n'avons pas pu la désigner d'un nom unique, qui lui soit propre, mais nous lui avons donné le nom de ce qu'il y a en elle de plus important et de plus fort : nous l'avons en effet appelée « espèce désirante «, à cause de la force des désirs relatifs à la nourriture, à la bois¬son, aux plaisirs d'Aphrodite et à tout ce qui leur est associé. Nous l'avons aussi appelée « amie de l'argent «, parce que c'est principalement avec de l'argent que les désirs de ce genre trouvent à se satisfaire.
— Ce sont des appellations correctes, dit-il.
— Si donc nous affirmions que le plaisir de cette espèce et son affection se portent vers le profit, ne disposerions-nous pas d'un principe de base pour appuyer notre raisonne¬ment, de manière à clarifier pour nous de quoi il s'agit chaque fois que nous parlerions de cette partie de l'âme ? En l'appelant « amie de l'argent et amie du profit «, ne la désignerions-nous pas correctement ?
— C'est en tout cas l'opinion que je m'en fais, dit-il.
— Mais dis-moi, l'élément d'ardeur, n'affirmons-nous pas qu'il tend toujours tout entier vers le pouvoir, la victoire et la renommée ?
— Si, certainement.
— Si donc nous déclarions qu'il est « ami de la victoire « et « ami de l'honneur «, serait-ce approprié ?
— Ce serait tout à fait approprié.
— Mais l'espèce par laquelle nous apprenons, il est évi-dent pour chacun qu'elle est toujours tout entière orientée vers la connaissance de la vérité, où qu'elle soit, et que, parmi les espèces de l'âme, elle est celle qui se soucie le moins des richesses et de la réputation.
— Oui, et de loin.
— Si nous l'appelions « amie du savoir « et « amie de la sagesse «, philosophe, ne la désignerions-nous pas de la manière qui convient ?
— Si, nécessairement.
— Or, repris-je, dans les âmes de certains, c'est cette espèce qui commande, alors que chez d'autres, c'est l'une des deux autres, selon la situation ?
— C'est bien le cas, dit-il.
— C'est pour cette raison que nous affirmons qu'il existe trois genres d'hommes principaux, le philosophe, l'ami de la victoire et l'ami du profit.
10. La tripartition de la cité
Platon, La République, 434b-434d, ibid., p. 1598.
— Mais je suppose que si un artisan ou quelqu'un d'autre naturellement doué pour les affaires, après s'être élevé par la richesse, ou par le nombre de ses gens, ou par sa puissance ou
pour d'autres raisons de ce genre, entreprenait de joindre les rangs de la classe militaire, ou alors que l'un des guerriers qui ne le mériterait pas entreprenait de joindre la classe respon-sable du conseil et de la garde, et que ces gens échangeaient les uns avec les autres leurs outils et la reconnaissance qu'ils tirent de leur fonction, ou alors si un même homme entreprenait d'accomplir toutes ces tâches en même temps, alors je pense que tu jugerais que ce renversement et cette dispersion dans les tâches constitueraient la destruction de la cité.
— Tout à fait.
— Cette dispersion dans une multiplicité de tâches au sein des trois classes de la cité, cette inversion des tâches les unes avec les autres, constituent donc le plus grand tort pour la cité, et c'est tout à fait à bon droit qu'on les jugerait comme une calamité extrême.
— Oui, parfaitement.
— Mais ne diras-tu pas que la calamité la plus grande à l'endroit de sa propre cité est l'injustice ?
— Bien sûr.
— Voilà donc ce qu'est l'injustice. Tentons de le réexpo-ser de la manière suivante. Le contraire de cette injustice serait donc la justice, qui consisterait pour chaque classe — celle de l'homme d'affaires, celle du militaire auxiliaire, celle du gardien — à exercer ses propres activités dans la cité ; c'est cela qui rendrait la cité juste.
11. Le philosophe-roi
Platon, La République, 520a-521b, ibid., p. 1684-1686.
— Une fois de plus, mon ami, dis-je, tu as oublié qu'il n'importe pas à la loi qu'une classe particulière de la cité
atteigne au bonheur de manière distinctive, mais que la loi veut mettre en oeuvre les choses de telle manière que cela se produise dans la cité tout entière, en mettant les citoyens en harmonie par la persuasion et la nécessité, et en faisant en sorte qu'ils s'offrent les uns aux autres les services dont chacun est capable de faire bénéficier la communauté. C'est la loi elle-même qui produit de tels hommes dans la cité, non pas pour que chacun se tourne vers ce qu'il souhaite, mais afin qu'elle-même mette ces hommes à son service pour réaliser le lien politique de la cité.
— C'est vrai, dit-il, j'avais oublié, en effet.
— Observe alors, Glaucon, dis-je, que nous ne serons pas injustes à l'endroit de ceux qui chez nous deviennent philosophes, mais que nous leur tiendrons un discours juste en les contraignant, en plus du reste, à se soucier des autres et à les garder. Nous leur dirons en effet qu'il est normal que ceux qui en viennent à occuper leur position dans les autres cités ne participent pas aux tâches qu'on y assume. Ils s'y développent en effet de par leur propre initiative, sans l'agrément de la constitution politique qui se trouve dans chacune de ces cités, et il est juste que ce qui se développe par soi-même, ne devant sa subsistance à personne, n'ait aucunement à coeur de payer à quiconque le prix de son entretien. « Mais dans votre cas, leur dirons-nous, c'est nous qui, pour vous-mêmes comme pour le reste de la cité, comme cela se passe dans les essaims d'abeilles, vous avons engendrés pour être des chefs et des rois, en vous donnant une éducation meilleure et plus parfaite qu'aux autres, et en vous rendant plus aptes à participer à l'un et l'autre mode de vie. [...] « Car voici en quoi consiste le vrai là-dessus : la cité au sein de laquelle s'apprêtent à gouverner ceux qui sont le moins empressés à diriger, c'est celle-là qui est nécessaire¬ment administrée de la meilleure façon et la plus exempte de dissension, tandis que celle que dirigent ceux qui sont dans l'état contraire se trouve dans la situation opposée.
— Oui, exactement, dit-il.
— Crois-tu dès lors que ceux dont nous avons assuré la subsistance, quand ils entendront ce discours, ne se laisse-ront pas persuader et qu'ils ne consentiront pas à peiner comme les autres dans la cité, chacun à son tour, tout en résidant la majeure partie de leur temps entre eux dans la région pure ?
— C'est impossible, dit-il, car nous prescrirons des règles justes à des hommes justes. Par ailleurs, c'est avant tout comme vers un devoir que chacun d'eux se portera vers le pouvoir, contrairement à ceux qui dirigent maintenant dans chaque cité.
— Voilà bien la situation, mon camarade, dis-je. Si tu peux découvrir, pour ceux qui s'apprêtent à diriger, une vie meilleure que le pouvoir, tu peux alors faire advenir une cité bien administrée. C'est en effet dans cette cité seulement que dirigeront ceux qui sont réellement riches : riches non pas d'or, mais de cette richesse qui est nécessaire à l'homme heu¬reux, c'est-à-dire une vie bonne et remplie de sagesse. Mais si ce sont des mendiants et des gens que leur vénalité porte vers des biens privés qui s'emparent des affaires publiques, croyant qu'il se trouve là du bien qu'il faut accaparer, alors ce ne sera pas possible. Si le pouvoir, en effet, devient l'objet d'un affron¬tement, une guerre de ce genre, parce qu'elle est intérieure et qu'elle fait s'affronter ceux qui sont apparentés, les détruit eux-mêmes autant que le reste de la cité. [...]
12. La part d'immortalité du sage
Platon, Timée, 90a-90c, in OEuvres complètes, op. cit.,
trad. L. Brisson, p. 2048.
[...] En ce qui concerne l'espèce d'âme qui en nous domine, il faut se faire l'idée que voici. En fait, un dieu a donné à chacun de nous, comme démon, cette espèce-là d'âme dont nous disons, ce qui est parfaitement exact, qu'elle habite dans la partie supérieure de notre corps, et qu'elle nous élève au-dessus de la terre vers ce qui, dans le ciel, lui est apparenté car nous sommes une plante non point terrestre, mais céleste. C'est à cette région en effet, à partir de laquelle poussa la première naissance de l'âme, que l'espèce divine accroche notre tête, c'est-à-dire nous enra-cine, et maintient ainsi tout notre corps droit. Cela étant, à l'homme qui s'est abandonné aux appétits et aux ambitions et qui se donne beaucoup de peine pour assurer leur satisfac¬tion, il arrive nécessairement que toutes ses pensées sont devenues mortelles et qu'exactement dans toute la mesure où il lui est possible de devenir mortel, il n'y manque pas, si peu que ce soit, puisque c'est la partie mortelle qu'il a développée. Au contraire, l'homme qui a mis tout son zèle à acquérir la connaissance et à obtenir des pensées vraies, celui qui a exercé surtout cette partie de lui-même, il est absolument nécessaire, je suppose, qu'il ait des pensées immortelles et divines, si précisément il atteint à la vérité ; que, dans la mesure, encore une fois, où la nature humaine est capable d'avoir part à l'immortalité, il ne lui en échappe pas la moindre parcelle ; enfin que, puisqu'il ne cesse de prendre soin de son élément divin et qu'il maintient en bonne forme le démon qui en lui partage sa demeure, il soit supérieurement heureux.
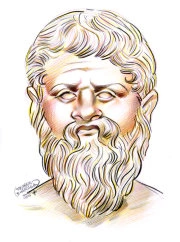
«
66 1 DE HOMÈRE À PLATON : LA NAISSANCE DE LA PHILOSOPHIE
aussi des vêtements ; je t'enverrai encore par l'arrière un vent
favorable, afin que
tu reviennes indemne en ta patrie, si du
moins le permettent les dieux, qui habitent le vaste ciel et qui
sont plus puissants que moi
pour concevoir et exécuter.
»
[ ...
]
Ayant ainsi parlé, l'auguste déesse le guida rapidement et le
héros suivait
ses pas.
Ils arrivèrent au creux de la grotte, et
Ulysse s'assit sur le siège d'où s'était levé Hermès ; la nymphe
plaçait près de lui toutes sortes de mets à manger et à boire,
tout ce dont se nourrissent les hommes mortels.
Elle-même
s'assit en face
du divin Ulysse, et des servantes lui présentèrent
ambroisie et nectar.
Tous deux tendirent
les mains vers les
mets disposés devant eux.
Puis,
quand ils eurent pris plaisir à
manger et à boire, Calypso, l'auguste déesse, parla la pre
mière :
«Nourrisson de Zeus, fils de Laërte, Ulysse aux mille
expédients,
il est donc vrai que tu veux, dès maintenant, rega
gner ta maison dans la terre aimée de tes pères
? Quoi que tu
résolves, bon succès! Mais si tu savais en ton esprit de quelles
peines
le sort doit te combler avant d'atteindre la terre de tes
pères,
tu resterais ici avec moi à garder cette demeure et tu
serais immortel, malgré ton désir de revoir ton épouse, pour
qui tu soupires sans cesse au long des jours.
Pourtant, je m'en
vante, je ne suis pas moins bien faite, moins élancée ; car il ne
sied même pas que des mortelles rivalisent avec des
Immor
telles pour la stature et la beauté.
»
Ulysse aux mille ruses lui répondit : « Puissante déesse,
n'en sois pas irritée contre moi.
Je sais fort bien que la sage
Pénélope n'est, à la voir,
ton égale ni pour la beauté, ni pour
la taille ; c'est une mortelle ; toi tu ne connaîtras ni la mort
ni la vieillesse.
Malgré tout, je veux et souhaite tous les jours
revenir en
ma maison et voir la journée du retour.
Si un dieu
me fait naufrager sur la mer vineuse, je m'y résignerai ; j'ai
dans
ma poitrine un cœur endurant : j'ai déjà tant souffert de
maux, subi d'épreuves sur
les flots et à la guerre ! Advienne
encore ce surcroît..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- EXTRAITS DE LA PENSÉE DE PLATON (Anthologie philosophique)
- Platon, Phèdre (extrait) - anthologie.
- La Fontaine avait beaucoup de goût pour les lectures et discussions philosophiques. Il lisait, s'il faut l'en croire, Platon; il discutait le système de Descartes; il s'engouait, grâce à son ami Bernier, de la philosophie de Gassendi, etc. Dans quelle mesure, selon vous, peut-on trouver dans les Fables un intérêt philosophique ?
- LIVRE V DE LA REPUBLIQUE DE PLATON : LES FONDEMENTS POLITIQUE ET PHILOSOPHIQUE DE LA BELLE CITE
- L'amour philosophique chez Platon dans le Banquet